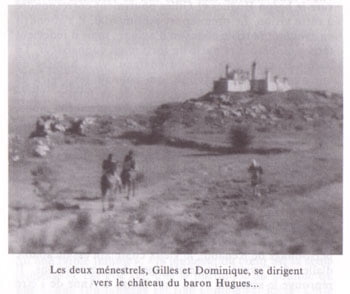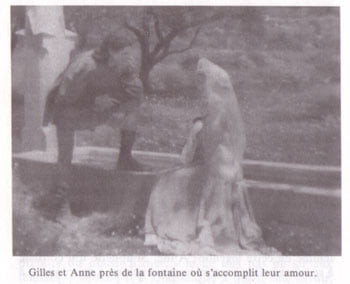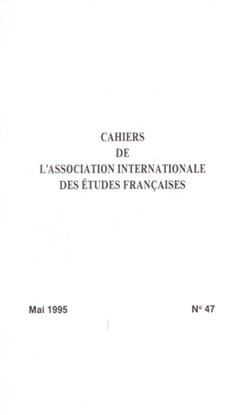LES VISITEURS DU SOIR
UNE DATE PEUT EN CACHER UNE AUTRE
Communication de Mme Danièle GASIGLIA-LASTER au XLVIe congrès de l’Association, le 19 juillet 1994, parue dans les Cahiers de l’Association internationale des études françaises, mai 1995, n° 47
– avec l’aimable autorisation de Danièle Gasiglia-Laster –
—————————
Danièle Gasiglia-Laster : Critique littéraire ; ses travaux et publications sont axés sur trois auteurs : Victor Hugo, Marcel Proust et Jacques Prévert ; a présenté, établi et annoté, en collaboration avec Arnaud Laster, l’édition dans la « Bibliothèque de la Pléiade » des Oeuvres complètes de Jacques Prévert ; auteur de la biographie Jacques Prévert, « celui qui rouge de cœur », parue chez Séguier.
—————————
« […] Or donc, en ce joli mois de mai 1485, messire le Diable dépêcha sur terre deux de ses créatures afin de désespérer les humains […] (Vieille légende du xve siècle). » C’est par ces mots, inscrits en lettres gothiques et entourés de rinceaux, sur la première page d’un livre filmée en gros plan, que commencent Les Visiteurs du soir, réalisés en 1942 par Marcel Carné sur un scénario et des dialogues de Jacques Prévert et Pierre Laroche.
Nous voilà d’emblée plongés dans le fantastique et invités à remonter le temps, jusqu’à une époque, charnière entre le Moyen Âge et la Renaissance, qui ne cessera d’intéresser Prévert : Notre-Dame de Paris, qu’il adaptera quatorze ans plus tard pour Jean Delannoy, en 1956, se déroule également dans le xve siècle finissant, et Agnès Bernauer, sketch pour Les Amours célèbres de Michel Boisrond réalisé en 1961, sera encore situé dans ce siècle.
C’est, à travers Les Visiteurs du soir, la vision du Moyen Âge de Prévert, ici assisté de Laroche, que j’essaierai de dégager, et aussi la manière dont, à la sortie du film (1), ce Moyen Âge a été perçu par la presse, c’est-à-dire non pas par des érudits ou des spécialistes, mais par des gens dits cultivés. Je n’aborderai donc qu’incidemment le travail du réalisateur, sa tentative d’évoquer visuellement la période où se situe le film ; je ne m’attacherai pas non plus à relever les inexactitudes du scénario par rapport à la réalité historique.
* *
En publiant la continuité dialoguée en 1947, les scénaristes mettront en épigraphe une citation de L’Automne du Moyen Âge (2) de Huizinga : « Les hommes de cette époque, géants à tête d’enfants, oscillent entre la peur de l’enfer et les plaisirs naïfs, entre la cruauté et la tendresse. Dédain absolu des joies de ce monde ou fol attachement aux jouissances terrestres, haine ou bonté. Ils vont toujours d’un extrême à l’autre. » On peut trouver dans le film, en effet, d’éventuelles traces d’une lecture du livre de Huizinga. Mais on ne sait pas de quels autres documents Laroche et Prévert se sont servis pour écrire le scénario et les dialogues.
Il est évident qu’il s’agit moins d’un Moyen Âge reconstruit que d’un Moyen Âge rêvé. Et il y a, dans le film, une sorte d’apologie de l’imagination et du rêve : le rêve qui permet l’évasion, la liberté. La lenteur voulue des premières images, puis l’arrêt complet du temps dans la fameuse scène du bal, où les personnages sont immobilisés, contribuent à donner une atmosphère onirique qui atteindra son apogée avec la scène du tournoi, vue dans l’eau légèrement frémissante d’une fontaine, comme un mirage, ou un songe. Marcel Carné a dit, au cours d’un entretien accordé avant la sortie du film : « Ce n’est pas une « reconstitution historique » dans le sens où on l’entend d’ordinaire, mais plutôt une sorte d’évocation stylisée […]. C’est, si l’on me permet ce terme, une sorte de « mystère » cinématographique où le fantastique intervient souvent (3). » Le terme d’« évocation stylisée » me paraît convenir également au scénario. Prévert et Laroche, tout en endormant la censure par le charme d’une prétendue légende d’autrefois, nous proposent un Moyen Âge à leur manière, où les allusions à l’époque contemporaine ne sont pas, malgré les apparences, totalement absentes.
Si l’intrigue du film est très précisément datée, elle ne comporte aucune référence explicite à l’histoire, ou à des personnages réels. Remarquons cependant qu’en 1485 commence la régence d’Anne de Beaujeu et que s’organise contre elle la coalition des grands féodaux. Or, un des principaux personnages des Visiteurs du soir est une jeune fille prénommée Anne… On peut toutefois se demander si cette date de mai 1485, qui ne figure ni dans le découpage technique, ni dans le texte qui sera publié en 1947, n’en cache pas une autre : celle par exemple, si on l’inverse, du 5 août 41 (1941, bien sûr…) proche, dans le temps, de la rédaction du film, peut-être date du début de l’écriture du scénario. Quant au mois de mai, mois privilégié dans les récits du Moyen Âge, mois des fêtes, il est aussi lié au printemps, saison très bénéfique dans l’œuvre de Prévert, symbole pour lui non seulement d’un renouveau mais d’une révolution.
Le découpage technique et, plus discrètement, la continuité dialoguée publiée par les auteurs, situent le château des Visiteurs du soir en Provence. Mais dans le film, toute localisation précise a disparu. Le seul décor est le château et ses environs les plus proches ; les deux « ménestrels » (c’est ainsi qu’ils se qualifient eux-mêmes) qui se dirigent vers ce château au début, arpentent le chemin escarpé d’une contrée désertique décrite ainsi par Prévert et Laroche : « Des pierres… des rocs abrupts… des coulées de lave pétrifiée… des gouffres ». On voit d’abord le château, perché, au loin, sur une colline, un champ et, en premier plan, un cheval qui tire une charrue, un paysan qui sème des graines. L’image a été inspirée à Marcel Carné, de son propre aveu, par une miniature des Très Riches Heures du duc de Berry. Et, en 1942, cette référence est reconnue par plusieurs critiques. La plupart trouvent ces premiers plans du film fidèles à ce que devaient être les paysages du Moyen Âge tels que nous les restituent les documents d’époque : « Certaines images évoquent des tableaux qui sont dans nos yeux depuis l’enfance : ce laboureur d’il y a cinq cents ans, qui jette le grain dans cette terre noire, pendant que le château qui le protège et l’exploite à la fois se profile dans le lointain », commente l’un d’eux (4). Près du château, une végétation apparaîtra : des arbres, des fleurs, des plantes. Le château et ses environs sont une sorte d’îlot, ou bien une oasis dans un désert.
Les personnages, tous fictifs, ne sont jamais désignés que par leurs prénoms : Gilles, Dominique, Anne, avec, pour deux d’entre eux, un titre accolé à ce prénom : le chevalier Renaud, le baron Hugues. Le diable, qui se fait passer pour une sorte de chevalier errant, ne se donne même pas la peine, lui, de se présenter : « mon nom, mes titres, ne vous diraient pas grand-chose. Je viens de si loin… » Ils ne correspondent guère, ces personnages, à la définition de Huizinga. Prévert et Laroche les chargent de trop de symboles pour que s’opère ce passage de la cruauté à la tendresse, de la haine à la bonté, dont parle l’auteur de L’Automne du Moyen Âge. Ils sont plutôt ou toute haine ou toute bonté. Seuls, peut-être, le bourreau, et dans une moindre mesure le baron Hugues et Gilles pourraient correspondre à cette vision. Le premier est sentimental, il s’attendrit en écoutant la triste chanson d’amour ; mais il redevient féroce au besoin et parle de torture en connaisseur. Le baron Hugues, seigneur du château, vieil homme en apparence plein de civilité, qui connaît les règles de l’hospitalité, vit dans le souvenir de sa femme morte depuis des années. Il semble aimer tendrement Anne, sa fille, mais s’apprête sans hésitation à la donner au chevalier Renaud pour lequel elle n’a, de toute évidence, aucune inclination. Huizinga enseigne, il est vrai, que « l’idéal de l’amour […] ne tenait aucune place dans les considérations très matérielles qui présidaient au mariage, spécialement au mariage entre gens de la noblesse »… Et le vieux baron Hugues n’est pas du genre à chambouler les conventions. Hugues représente une des facettes de l’esprit féodal, que viendra compléter le personnage de Renaud : le vieux châtelain est incapable d’aller de l’avant, de se dégager des conventions. Il réprouve le scandale et en veut moins à Anne de s’être livrée à des plaisirs coupables avec un inconnu que d’avoir eu l’impudeur de le dire à tout le monde. Sous ses dehors d’homme affable et fatigué, le baron laisse entrevoir une mentalité de tyran. « […] Que diraient votre fille… et le chevalier Renaud ? », lui demande Dominique, à qui il vient d’avouer son amour. « Ils ne diront rien, parce qu’ils n’auront rien à dire… Quand je parle, on m’écoute et on se tait. » D’abord détaché de ce monde, il apprécie à nouveau les joies terrestres en s’éprenant de Dominique, mais on n’a pas l’impression qu’il soit dans son caractère de passer ainsi de l’indifférence à l’enthousiasme. Ce passage d’un extrême à l’autre s’opère sous l’influence du diable.
Gilles et Dominique, émissaires du démon (ils ont signé avec lui un pacte) doivent séduire les créatures pour les damner, ce qui n’est pas difficile pour eux : sortes de préfigurations de Valmont et de Merteuil, ils ont passé leur vie à captiver les autres sans les aimer, se plaisant à les faire souffrir. Gilles ne croit pas au bonheur qu’il juge « absurde, triste, monotone et fastidieux ». Mais tout change quand il rencontre une jeune fille, sa victime désignée, Anne, qui lui redonne goût à la vie. Hugues retrouvait ce goût grâce au diable ; l’envoyé du diable se métamorphose grâce à l’amour. C’est un changement radical et profond qui n’est pas, non plus, cette oscillation décrite par Huizinga.
Dominique, l’autre soldat du diable, est peut-être le personnage le plus étrange. Son ambiguïté se révèle quand on découvre que ce soi-disant jeune homme est en réalité une femme. Cette androgynie est un des signes de son inhumanité. Dominique est d’une froideur absolue, n’éprouve rien ; elle est de marbre, même en amour. Au baron Hugues elle parle par poncifs (« je ne suis qu’une faible femme », « la jeunesse du cœur est la seule jeunesse »), car elle sait que le baron est un homme du passé, que son langage est figé comme ses idées. Cette manière de vaincre l’autre en feignant d’utiliser les lieux communs qui constituent son langage est très prévertienne.
Renaud incarne la féodalité dans ce qu’elle a de plus sauvage et brutal. Il aime la chasse, s’ennuie quand on parle d’amour et a la nostalgie d’un temps plus ancien où on disait moins de « fadaises ». Indiscutablement, il considère sa fiancée, Anne, comme un bien acquis au même titre que ses terres, que ses meubles et que ses chiens. Il tient à faire respecter ses droits sur elle : elle est sa possession, elle appartient à son territoire, et gare à celui qui osera la regarder un peu trop intensément. Le ménestrel qui semble chanter pour elle sa chanson d’amour est menacé aussitôt de pendaison et plus tard Renaud demandera au bourreau de le défigurer. Même quand il tombe amoureux d’une autre femme, il n’admet pas que Gilles et Anne puissent s’aimer. Une balafre sur sa joue contribue à lui donner un air de mâle férocité, suggérant qu’il aime les combats violents, ce qui est d’ailleurs confirmé dans ses propos : il dit prendre du plaisir à tuer. « Je ne sais pas parler aux femmes », avoue-t-il à Dominique à qui il fait savoir, sans détours, qu’il la désire. Mais Dominique lui dit préférer cette manière à des formes plus courtoises : « Je vous ai dit que vous parliez brutalement, mais je n’ai pas dit que cela me déplaisait. Il y a tant d’hommes qui se disent des hommes et qui se plaisent à larmoyer auprès de leurs belles. » Dominique, il est vrai, est l’avocat du diable… Pourtant, avec elle, et poussé par elle, Renaud va pratiquer, à sa manière, cet amour courtois qu’il a tellement dédaigné, mais dans le combat uniquement et pour prouver sa bravoure et sa force, ce qui au fond ne le change guère. Dans la lutte à mort qui l’oppose au baron Hugues — et dont l’enjeu est Dominique — il accepte, pour ses beaux yeux, de ne pas porter de cotte de maille. Ce détail est peut-être emprunté au fabliau de Jakes de Baisieux, Des trois chevaliers et del chainse (5), évoqué par Huizinga : « Une dame […] envoie à trois chevaliers qui la servent son chainse, sorte de vêtement, pour que l’un d’eux le porte dans le prochain tournoi, en guise de cotte d’armes et sans aucune cuirasse. Les deux premiers chevaliers déclinent l’offre. Le troisième, qui est pauvre, embrasse le chainse avec passion et le porte au tournoi. Il est grièvement blessé, le chainse déchiré et maculé de sang. » Or, c’est Dominique qui demande à Renaud, pour lui prouver sa bravoure et son amour, de ne pas se protéger, et elle lui dit en montrant son corsage : « Demain vous porterez ceci sur votre pourpoint… Vous vous rappellerez la chaleur de mon corps en vous battant pour le garder. » Prévert semble avoir retenu de Huizinga que le tournoi a un caractère érotique qui exige une sanglante violence.
À l’ambiguïté de Dominique s’oppose la simplicité, plusieurs fois soulignée dans les dialogues, de l’autre femme de cette légende : Anne. Simplicité qui consiste à se laisser aller à ses joies, à ses peines, à ses plaisirs, à vivre intensément. Mais au piège du langage elle ne se laisse jamais prendre, pas même à celui de la parole donnée. « J’ai menti », ose-t-elle dire au diable à qui elle s’est promise en échange de la vie sauve de son amant. Et c’est le personnage le plus fort de l’histoire : le héros est une héroïne. Anne sait ce qu’elle veut, elle sait, dès qu’elle voit Gilles, que c’est lui qu’elle aime. Mais elle a besoin de s’assurer qu’il ne l’aime pas comme Renaud : « Est-il possible, l’interroge-t-elle, qu’un être puisse appartenir à un autre être ? — Certains appellent cela l’amour », répond-il. En demandant à Gilles de l’aimer autrement, sans l’enfermer et en la laissant vivre, Anne s’affirme peut-être la plus en décalage avec son époque. Gilles semble pourtant admettre finalement ces revendications : « Anne n’appartient à personne, elle est libre », dit-il au diable. Si le lieu où s’accomplit l’amour — près d’une fontaine, dans une sorte de jardin des délices, sur un tapis de fleurs — n’est pas étranger aux romans de chevalerie, il paraît plus insolite qu’Anne le fasse sans hésiter, ni soumettre son amant à de longues épreuves, ni retarder l’aveu. Il ne fait aucun doute que pour elle l’amour n’est pas adoration platonique et, moins traditionnellement encore, qu’il ne nécessite ni le silence ni la discrétion. Peu à peu, les relations entre Anne et Gilles en viennent même à être inversées par rapport aux schémas traditionnels. C’est Gilles qui demande à Anne de le protéger, conscient de la force intérieure de la jeune fille. Anne lui donne l’énergie dont il a besoin, et la conviction qu’elle a de l’invincibilité de leur amour va les rendre invincibles. « Le motif essentiel de la poésie chevaleresque amoureuse », qui, selon Huizinga, « sera la délivrance de la vierge par le héros », devient chez Prévert la délivrance du jeune homme — vierge non pas physiologiquement mais sentimentalement (puisque Gilles n’a jamais aimé personne) — par l’héroïne.
Curieusement, la presse de 1942 et de 1943 n’a guère vu ce que pouvait avoir de contestataire, voire de contradictoire par rapport aux idéaux pétainistes ou nazis ce personnage de jeune fille, ni que ses revendications étaient bien étonnantes chez une jeune noble du xve siècle. Ou bien elle a fait semblant de ne pas le voir : Anne est à plusieurs reprises qualifiée de jeune fille douce et pure. À Marie Déa, dit un critique (Marie Déa est l’interprète d’Anne), « il est demandé d’être belle, virginale et passionnée (6) ». Une rédactrice se plaint que l’actrice soit mal maquillée et commente : « on eût aimé une princesse de rêve idéale et fragile » (7). Un autre critique discute le choix de Marie Déa pour incarner la « tendre, possédée d’amour ». Cette actrice, ajoute-t-il, « manque de grâce et de pureté : son visage n’a ni lumière ni auréole (8) ». Or, Anne est peut-être pure au sens où l’entend Prévert — elle aime avec force et conviction et rien ne peut ternir son amour —, mais elle n’est ni fragile ni vraiment virginale… Et que l’on puisse lui prêter une auréole a dû faire rire le principal auteur du scénario.
* *
Le diable fait une apparition tardive, au moment où Gilles, lui désobéissant, prend conscience de son amour pour Anne. Il vient donc rétablir l’ordre, ce diable dont tout le monde a encore si peur en cette fin du xve siècle. Son arrivée est signalée par des coups de tonnerre et une tempête soudaine, et la première vision que l’on a de lui est celle d’une ombre projetée dans la nuit sur le mur du château par la foudre et les éclairs. Il est vêtu de vêtements sombres et a l’air assez inquiétant, mais son apparence est celle d’un homme : aussi est-il reçu selon les règles de l’hospitalité par le seigneur des lieux. Son apparition au beau milieu de l’orage est on ne peut plus théâtrale mais, à l’exception de ses deux émissaires, les ménestrels Gilles et Dominique, personne ne se doute que cet homme est le diable. Et il ne le dira qu’à une de ses victimes désignées, Anne, probablement parce qu’il devine que c’est contre elle que la partie va être la plus dure.
Ce diable est en tout cas le personnage qui suscite le plus de commentaires dans la presse de 1942. « Il n’a pas, dit Marcel Lapierre, la physionomie allégorique (pieds fourchus, tête encornée et barbichue, etc.). » Le même remarque aussi que c’est un « diable qui se fait avoir » et que dans « des « mystères » de la passion, tel celui de Jehan Michel, le diable était un personnage comique, un destinataire de coups de pied au cul. Dans les drames sacrés du théâtre médiéval, les apparitions du démon avaient quelque chose comme des entrées de clown » (9). Un certain J.R. trouve « Jules Berry assez malin pour présenter un malin exceptionnel » et apprécie que ce « diable désinvolte, cynique, trépidant et tournoyant […] ne porte ni sourcils relevés en pointe, ni barbiche méphistophélique (10) ». D’autres, au contraire, regrettent qu’il soit trop proche de nous : « N’eût-il pas été préférable d’évoquer le diable sous une forme moins précise (11) ? » ; « Berry, diable trop humain et noceur est une erreur (12) ». Didier Daix s’étonne qu’il « discute le coup » avec Anne, « qu’il la supplie (13) ». Plusieurs lui trouvent des ressemblances… avec Méphisto.
On fait peu d’analyses, généralement, des rôles de Renaud, Dominique ou Hugues, sinon pour complimenter les acteurs. La conception de l’amour soulève de nombreuses discussions, provoque maintes allusions au Moyen Âge et à sa littérature : « Ce film, écrit un journaliste, rappelle les grandes légendes du roi Arthur, de Tristan et Yseult, etc. Il procède d’ailleurs du même esprit puisqu’il reprend les romans courtois du xve siècle, où le merveilleux frôle la féerie et où l’amour est présenté comme un sentiment d’essence purement invincible » (14), écrit un rédacteur du Journal. « Évoquons Faust et Tristan et Yseult ; le rapprochement n’est pas déplacé » (15), dit Jean Moingt dans Demain. Un chroniqueur du Dimanche illustré parle, lui, du « Moyen Âge brutal et tendre de Chrétien de Troyes et de Rutebeuf » (16).
Ce qui est amusant, c’est que beaucoup disent qu’il s’agit d’une véritable légende médiévale, « que l’on contait jadis dans les demeures seigneuriales », est-il même précisé dans un compte-rendu du film. Mais ce que presque personne ne semble remarquer, c’est que, s’il y a bien, dans l’histoire, un combat entre les forces des ténèbres et de la lumière, ce combat du diable n’est pas contre Dieu. La lumière, l’envers du diable, c’est Anne, et c’est l’amour humain… Dans ce « mystère », puisque c’est ainsi que Carné qualifiait, non sans précautions, le film, il manque donc le personnage principal.
Dieu est absent : son nom même n’est à aucun moment prononcé. Il y a, dans le film, quelques signes qui peuvent laisser supposer qu’on pratique, dans ce château, la religion chrétienne ; mais ils sont rares. Avant et après la première visite tentatrice de Dominique, le baron Hugues s’agenouille sur une sorte de prie-dieu orné d’un livre que l’on peut supposer de prière ; mais ce prie-dieu n’est surmonté d’aucune image pieuse ni d’aucune croix, seulement du portrait de la défunte épouse du baron qui, par un tour du diable, prend soudain les traits de Dominique. Au moment du départ pour la chasse, un gros seigneur jovial dit que « c’est grand dommage de faire lever les chrétiens à pareille heure ». Et quand Renaud sera tué, les cloches — peut-être celles d’une chapelle ou d’une église — sonneront sa mort. Mais son corps, bien que veillé par deux moines, est emporté dans une salle vide. Certes, les émissaires du diable disent à ceux qu’ils viennent tenter : « j’ai remercié le ciel de m’avoir conduit jusqu’à vous », mais ce sont là paroles dictées par le démon. Anne, qui dit au diable sidéré : « Vous n’existez pas pour moi », ne parle jamais, non plus, de Dieu. Tout laisse supposer qu’elle n’y croit pas : « La vie tout entière, n’est-elle pas remplie de choses inexplicables ? », dit-elle à Gilles. « Un oiseau, un fruit, une bête, le soleil, les arbres de ces bois. Et nous-mêmes qui ne savons pas d’où nous venons, où nous allons. » Aussi n’accorde-t-elle aucune importance à ce que les autres appellent « péché », ce qui dérange fort les plans du satanique personnage :
« […] tu oublies, perfide créature, que tu as commis la faute, le péché », dit-il à Anne. Et celle-ci répond sans se démonter : « Si c’est une faute que s’être abandonnée à celui qu’on aime, je ne regrette pas de l’avoir commise. » Alors que, selon Huizinga, dans « l’esprit médiéval, tous les sentiments purs et élevés sont absorbés dans la religion tandis que les penchants naturels, sensuels, consciemment refoulés tombent au niveau de coupable amour du monde », et surtout que « la sensualité » est « abandonnée au diable », ici, cette sensualité, hors de toute religion et de tout péché, fait partie de l’amour parfait, idéal, qui va vaincre le diable.
Mais tout le monde n’est pas dupe : certains critiques sentent bien une odeur de roussi dans ce Moyen Âge tel que nous le donnent à voir Les Visiteurs du soir. Maurice Rousseau du Gard, par exemple, s’étonne de la « béate admiration » que l’on a pour le film qu’il commente ainsi : « […] dans ce château du Moyen Âge, nulle trace de sentiment chrétien, hormis la pauvre prière que l’on voit le baron Hugues marmonner à genoux, ce qui ne l’empêche pas de l’interrompre pour se laisser séduire par l’endiablée Dominique. Nous avons une haute idée du véritable Amour pour nous extasier devant cette production qui n’est que l’exaltation idéalisée de la passion sensuelle » (17). Un an après, Les Visiteurs du soir sont pourtant proposés comme un film de propagande française à l’ambassadeur d’Espagne, totalement éberlué qu’on puisse lui faire une pareille offre et qui demande vertement qu’on lui cache ce sein qu’il ne saurait voir, dans une lettre au chef du gouvernement, Pierre Laval, datée du 8 avril 1944 : il « y note surtout l’absence de toute moralité véritable, le côté « irréligieux » et purement païen d’un scénario qui se réfère pourtant à une époque qui est celle des cathédrales, et que les Espagnols ne voient, par formation culturelle, qu’à travers le prisme de la catholicité et de la foi. Il est inouï à cet égard, qu’à côté de tant de châteaux forts en carton l’auteur de ce film n’ait songé à aucun moment à nous montrer, dans ce paysage français du xve siècle, une croix ou une église. [… ] Il n’est, à cet égard, jusqu’à la figuration inattendue d’un Satan bon vivant et débordant de jovialité qui n’apparaîtrait à la piété castillane comme un enjolivement de l’enfer./ Par ailleurs, la plate sensualité du sujet, ponctuée par un abus risible du baiser passionné, de l’extase sentimentale, de la fureur amoureuse, le tout à base d’adultère facile, de luxure généralisée, y rend un son de matérialisme dont l’obsession ne manquerait pas de lasser ou d’irriter un public qui, comme celui d’Espagne, est essentiellement pudibond./Enfin, j’ose à peine indiquer que la crudité de certains détails vestimentaires masculins, pour historiquement défendable qu’elle puisse être, achève de faire de ce spectacle le type d’une littérature et d’une imagerie dont les Espagnols supportent mal l’importation et qu’ils nous reprochent comme la marque même de notre impiété et de notre inconvenance » (18).
De son point de vue, cet ambassadeur n’a pas tort, quoique ce Satan qui lui paraît bon vivant et jovial soit tout de même, malgré sa politesse et son goût pour la plaisanterie, une sinistre canaille avec laquelle les représentants du pouvoir, Hugues et Renaud, n’hésitent pas à collaborer.
* *
C’est par l’intermédiaire d’Anne, pourtant fille du baron, mais qui, elle, résiste immédiatement et sans faiblir à cet ennemi, que se profile une autre époque, un avenir, un printemps, une renaissance… Anne, c’est le contraire de la résignation et du repliement sur soi. Elle n’a rien à cacher et quand le diable la met au défi de dire son amour aux gens de la ville, c’est ce qu’elle fait, criant par les fenêtres du château qu’elle y est prisonnière et qu’on veut l’empêcher d’aimer Gilles. Cette ville, que l’on ne voit pas, à qui est criée une vérité qui ne devrait pas se dire, cette ville qui phonétiquement peut s’entendre « vile », c’est peut-être aussi le peuple, un peuple qui vit dans l’ombre, et que l’on maintient dans l’obscurantisme. La confession publique d’Anne est d’abord écoutée par des seigneurs et des hommes d’armes étonnés, puis la caméra montre, dans la foule, des gens simples qui lèvent la tête vers la jeune fille, intéressés. Gilles va lui aussi se rapprocher de ce peuple dont au départ il ne fait pas partie. Il rend la joie à un pauvre saltimbanque en ressuscitant son ours méchamment abattu par les gardes du château ; il transforme le visage difforme de Louison, une servante trop laide pour être aimée. Et il va peu à peu s’identifier au ménestrel dont il joue le rôle, celui d’un poète qui représente le peuple, celui d’un homme du peuple enchaîné par des seigneurs, menacé de torture par le diable et par Renaud. Prisonniers dans le chenil, Gilles et Anne seront d’ailleurs regardés avec compassion par le peuple qui se pressera aux grilles, fasciné par le chant d’amour de Gilles.
On a contesté — et Carné lui-même — le rapport que pouvait entretenir le film avec les événements qui se passaient au moment où il était réalisé. C’était sans compter avec la capacité de Prévert de jouer sur les différentes interprétations possibles d’une histoire. Il tenait beaucoup à la fin (Carné était, paraît-il, plus réticent), à la victoire de l’amour sur le mal et sur la mort, symbolisée par les cœurs des deux amants continuant à battre à l’unisson bien qu’ils aient été changés en statues de pierre par le démon : « Mais c’est leur cœur que j’entends », dit alors le diable, impuissant et fou de rage, « leur cœur qui bat… qui ne cesse de battre… Leur cœur qui bat… qui bat… qui bat…, qui bat… »
Même si l’amour de Gilles et d’Anne n’est pas marqué par la fatalité — c’est un amour conscient, volontaire, salvateur —, on n’a pas eu tort de le rapprocher de celui de Tristan et Yseult. Prévert a très bien pu lire leur histoire telle qu’elle a été relatée par Joseph Bédier, version qui restait la plus connue dans les années 40 : Bédier y racontait comment une ronce verte, jaillie de la tombe de Tristan, s’enfonçait dans celle d’Yseult sans que personne réussisse à la détruire. Mais il est très éclairant de mettre aussi la fin des Visiteurs du soir en parallèle avec la fin d’un poème (19) écrit par Prévert en 1936, où il avait déjà utilisé cette métaphore du cœur que rien ne peut détruire, pour évoquer la résistance à Franco. Ce cœur, c’était « le cœur de la révolution », ce cœur, écrivait-il, « que rien… personne ne peut empêcher d’abattre ceux qui veulent l’empêcher de battre… de se battre… de battre… de battre... » Comment, à la lumière de ce texte, ne pas voir alors, dans les cœurs de Gilles et d’Anne, celui de la Résistance, et en cet homme noir qui croit tenir le monde dans ses mains, dont les soldats sont parfois glacés et indifférents à la souffrance, sortes de robots comme Dominique, Hitler et le nazisme ? Dans L’Ordre nouveau (20), poème écrit pendant la guerre, un soldat nazi est qualifié par Prévert d’« automate de l’Europe nouvelle ».
Et pour assister ces soldats du diable dans leur tâche, il y a aussi des monstres, qui semblent suivre Gilles et Dominique comme leur ombre. Là encore, si on peut supposer que Prévert emprunte ces monstres à ceux qui hantent le Moyen Âge, il faut également remarquer que les monstres seront nombreux dans une partie de son œuvre moins connue que ses dialogues et sa poésie : ses collages. Ils y seront d’ailleurs ambigus, susceptibles aussi bien d’incarner les victimes d’une société cruelle que de révéler, comme c’est le cas dans le film, une laideur intérieure.
Le scénario prévoyait, accompagnant le triomphe des amants, l’écroulement du château. Mais le budget ayant été dépassé et le film ayant coûté fort cher, on y renonça. Prévert se rattrapera plus tard, dans son adaptation pour Paul Grimault de La Bergère et le Ramoneur d’Andersen, où on assistera, après le combat d’un jeune couple de roturiers contre un roi méchant et mégalomane, à la destruction du château. Pour lui, le château, qu’il soit la demeure féodale du Moyen Âge ou bien la résidence seigneuriale ou royale de siècles moins éloignés, est le symbole du pouvoir absolu, de la tyrannie de l’exploitation ; montrer la destruction ou l’écroulement du château, c’est dire que les révolutions sont nécessaires pour que puisse naître un monde nouveau. La renaissance annoncée par cette fin du xve siècle et par ce « joli mois de mai » est une renaissance elle aussi toute symbolique. La féodalité et l’esprit féodal sont pour Prévert tenaces : il faut continuer à les combattre tant que tous les châteaux ne seront pas des musées ou des ruines ; il faut changer « l’automne du Moyen Âge » en printemps. « […] Les choses importantes de la vie, écrira Pierre Mac Orlan dans sa préface aux dialogues, se mêlent et s’entraident jusqu’à la confusion des dates par quoi l’histoire devient un enseignement véritablement humain. »
Danièle GASIGLIA-LASTER
(1) L’accueil des Visiteurs du soir par la presse a été étudié par Stéphane Champmartin dans un mémoire de maîtrise soutenu à Paris-III, en 1992. Mes exemples seront empruntés aux articles relevés dans cet ouvrage.
(2) Publié en 1932 aux éditions Payot dans une traduction du hollandais sous le titre Le Déclin du Moyen Âge (titre sous lequel Prévert a donc pu le lire), repris en 1975 sous le titre L’Automne du Moyen Âge.
(3) « Entretiens avec Marcel Carné » par Jean d’Esquelle, Vedettes, 5.12.42.
(4) Pierre Ducrocq, « Les Visiteurs du soir », L’Appel, 10 décembre 1942.
(5) Fabliau publié par les éditions Scheler, Trouvères belges, I, 1876.
(6) J.R., « Le Courrier du cinéma », Les Lettres et les Arts, 31.12.1942.
(7) Simone Mohy, « Les Visiteurs du soir », Le Franciste, 19.12.1942.
(8) Rocheteix, « Un chef-d’œuvre provisoire, Les Visiteurs du soir », La Révolution nationale, 26 décembre 1942.
(9) Marcel Lapierre, « Le film qu’il faut avoir vu : Les Visiteurs du soir. Réalisation de Marcel Carné », L’Atelier, 15.12.1942.
(10) J.R., « Le Courrier du cinéma », Le Journal, 31.12.1942.
(11) Simone Mohy, « Les Visiteurs du soir », Le Franciste, 19.12.1942.
(12) G.L., « Les Visiteurs du soir », Confluences, janvier 1943.
(13) Didier Daix, « Les Visiteurs du soir », Ciné-Mondial, 12.12.1942.
(14) G.B., « On a présenté Les Visiteurs du soir… », Le Journal, 9.12.1942.
(15) Jean Moingt, « Le cinéma. Les Visiteurs du soir, film de Marcel Carné », Demain, 3-10 janvier 1943.
(16) C.R., « Les Visiteurs du soir », Dimanche illustré, 16-22 janvier 1943.
(17) Maurice Rousseau du Gard, « Le cinéma, Les Visiteurs du soir », Voix françaises, 26.2.1943.
(18) On pouvait lire cette lettre pendant l’exposition consacrée à Marcel Carné au musée Montmartre, du 15 janvier au 30 avril 1994.
(19) « La Crosse en l’air », Paroles.
(20) Paroles.