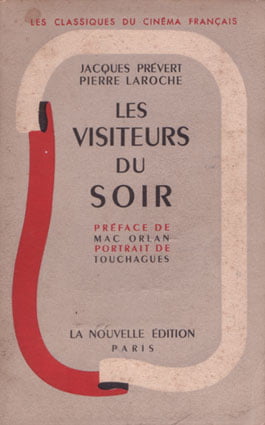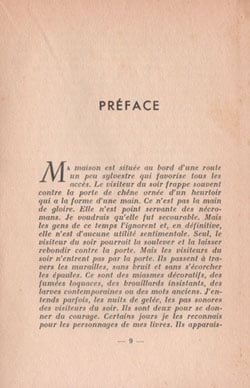LES VISITEURS DU SOIR (1942) par Pierre Mac Orlan
Préface de Mac Orlan à l’édition parue en 1947 du scénario des Visiteurs du soir à La Nouvelle Édition dans la collection « Les Classiques du cinéma français ».
Cette collection a été publiée sous la direction de Colette Johnson et André Salvet.
Entre autres, Mac Orlan était l’auteur du roman Le Quai des Brumes (1927) dont Carné a bien évidemment tiré le classique que nous connaissons avec Jean Gabin et Michèle Morgan en 1938.
Nous n’avons pas réussi à trouver trace d’une réédition de ce texte dans l’œuvre de Mac Orlan. Si quelqu’un a des renseignements à ce sujet, n’hésitez pas à nous contacter.
– Aussi, jusqu’à preuve du contraire, ce texte de Mac Orlan est inédit –
Ma maison est située au bord d’une route un peu sylvestre qui favorise tous les accès. Le visiteur du soir frappe souvent contre la porte de chêne ornée d’un heurtoir qui a la forme d’une main. Ce n’est pas la main de gloire. Elle n’est point servante des nécromans. Je voudrais qu’elle fût secourable. Mais les gens de ce temps l’ignorent et, en définitive, elle n’est d’aucune utilité sentimentale. Seul, le visiteur du soir pourrait la soulever et la laisser rebondir contre la porte.
Mais les visiteurs du soir n’entrent pas par la porte. Ils passent à travers les murailles, sans bruit et sans s’écorcher les épaules. Ce sont des miasmes décoratifs, des fumées loquaces, des brouillards insistants, des larves contemporaines ou des mots anciens. J’entends parfois, les nuits de gelée, les pas sonores des visiteurs du soir. Ils sont deux pour se donner du courage. Certains jours je les reconnais pour les personnages de mes livres. Ils apparaissent afin de me reprocher des imperfections. Le plus souvent ils viennent d’autres contrées littéraires, dont quelques-unes sont encore régies par les lois cruelles, fastueuses et puériles des démonologies conçues par les Pierre de Lancre, Boguet, Bodin et Del Rio. Leur présence se manifeste entre le ricanement désagréable et les gémissements froids. Rien ne sait protéger une demeure contre leur intrusion. Les formules magiques manquent d’efficacité. Au besoin, ces démons se maquillent en bacilles rusés, s’introduisent dans le corps humain et le mortifient lentement. C’est la maladie n° 10 qui succède à la lèpre, aux pestes romantiques et au mal des ardents qui illumine les nuits des estropiés mendiants.
Nés du livre et de l’image, ils se mêlent aux quatre éléments du décor de la vie et des « studios » perfectionnés qui en dépendent. C’est ainsi que chacun de nous compose son film dont le rôle principal est tenu par le visiteur du soir, l’indestructible visiteur du soir habillé à la mode des siècles, ivre de boniments et de promesses inusables. Quand j’aurai dit que ce personnage est noir et blanc, je l’aurai dénoncé, et, ce qui est le plus sérieux, j’aurai livré l’adresse de son domicile de prédilection. Ce démon ne se révèle bien que sur les écrans où l’on projette des films qui ne sont pas tous à son usage. Mais il n’en a cure car c’est une création photographique d’une vérité souvent gênante. L’art cinématographique qui l’anime, et par ainsi nous le rend familier, le couve, le nourrit et l’élève dans la substance même de sa pellicule et des objectifs qui lui donnent une âme, une âme un peu inhumaine qui ne prend ses forces que dans l’ombre des apparences réglementaires de la société. Le fantastique social s’épanouit et se révèle dans cette sorte de métaphysique vulgaire, mais un peu monstrueuse, dont la photographie animée est bonne conductrice.
Une rue, en studio ou d’après nature, est une rue noire et blanche, dont les ombres sont toujours perfides. Le diable habite les rues noires et grises de la photographie mouvante. Le diable doit être considéré comme un mot facile à prononcer, une abréviation qui résume une somme importante d’expériences, le plus souvent lugubres. Ce mot diable, employé par l’art cinématographique, apporte une qualité un peu surréaliste aux objets les moins enclins à dérégler les jeux de l’imagination. Breughel voyait le diable dans un pot de terre ou dans une marmite rustique ; nous l’apercevons maintenant à l’angle d’une rue mal éclairée mais bien photographiée.
Et les mouvements humains projetés sur un écran appartiennent spontanément au monde surnaturel d’un romantisme qui nous apparaît en quelque sorte comme l’image exacte de la vie inconnue de nos propres ombres. Le réalisme de la vie des ombres, c’est l’essence même de la vie cinématographique qui n’est qu’un aspect, maintenant découvert, de notre activité quotidienne, la plus banale comme la plus surprenante. Le diable ne fut toujours qu’une forme de prémonition. Le Grand Bouc, de la lande de Siborro, se révéla le premier des metteurs en scène. Il connaissait déjà la puissance de la lumière quand elle pouvait anéantir les couleurs du prisme pour ne laisser apparaître que le noir absolu de l’éternelle solitude des hommes et des choses sans Dieu.
Les visiteurs du soir sont à mes côtés au moment que j’écris ces lignes. Le gel métaphysique place le village sous la cloche pneumatique. On peut donc écrire que le paysage baigne dans la pureté absolue de la pellicule vierge. Je connais les noms des trois visiteurs, d’apparence médiévale, en cette nuit : ce sont Carné, Jacques Prévert et cette curieuse Arletty vers qui aboutissent toutes les routes imaginaires du fantastique de minuit.
Carné ? Je le connais depuis le jour où il m’écrivit d’Allemagne, quand il était soldat dans les troupes d’occupation, une lettre juvénile qui me touche encore profondément.
Jacques Prévert ? C’est la poésie même des petits détails de la rue adolescente, cette rue tiède comme un organe féminin, un tendre sexe sentimental, dont l’influence ne cesse de rayonner en chansons, ces chansons qui sont les poèmes les plus humains de la gentillesse quotidienne des hommes et des filles bien élevées selon les lois de la vie.
Arletty vêtue en page-baladin les accompagne. Elle soulève le heurtoir de la porte de ce château tout neuf qui, dans quelques années, deviendra la maison Roderick Usher. Qui pourrait résister à ce geste ? Arletty gémit devant cette porte fortifiée ; elle balbutie en jobelin les mots de la mauvaise chance qui ouvrent toutes les demeures. Qu’importe si le cœur des amants est indéréglable. Le diable, qui est un amoureux plein de talent, est toujours battu par ses propres dons.
Prévert et Arletty sont nés de la tendresse classique de la rue pour le plaisir des amoureux. Villon dans les bosquets de Robinson, ou mieux encore Catulle, ce sont l’un et l’autre Prévert lisant ses poèmes dans les étuves de la rue de la Juiverie ou dans une auberge enfouie sous les pampres de Frascati. Carné mène le jeu. C’est un homme extrêmement curieux, une des personnalités les plus puissantes de la vie cinématographique, c’est-à-dire du monde noir et blanc du désespoir, de la malice et de l’inquiétude sociale. Il sait reconnaître le mot diable, quel que soit le maquillage dont il se protège contre l’hostilité de ses plus fidèles clients.
Dans la rue noire et blanche de la vie nocturne, celle de la civilisation de minuit ou du petit jour, le diable prend la voix des impubères sans logis, celle des blêmes imbéciles aux mains tachées de sang, celle des filles sans bordels. Les braves gens ivres de refoulements, les faux Landru à barbe noire, le chef coiffé d’un chapeau melon honorable, l’attendent au coin des ruelles et le suivent furtivement pour se damner à l’insu de leur chef de bureau.
Ces spectacles de la cinématographie intime sont vieux comme le monde.
Le premier film fut un film d’inquiétude sociale. Adam et Eve, les vedettes, se hissaient sur la pointe des pieds pour regarder, par le trou de la serrure de la porte du travail, le pittoresque clandestin de leur future condition de salariés.
En dirigeant ses personnages de livre d’heures vers les hautes salles du château de Tristan et Yseult, Carné regarda par le trou de la serrure. Il entendit les ricanements de son jongleur, vit le page décroiser ses jambes et, pour finir, il entendit battre les cœurs dans l’éternelle absolution. Le mal seul comporte une si haute morale. Elle est d’intelligence catholique et la plus humaine qu’il soit dans toutes les mythologies. L’humanité se damne pour connaître les blandices de l’absolution.
Carné et Prévert ont su former une association d’une distinction parfaite dans toutes les nuances de la poésie. Car la poésie doit être l’âme de la cinématographie considérée comme un art, peut-être même le seul art expressionniste de ce temps. La littérature trahit les fantômes. Le cinéma ne peut renier leur présence. C’est la révélation artistique et romanesque de ce fantastique quotidien qui confère, par des moyens détournés, une sorte de poésie à des cartes d’alimentation même périmées.
Jusqu’à ce que la dissociation de la matière devienne un résultat définitif, le film nous accoutume, petit à petit, à ce dénouement ; car, dans ces images noires et blanches, la mort est toujours en mouvement. L’art de la photographie est un art mortuaire et quand elle devient mobile, un art de résurrection des petits faits de l’année, de la semaine, du jour ou de la nuit. Tout metteur en scène est un nécroman, souvent de mauvaise humeur. Toutes les images vivantes qu’il inspire meurent au moment qu’elles apparaissent sur l’écran.
Et puis, l’obscurité complète faite dans la salle et les spectateurs dans leur lit, il reste l’écran de la pensée, cet écran de la pensée, criblé de trous lumineux, où toutes les menaces des angusties nocturnes s’émancipent pour transposer les influences littéraires de la journée. C’est l’heure que les visiteurs du soir choisissent pour interroger et se confesser.
La puissance lyrique d’un grand film se dégage de ces entretiens inavoués.
Pour faire suite à ces quelques notes écrites en marge d’une œuvre littéraire et cinématographique importante, vous lirez le texte du scénario de Jacques Prévert et de Pierre Laroche. Il appartient à Carné d’avoir apporté le feu de Prométhée dans ce fabliau qui pourrait être vécu et joué dans les costumes de notre temps.
C’est un texte humain, comme une chanson. Il est flexible. Il peut permettre bien des transpositions. En suivant les deux trouvères des rues et des routes, je peux les entendre chanter dans tous les carrefours de Paris dont ma mémoire garde l’empreinte. Ils chantent : L’amour est passé près de vous…, comme en 1432, par exemple, Villon, assis sous un arbre devant l’église de Saint-Benoît-le-Bétourné, chantait — à moins que ce ne fut Jacques Prévert — la complainte des gentils enfants d’Aubervilliers. Ainsi les choses importantes de la vie se mêlent et s’entraident jusqu’à la confusion des dates par quoi l’histoire devient un enseignement véritablement humain.
Celte histoire nettement fantastique dont vous pourrez, par la suite, méditer le déroulement, offre une image exacte de la condition humaine. Lorsque Carné et Prévert, et peu d’autres, auront pu sélectionner une grande partie de leur public, la rue, ses démons, ses angélolâtries dédiées aux enfants mystérieux qui jouent à la marelle, s’installeront définitivement dans cette vision cinématographique de la société : cette vision parmi les plus riches dans l’intelligence des hommes et des choses, parmi les plus habiles à découvrir les larves qui se lient à la conquête du pain et de l’amour.
Pierre Mac Orlan