LE JOUR SE LÈVE (1939)
raconté par R. Laude et R. Corlieu dans Le Film complet n°2301 du 18 août 1939
Ce numéro du Film complet est bien évidemment épuisé et très rare.
Il s’agit de la version romancée du scénario écrit par Jacques Viot et raconté par R. Laude et R. Corlieu, agrémenté de quelques belles photographies du film.
Le jour se lève raconté par R. Laude et R. Corlieu
Scénario de Jacques VIOT — Dialogue de Jacques PRÉVERT
D’après le film de Marcel CARNÉ
Le crépuscule tombait sur un jour triste. Des heures durant, de grands nuages gris, tout doucement poussés par le vent d’est, avaient défilé dans le ciel en troupeaux confus. Puis le soleil, lassé d’une inutile veille, avait sombré à l’horizon.
Surprise elle aussi par la chute brutale du jour, la place Graillot avait sombré dans la torpeur. Le soleil la laissait triste, mais le soir la rendait sinistre, avec ses pavés hostiles et gluants, ses rigoles douteuses au ras des trottoirs étroits, ses grands murs noirs et sales.
La maison ouvrière du haut de ses quatre étages trônait sur la face est, imposant à la misère de ce quartier proche de la banlieue d’Amiens l’étalage minutieux de ses fenêtres en série.
Passé le seuil, les marches s’enrubannaient autour de la rampe, luisante du glissement des paumes. Quatre paliers offraient, face à la cage de l’escalier, une porte centrale. À droite et à gauche, à chaque étage, des couloirs se perdaient dans l’ombre.
Le drame allait habiter le dernier étage…
Ce fut d’abord, au quatrième palier, filtrée au travers de la porte, la rumeur étouffée de la discussion. Indistinctes d’abord, les voix se haussaient maintenant, croissant de ton et de violence. Derrière la porte fermée, il y eut sur l’instant le gros éclat de rire qui sonnait faux…
– Rigolade, alors ! C’est amusant comme les gens simples se font des idées compliquées sur les femmes !
Le rire reprit… on le sentait forcé jusqu’à la bravade et presque jusqu’au défi.
– Tais-toi ! Tais-toi ! hacha le crescendo incessant d’une réplique à bout de nerfs.
– Peut-être qu’elle t’aime, bien sûr ! mais moi, je lui plais ! Évidemment, c’est pas l’amour… de plaire… Ça vaut mieux parfois.
– Tais-toi ! ordonna encore la voix que la menace faisait trembler.
– Ah j’aurais eu tort de me gêner… et pourquoi ça ? J’aime bien la jeunesse… et puis c’est si facile… Tu souffres, hein et peut-être veux-tu savoir ? Alors voici, c’est simple… on ouvre une porte, on la referme et on éteint la lumière… et puis tiens, écoute encore…
Ce fut bien autre chose alors qu’on entendit : le martèlement d’une canne d’abord. Celle de l’aveugle qui rentrait au logis, comme chaque soir, à pareille heure, la nuit tombée. Cela, oui… et puis le claquement insolite, effrayant d’une détonation… Alors, et comme si la maison tout entière avait prêté l’oreille, il y eut le vide total d’un grand silence… puis une phrase surgit, que l’on sentait issue d’une bouche déjà crispée, au delà d’une gorge que la douleur serrait…
– Te voilà bien avancé, maintenant.
– Et toi ?
Les deux derniers mots jaillirent de derrière la porte sur le passage de l’homme frappé à mort. Un instant une main griffa le bois du chambranle… l’autre chercha sous l’étoffe des vêtements la plaie de la chair trouée. Un fracas nouveau ébranla le palier… celui de la porte refermée par la main meurtrière. L’homme assassiné fit deux pas vers l’escalier. Le réflexe des nerfs, vestige d’une volonté déjà morte, poussa le corps en avant, l’adossa à la rampe, puis, fauché soudain par la mort, il tomba lourdement.
Ce fut l’aveugle qui, à l’étage au-dessous, le reçut sous sa canne. Son instinct confus pressentit tout le drame. Il interrogea :
– Qu’est-ce qu’il y a ? Quelqu’un est tombé !
À tous les étages, au fond des couloirs, les portes s’ouvraient maintenant. Du café en face, on était venu, attiré par les clameurs et les cris.
– Faut aller chercher la police, conseilla quelqu’un.
Une seconde, il y eut une reculade instinctive, tandis que les regards se portaient, à ras du palier du quatrième étage, vers la porte silencieuse et fermée. Sitôt prévenue, la police arrivait déjà. Deux agents du poste proche, écartant le groupe de curieux qui stationnaient sur le trottoir, pénétrèrent dans l’immeuble. Ils procédèrent aux premières constatations, en présence des concierges et de quelques hommes.
– Ainsi… dit l’agent Beloux, cet homme-là, le mort, personne ne le connaît ?
– Je ne l’avais jamais vu…, réaffirma le concierge Bastien.
– Et à votre avis, qui l’a tué ?
– Ah ! ça… je n’en sais rien.
– Enfin, il est tombé dans l’escalier du quatrième étage. Sur le palier, il y a bien une porte, en face ?
– Ben oui… celle de Raimbaud.
– Et il était chez lui, ce Raimbaud ?
– Ça pour sûr, intervint madame Bastien, je l’ai vu rentrer.
L’agent se tourna vers son collègue :
– Faut aller voir ! on monte.
Tandis que le concierge demeurait auprès du cadavre, les locataires qui étaient là s’en furent derrière les agents. La nouvelle de l’arrivée de la police s’était répandue dans l’immeuble. Sur tout le pourtour de la rampe, à hauteur des étages, des têtes levées regardaient curieusement. Les deux hommes étaient arrivés devant la porte derrière laquelle rien ne s’entendait ni ne bougeait.
– Police ! Ouvrez ! ordonna l’agent Beloux en frappant le bois.
La cage de l’escalier et la maison tout entière sombrèrent dans le silence de sorte que, même au second étage, on entendit la réponse brutale et nette de l’homme :
– F…-moi la paix !
– De ce coup-là c’est bien lui ! souffla quelqu’un. La voix de Beloux reprit plus fortement :
– Police ! ouvrez immédiatement…
L’agent ne put achever. De nouveau la voix résolue de l’homme lançait :
– Non, je n’ouvrirai pas. J’ai pas à vous voir ! Laissez-moi… je veux qu’on me f… la paix !
– Alors, vous allez ouvrir ? réitéra l’agent en cognant la porte de son poing fermé.
Un flot de colère parut alors emporter l’homme :
– Barrez-vous ! Vous allez vous barrer ? Oui ?…
Pressentiment, ou instinct, si précise était la menace, que les deux agents eurent un geste pour s’effacer. Il était temps : une détonation venait de claquer, suivie d’une autre, d’une autre encore… Coup sur coup, trois balles avaient percé la porte. Cette fois l’affaire devenait sérieuse. Entraînant en hâte son collègue, l’agent Beloux regagna l’escalier où régnait la débâcle.
Derrière la porte close François Raimbaud, le revolver au poing, écoutait décroître dans l’immeuble la rumeur de la bousculade effrayée. Rien ne se lisait sur son masque tragique que la volonté tenace d’une bête déterminée à ne pas laisser forcer son repaire. Il entrouvrit lentement sa porte, huma l’air suspect, attentif aux bruits, l’œil en éveil, prêt à bondir, à fuir ou à tuer. Rassuré, il fit deux pas sur le palier désert, se pencha sur la cage de l’escalier. Tout l’immeuble était silencieux. À peine percevait-on en bas, au bout de la spirale obscure, les silhouettes des agents qui rejoignaient le rez-de-chaussée. Penché sur la rampe, il hurla :
– Vous avez compris ? Je veux être tout seul.
Aucune autre réponse ne lui parvint que l’écho de ses propres mots ; il regagna sa chambre en deux bonds, en referma la porte à toute volée, tandis que la clef claquait à deux reprises.
François Raimbaud avait fait quelques pas dans sa chambre. C’était une assez grande pièce, carrelée de rouge et tapissée de gris clair. La fenêtre plongeait sur la place. Une lourde et grosse armoire normande s’adossait au mur, près de la porte. Puis venaient le lit bas et sa table de nuit, la cheminée enfin, surmontée d’une grande glace, dans laquelle se reflétait une lampe électrique coiffée d’un abat-jour. Piquée dans le papier du mur, contre le cadre de la glace, une petite broche médaillon, en mosaïque multicolore, jetait dans cet intérieur modeste et terne d’ouvrier une note insolite. Une table ronde occupait le centre de la pièce, sous l’aplomb d’une ampoule de plafond.
Un instant l’homme traqué demeura immobile. Le masque était détendu, le regard était devenu presque normal. À peine l’indécision des gestes marquait-elle que la pensée demeurait accrochée ailleurs.
François déposa l’arme sur la table, puis il prit dans un étui une cigarette qu’il alluma. Ses yeux coururent du réveille-matin dont le tic-tac emplissait la chambre, à un ours en peluche accroupi sur le marbre de la cheminée. Il alla vers la glace. se pencha sur sa propre image dont le miroir lui envoyait le reflet apaisé. Ses mains appliquées aux tempes lissèrent les cheveux en mèches ordonnées, puis, désœuvré soudain, il vint à la fenêtre et regarda le ciel.
Une centaine de curieux stationnaient maintenant devant la maison et sur la place. La rumeur du drame avait vite rejoint les rues adjacentes. Les mieux informés reprenaient, au bénéfice des nouveaux venus, les circonstances du drame. En face, au café de l’hôtel du Commerce, l’animation y était à son comble et les commentaires s’y muaient en tournées.
D’une rue voisine débouchaient à présent huit agents conduits par un brigadier. Ils se dirigèrent vers la maison, suivis des regards de tous les curieux qui s’écartaient sur leur passage. Quatre hommes restèrent sur le trottoir pour le service d’ordre, les quatre autres entrèrent à la suite de leur brigadier. Pour la vingtième fois, la mère Bastien narrait les circonstances du drame, mais cette fois, au brigadier.
– Enfin, quel genre d’homme était-ce, ce François ? Un violent ? Un alcoolique ? interrogea le brigadier.
Outrée de l’accusation, la concierge eut un sursaut :
– Un alcoolique ? M. François ? Mais il n’y a pas meilleur que lui dans la maison, pas plus tranquille…
Le commissaire arriva suivi de son secrétaire.
– Allons, dit-il brièvement, assez parlé, il n’y a qu’à monter.
Dehors, sur le trottoir, l’intérêt du drame ne tarda pas à subir un renouveau. Ce fut d’abord l’arrivée de l’ambulance, puis l’enlèvement du cadavre. La voiture sanitaire s’éloignait à peine qu’un car de police surgissait soudain.
On entrait dans le café en face pour boire un verre, puis on en sortait à chaque nouvel incident. Par la porte ouverte, des échos de la radio s’en venaient aux oreilles. Derrière un pan de vitre, indifférents au tumulte, deux joueurs de jacquet continuaient leur partie.
Là-haut, dans la chambre du quatrième étage, François Raimbaud marche de long en large, insouciant de cette foule qui s’assemble pour la curée, de cet assaut dont l’implacable chaîne se trame autour de lui. S’il allait de son pas lassé qu’aucune volonté ne guide plus, jusqu’à la fenêtre close, il pourrait sans doute, au-delà des vitres, voir se profiler sur le toit d’en face, des silhouettes d’hommes.
En bas, la foule anxieuse attend. Du bras tendu, on se montre la fenêtre éclairée, la seule… celle de Raimbaud, l’homme tranquille… ainsi disait la mère Bastien. Sur les toits voisins, les agents rampent au long de tuiles. Les mousquetons sont dans les mains, chaque tireur est à sa place.
Et voici que François lève, vers la glace qui se trouve derrière lui, un regard étonné. Quelque chose est entré dans la chambre qui, crevant la vitre, est venu s’écraser là, avec un bruit sec. Dehors, quelque part, une détonation a brisé le silence, et Raimbaud contemple, le regard perdu, ce trou étoilé qui marque sur le miroir la trace du projectile. Et voici qu’une deuxième balle, suivie d’une troisième, a claqué dans la vitre… cinq trous maintenant crèvent à mi-hauteur du mur la cible brillante… C’est une pluie de projectiles à présent et l’un d’eux fait un mort. Atteint par une balle, le petit ours de peluche a roulé dans la chambre…
Et voici qu’une dernière balle vient de briser la lampe. Du coup, la chambre est plongée dans la nuit. François cherche vers la fenêtre la tache grise des vitres découpées sur le ciel sombre. D’un pas d’automate, il a marché vers ce ciel. La tête penchée, il regarde à présent au travers du cadre hérissé de dangereux éclats de vitres fracassées… Il regarde, mais voit-il vraiment ?
En bas, pourtant, la place Graillot est noire de monde, mais François Raimbaud ne voit rien de tout cela. À ses yeux, à ses oreilles, la place Graillot est calme et vide. Il n’est point de drame, il n’est pas de nuit. De l’ombre et du sang, tout n’est qu’apparence. Tout à l’heure, au sortir de ce cauchemar qui assassine et hurle aux portes, qui tracasse vitres et glaces et tue la lumière des lampes… Oui, tout à l’heure, la clarté reviendra. Le jour se lèvera et François s’en ira dans le matin calme… comme autrefois… comme hier…
Autrefois ! ah oui ! que la vie était belle !
Aux premières lueurs de l’aube, par la fenêtre ouverte, toute la joie du ciel entrait dans la chambre et François se levait alors avec le jour. Il s’habillait en sifflotant, puis les mains dans les poches, la cigarette aux lèvres et la casquette en arrière, il descendait. Il gagnait en vélo, sans se hâter, le boulevard extérieur en bordure duquel s’élevait l’usine, presque en plein champ.
François était au sablage… un dur métier qui brûlait les yeux, desséchait les poumons et mordait les chairs. Il fallait travailler sous le casque, avec des bottes, avec des gants ; ennemi tenace, le sable, jamais battu, attaquait toujours. Souvent il triomphait, à la longue, car sa revanche savait attendre. Fantastiques robots, scaphandriers de l’usine, les ouvriers sableurs essaimaient au fil des jours de dures heures de travail.
Françoise… si étonnante que soit la chose, c’était pourtant à l’atelier de sablage qu’elle lui était apparue un jour…
Stupéfait, il avait considéré un instant la surprenante et gracieuse apparition surgie à quelques pas de lui. Arrêtant son travail, Il avait soulevé son casque, souriant à la jeune fille interdite, dont les regards allaient dans ce décor fantasque, des autres ouvriers, encore casqués, au visage de François que voilait la poussière hostile.
Un bon sourire avait détendu les traits du jeune homme et il étendit la main vers le pot d’azalées qu’elle portait au creux de son bras.
– Tiens des fleurs… Ça c’est gentil ! C’est pour ma fête ?
D’abord interloquée, elle s’était vite ressaisie et elle riposta, rieuse :
– Alors, vous vous appelez François ?
– T’as trouvé ça toute seule, toi ?
– Oh ! sans effort, vous savez, car je m’appelle Françoise, moi aussi.
– Et les fleurs, c’est pour qui ?
Une fois encore le rire joyeux tinta, relevant les lèvres sur les dents éclatantes :
– Oh ! c’est pas pour vous ! Je venais les livrer et je me suis perdue dans l’usine. Mme Legardier, vous connaissez ?
– Mme Legardier… je comprends que je la connais… C’est la femme du sous-directeur… Elle ne vient jamais ici, tu peux me croire… jamais…
Il entraîna la jeune fille jusqu’à la fenêtre, après qu’elle eut déposé son pot de fleurs sur une table.
– Tu vois le grand hangar…, expliqua-t-il, eh bien tu tournes à gauche… tu suis tout droit et au bout, il y a un jardin… la maison est derrière.
N’ayant plus rien à lui dire, François revint à son travail, mais avant jeté un regard vers la porte, il la vit sur le seuil qui le regardait. Il retourna vers elle et lui dit :
– Alors, tu travailles par ici ?
– Oui.
– Et tu demeures avec tes parents ?
– Non, je demeure chez les Briquet, répondit-elle en baissant la tête, gênée. J’ai pas de parents. Je suis de l’Assistance.
Une expression d’amusement parut sur le visage de François tandis qu’il s’écriait :
– Ça alors, moi aussi, je suis de l’Assistance… c’est marrant ! On s’appelle pareil, on est de la même famille puisqu’on n’en a pas, ni l’un ni l’autre… et puis, on se rencontre aujourd’hui… Juste le jour de notre fête…
Mais le souci de l’heure la reprenait soudain, et elle s’écria :
– Excusez-moi, il faut que je me sauve.
– Est-ce qu’on se reverra ? demanda François.
Ils s’étaient revus souvent, dans les bosquets du square de la Couronne où elle l’attendait le soir à la sortie de l’usine ; il la reconduisait ensuite jusque chez les Briquet.
Quand elle ne pouvait sortir, il allait causer avec elle quelques instants le long de la haie du jardin. Il sifflait pour l’appeler. Un soir, le doigt sur les lèvres, elle lui fit signe d’entrer. Dans le noir, il avait marché sur ses traces, jusqu’à l’entrée de la cuisine située derrière la maison. Elle referma la porte derrière lui, et très simplement, tendit son visage à ses baisers, puis, s’écartant de lui, elle demanda :
– À quoi pensez-vous quand vous m’embrassez ?
L’art subtil des nuances et des mots n’était pas le premier talent de Raimbaud. La réponse jaillit brusque et franche :
– Moi ? À quoi je pense ? Tu le sais bien… Alors, pourquoi le demandes-tu ?
Il essayait de l’attirer contre lui, mais elle se dégagea lentement sans répondre. Une expression indéfinissable de regret, de mélancolie, de tendresse aussi passait sur son visage. Surpris de son silence et pensant qu’il n’avait pas assez dit encore, il murmura à son oreille tous les mots simples qui lui venaient du cœur.
– C’est vrai, Françoise, dans le fond, tu sais, je me marierais bien avec toi.
Un instant, elle scruta le visage de Raimbaud… Une certaine dureté marquait sur les traits du jeune homme l’intensité du vœu exprimé. Entre eux, un silence s’établit, coupé seulement par le tic-tac monotone d’un réveil placé sur la table de nuit dans la chambre à coucher dont la porte était restée entrouverte. Un mouvement de curiosité poussa François vers la chambre. Quelques cartes postales avaient été glissées le long de la glace de la cheminée ainsi qu’une série de « Photomaton » dans laquelle il venait de se reconnaître.
Un petit ours en peluche, le cou ceint d’un ruban rouge, était posé sur la cheminée.
– C’est Balop… mon ours quand j’étais petite, expliqua Françoise.
– Il a une bonne tête.
– Oui, il vous ressemble, approuva-t-elle en riant.
François faisait face à la glace. Il éleva Balop à la hauteur de son visage, tandis qu’elle appréciait :
– Regardez si ce n’est pas vrai. Il est comme vous. Il a un œil gai et l’autre qui est un tout petit peu triste.
– Comment que tu t’es aperçue de ça ? demanda-t-il en riant.
– Parce que je vous ai regardé, fit-elle simplement.
Il la considéra avec curiosité, cherchant le mot par quoi il eût voulu manifester sa joie. N’ayant pas trouvé, il se contenta d’un à-peu-près dans lequel il essayait de faire tenir beaucoup de choses.
– T’es marrante…
Les cartes postales retinrent son attention. Il déchiffra les provenances en commentant bruyamment :
– Ah ça, mais tu les collectionnes ! Et de partout encore… Monte-Carlo, Villefranche-sur-Mer… Nice, la Promenade des Anglais… La Promenade des Anglais, paraît que c’est tout ce qu’il y a de plus chouette.
Un éclat de rire moqueur ponctua son appréciation, mais cette dernière n’était pas du goût de Françoise et elle remarqua maussade :
– Pourquoi riez-vous ? C’est pourtant beau la Provence, vous savez…
– Tu y as été ?
– Non… mais on m’a raconté… alors, je connais presque. Il y a des grands rochers rouges et puis la mer… la mer avec des casinos tout autour… Et puis là-bas, il y a toujours du soleil, et puis des fleurs, même en hiver… des mimosas…
Il l’écoutait, mécontent. Son âme simple ne concevait que les bonheurs accessibles.
– Tiens, tu me fais rigoler avec tes mimosas… La Riviera, les mimosas, tout ça c’est du rêve… de la musique.
– Du rêve, de la musique… oui, peut-être, mais il y a des jours où c’est tellement triste ici…
D’un mouvement instinctif de tendresse, François l’avait serrée contre lui, pour la consoler, la rassurer :
– Bien sûr, c’est triste parce que tu vis toute seule… mais si tu vivais avec moi… Tu verras, quand j’aurai des ronds, je t’achèterai un vélo, et puis, dès qu’il fera beau… tiens, à Pâques, on ira chercher des lilas…
Des lilas ! Fier de son idée, François regardait la jeune fille. De fait, un sourire heureux détendait son visage, et elle répéta avec une nuance de tendresse :
– Oh oui ! des lilas !
Elle alla prendre sur la cheminée une broche qu’elle voulut épingler au col de sa blouse, mais un cri lui échappa presque aussitôt, tandis qu’elle regardait, consternée, son doigt où perlait une goutte de sang.
– C’est rien ! consola-t-il doucement, tu vas voir.
Il lui prit le doigt qu’il approcha de ses lèvres, puis, brusquement il attira la jeune fille contre lui. L’étreinte ayant réveillé en lui le désir, il murmura la voix changée :
– Écoute… tu veux que je reste ? Je m’en irai de bonne heure…
– Non… pas ce soir, fit-elle en détournant la tête : je dois sortir… j’ai rendez-vous.
La réponse était tellement inattendue qu’il resta un instant muet, puis il remarqua aigrement :
– Alors, tu sors comme ça le soir ? Et on te laisse faire ?
Elle ne parut d’abord pas sentir la nuance irritée du reproche. Elle voulut expliquer avec enjouement :
– Oh ! Tout le monde dort… alors je peux m’en aller… Vous n’allez pas être jaloux, tout de même !
Il alluma une cigarette, fâché contre elle et contre lui-même. Affectant l’indifférence, il énonça avec une apparente tranquillité :
– Jaloux… mais tu es libre… moi aussi, je suis libre… alors, salut. Au revoir et à bientôt.
Il rafla sur la cheminée le petit ours de peluche :
– Qui se ressemble s’assemble. Tiens, je l’emmène celui-là. Ça m’ennuierait de partir les mains vides.
Passant devant Françoise, il sortit sans se retourner. Raimbaud se retrouva sur le chemin. Il hésita un instant. À gauche de la maison, s’ouvrait un sentier étroit. À peine avait-il eu le temps de s’y cacher, qu’il vit apparaître Françoise. Le cœur de François battit à grands coups dans sa poitrine, quand elle passa devant lui sans le voir. Dès qu’elle eut franchi le tournant du viaduc, il s’élança à sa suite.
« Où pouvait-elle aller ainsi ? » pensait Raimbaud.
De Françoise, il savait peu en somme. Peu communicative, elle écoutait plus qu’elle ne parlait, il ignorait presque tout d’elle.
Il marchait à peu de distance d’elle et pas une fois, elle ne se retourna. Elle gagna le centre de la ville, et la stupéfaction de François fut sans borne, quand il la vit pénétrer sous un porche éclairé. C’était l’entrée d’une salle de café-concert. Obscurément peiné, il considérait l’étrange lieu de rendez-vous choisi par la jeune fille, et pénétra à sa suite dans la salle. Une petite scène en occupait le fond dans un décor de rideaux fanés. Malgré quelques vides dans les derniers rangs, le spectacle paraissait faire recette. Sur l’estrade, une chanteuse de genre, drapée dans une cape tricolore, achevait un refrain patriotique. Une bordée d’applaudissements marqua la fin de la chanson et le tombé du rideau, en même temps que la lumière, jaillie des rampes, ramenait la clarté.
Au premier rang, Françoise était assise sur un strapontin. Raimbaud la voyait de profil et, les yeux fixés sur le rideau rouge qui masquait la scène, elle ne paraissait se soucier que de la suite du spectacle. Cependant, le rideau se levait, découvrant cinq petits chiens rigoureusement alignés sur cinq petits tabourets. Un redoublement de l’orchestre marqua l’entrée d’un monsieur en habit, culotté court, coiffé d’un haut-de-forme. Désinvolte et plaisant, il se pencha sur la rampe, saluant le public qui applaudissait à tout rompre. Françoise aussi battait des mains et Raimbaud qui ne la quittait pas du regard se pencha, attentif soudain. L’instant d’une seconde, il lui parut qu’elle avait un sourire pour le dresseur de chiens.
Sur la scène cependant, répondant à l’appel de l’artiste, une femme venait d’entrer à son tour, vêtue d’une robe pailletée de gommeuse qui se terminait court sur des jambes gainées de soie jusqu’aux cuisses. Elle prit le chapeau et les gants de l’artiste et se retira aussitôt.
Raimbaud suivait distraitement l’exhibition. Accoudé au bar, son verre intact derrière lui, il ne perdait pas des yeux le profil de Françoise. Le barman, qui s’ennuyait tout seul derrière son comptoir, commentait la scène et donnait son opinion tout haut :
– Il est tout ce qu’il y a de fortiche, ce Valentin. Comme dresseur, on ne fait pas mieux. Il est déjà passé ici, il y a trois mois… Clara, sa partenaire est pas mal non plus… Tiens, la voilà justement.
La porte donnant sur les coulisses venait en effet de s’ouvrir. La compagne de Valentin, un manteau jeté sur son costume de gommeuse, remontait la salle ; elle vint s’accouder au bar. Ayant examiné ce grand garçon taciturne qui en était l’unique client, elle commença à monologuer :
– Mais c’est beau comme tout… Surtout d’ici avec le recul… Ça vaut le déplacement. Vous comprenez, tous les soirs à côté de lui, on ne peut pas se rendre compte. C’est qu’il est merveilleux ! Non mais, regardez-moi ça.
L’excès de ses louanges fut vite tempéré par des considérations moins chaleureuses.
– Ah ! la vache ! déclara-t-elle sobrement. Ah ! oui… les femmes sont bien folles… Ça, on peut le dire… Et moi, je suis la reine…
Lassée de parler dans le vide et désespérant d’attirer par des moyens aussi indirects l’attention de ce taciturne dont le mutisme commençait à l’énerver, elle l’interpella :
– Non… mais vous avouerez tout de même, vous… qu’il faut avoir de l’eau dans le gaz et des papillons dans le compteur pour être restée pendant trois ans avec un type pareil.
L’effet qu’elle avait escompté se produisit, cette fois, et François, dévisageant la jeune femme, appréciait à son tour :
– Écoutez, vous êtes bien gentille, mais vous y allez un peu fort. Quand vous aurez fini de faire le ménage, vous me le direz.
– Le ménage ? répéta Clara interloquée.
– Parfaitement ! vous arrivez là, vous videz vos tiroirs, vous battez vos tapis… Je ne vous ai rien raconté, moi. Pourquoi me racontez-vous votre vie ?
– Faut pas m’en vouloir… C’était histoire de ne pas causer toute seule. Ce soir, je suis tellement heureuse vous pouvez pas savoir… La liberté… c’est pas rien… C’est égal, vous n’êtes pas aimable, tout de même.
Tant d’insistance ne devait pas être dépensée en vain. Vaguement flatté de l’intérêt qui lui était marqué, il détaillait avec plaisir les yeux brillants, les lèvres charnues, les épaules dévêtues et le profil révélateur de la robe pailletée.
– Oui, c’est formidable, conclut Clara, ce qu’il cause bien cet homme-là ! Il a une façon de remuer les mains en parlant, de bomber le torse ou de tourner la tête… Il peut raconter n’importe quoi et tout de suite on croit que c’est arrivé… Tenez, la Côte d’Azur, par exemple, il n’a qu’à en parler, on y est…
La Côte d’Azur… les mots venaient d’accrocher Raimbaud. Il leva la tête et soudain il crut voir le cabotin adresser un sourire à la jeune fille. Il ne perdit plus un geste de Valentin jusqu’à la fin de la scène. Le rideau retombait dans le vacarme de l’orchestre, parmi les derniers bravos. Il vit Françoise se lever, se diriger vers la porte des coulisses et disparaître. Il demeura atterré sans bouger, jusqu’à ce que la voix de Clara le tirât de son immobilité :
– Ben qu’est-ce qui vous prend ? Qu’est-ce que vous avez ?
– Rien… rien…
Il vida d’un trait son verre. Que lui importait après tout cette Françoise. Il avait bien tort de s’affliger. Une de perdue, dix de retrouvées, dont la première n’était pas loin. Oublier et vite… Cette Clara l’y aiderait ? Pourquoi pas ?
– Vous devriez me dire quelque chose de gentil, quelque chose de tendre, dit-elle en se frottant contre lui.
– Mais je ne demande pas mieux, répliqua-t-il en riant. Que veux-tu que je te dise ? Que je t’aime ?
– Non merci… je t’en dispense. J’en ai ma claque des hommes qui parlent d’amour. C’est vrai ça, tu sais, ils en parlent tellement qu’ils oublient de le faire…
La porte donnant sur les coulisses s’était ouverte pour livrer passage à Françoise qu’escortait le dresseur de chiens. François détourna la tête pour ne pas être vu. Elle passa près de lui sans le reconnaître. La présence de Clara, appuyée au comptoir, en compagnie d’un homme, n’avait pas échappé à Valentin. Il ne s’arrêta cependant pas. Clara n’avait rien répondu, le visage figé dans un mutisme souriant. François, n’y tenant plus, se leva pour sortir. Clara comprit qu’elle ne le reverrait plus et le retint par le bras :
– Qu’est-ce que vous faites ? Vous n’allez pas m’abandonner maintenant.
Un instant, il demeura hésitant ; la porte s’ouvrit tout à coup et Valentin parut seul. De son allure désinvolte, il gagnait le bar et interpellait Clara :
– Écoute ! les plaisanteries, j’aime bien ça, mais à condition que ce soit moi qui plaisante. Me laisser tomber en plein travail, comme tu l’as fait…
Épanouie et triomphante, elle le nargua de la voix et du sourire :
– En plein travail… tu me fais rire… Il n’y a plus de travail, et plus rien du tout. C’est fini le tandem… je reprends mes pédales… as-tu compris ?
La violence de la riposte parut le surprendre. Un instant, il dévisagea Clara, puis ses regards se portèrent sur François qui avait écouté l’algarade. Celui-ci intervint alors, très calme, mais décidé au pire s’il le fallait :
– Eh là ! Eh ! doucement, Madame est avec moi !
– Momentanément ! rectifia Valentin, méprisant.
– De quoi… de quoi ? se récria Clara. Et où prends-tu ça ? On est ensemble pour la vie… pas vrai ?
Elle éclata de rire de ne pouvoir pas même jeter le prénom de son compagnon au bout de sa phrase. Elle ne s’embarrassa pas pour si peu !
– Oui ! pour la vie… Comment vous appelez-vous ? Moi, je m’appelle Clara.
Valentin parut faire un effort sur lui-même et son visage blêmit :
– Allons, viens, c’est ridicule tout cela !
– Ridicule, ridicule…, martela François le visage soudain durci : tu vois donc pas que c’est toi qui es ridicule ?
Un moment, Valentin chercha sa réponse. L’insulte et la menace avaient fait monter à son front une rougeur subite. Ses yeux avaient soudain une curieuse mobilité. Mais il prit tout à coup son parti de l’événement, et tournant brusquement les talons, avec un geste méprisant de la main, il s’éloigna vers la sortie.
Comme au sortir d’un cauchemar, François Raimbaud ouvrit les paupières, passa sa main sur son front fiévreux, lassé par l’insomnie.
Une allumette encore grilla le bout d’une cigarette et François, allant jusqu’au commutateur, alluma la lampe du plafond dont la lumière livide livra le désordre de la pièce et la meurtrissure brutale des balles. Au pied de la cheminée, il ramassa quelque chose : c’était le petit ours en peluche. La balle l’avait frappé à la tête, faisant jaillir l’œil. Une touffe de paille crevait l’étoffe et le défigurait. Il se souvenait du soir où, pour la première fois, il avait tenu Balop dans sa main. Un pauvre rire navrant lui vint à la gorge. Tout était bien fini, hélas ! de lui-même et de Balop.
Dans les coulisses du drame, l’animation battait son plein. La place grouillait de monde et la nuit, loin de chasser les curieux, avait attiré de nouveaux oisifs. Parfois des renforts d’agents venaient relever leurs camarades. La fusillade du début de l’action avait suscité maints commentaires défavorables. François avait tué et sa rébellion le mettait hors la loi. Un peu plus tard, il avait tiré sur les agents… Pourtant ces actes, aux yeux de beaucoup, ne justifiaient pas l’énergique intervention des mousquetons et des revolvers. C’est ce qu’exprimait sans ambages le commissaire Dupuys, reprochant à l’officier de paix qui en avait pris l’initiative, de transformer ainsi l’assassin en héros.
– Il faut en finir… et le plus tôt possible ! grogna Dupuys en rentrant dans la maison ; il y a de quoi devenir enragé d’être tenu ainsi en échec par un assassin derrière une porte. Écoutez-moi.
La voix brève, il exposa son plan. Il fallait tenter un coup de force sur le palier, disloquer la porte par un tir nourri et ensuite, s’il le fallait, se lancer à l’assaut. Entre l’étage habité par Raimbaud et le palier inférieur, la ligne de tir fut établie. Des boucliers d’acier assuraient la protection des agents. Tout était prêt, et le brigadier Suiret ayant ordonné l’ouverture du feu, le fracas des détonations emplit l’escalier. Les balles frappèrent la porte à hauteur de la serrure, en plein bois. Sur le palier rien ne bougea, mais un vacarme soudain et des cris emplirent les étages inférieurs.
– Laissez-moi…. laissez-moi, je vous dis que je veux monter…
C’était Clara. Elle rentrait chez elle, quand elle avait appris en route le drame. Une force irrésistible l’avait alors jetée en avant, ruée à travers la foule des curieux, elle avait pénétré dans l’immeuble au moment où retentissait le fracas des premières détonations.
– François ! François ! hurla-t-elle. Ne tirez plus…
Elle était parvenue au troisième palier, là elle se heurtait à deux agents qui venaient à sa rencontre et fut rejointe par celui qui la poursuivait. Échevelée et pleurante, elle se débattait au milieu des trois gendarmes qui voulaient l’entraîner.
– Vous n’allez pas faire ça ! Ça n’est pas possible ! Assassins ! François, je suis là… Moi, Clara ! Non, vous ne ferez pas ça… Je ne veux pas… Vous n’allez pas le tuer… ce serait trop bête…
Sa voix s’éteignit, étouffée par la pèlerine qu’un agent venait de jeter sur sa tête. Maîtrisée, elle fut emportée jusqu’au rez-de-chaussée de l’immeuble où, gardée à vue un moment, elle ne fut libérée qu’après identification d’identité.
Là-haut le siège continuait. Sous le choc répété des balles, un panneau de la porte s’était fendu. À l’intérieur de la chambre, rien n’avait bougé et le commissaire Dupuys se demandait avec anxiété si le moment était venu de se ruer à l’assaut, quand on entendit un bruit étrange, craquement et glissement à la fois, dont un agent décela l’origine :
– Il a dû mettre une armoire devant la porte.
– Manquait plus que ça ! maugréa le commissaire.
Lassé de l’effort qu’il venait de faire pour pousser la lourde armoire devant la porte, François était retourné à son lit ; il s’y recroquevilla, tassé contre le mur. Un peu de brume voilait ses yeux… Ainsi voit-on parfois s’embuer les yeux des bêtes qui souffrent, avant leur agonie. Une image naissait, remplaçant celle qui était devant ses yeux. Il était dans la même chambre, seulement l’armoire était à sa place habituelle à gauche de la porte. Celle-ci était intacte ; il faisait grand jour et il achevait de s’habiller. C’était dimanche et il avait dormi plus tard que de coutume. Il avait descendu l’escalier, sifflotant, et salué en bas la mère Bastien qui lavait le carrelage. Traversant la place, il était entré dans l’hôtel, avait en quelques enjambées atteint le premier étage et était entré sans frapper en criant :
– Je ne te dérange pas ? Tu es seule ?
Derrière un rideau Clara achevait sa toilette ; elle passa sa tête, et grogna :
– Imbécile ! Naturellement je suis seule, puisque tu me laisses toujours toute seule.
Il s’approcha pour l’embrasser, prévenant les reproches prêts à jaillir :
– T’es belle comme ça, tu sais… On dirait la Vérité sortant du puits.
– La Vérité ! répliqua-t-elle gaiement, tu ferais mieux de te taire… Si je te les disais, à toi, tes quatre vérités ?
– Pas la peine… je ne suis pas curieux ce matin… je suis amoureux.
Elle sortait de derrière son rideau, enveloppée dans un peignoir :
– Amoureux ! qu’est-ce qu’y faut pas entendre ! Quand je pense que je moisis ici depuis deux mois… et pour quoi ? pour qui ? pour une brute pareille qui vient me voir comme ça… quand ça lui fait plaisir, de temps en temps, en touriste.
– Tu sais bien, Clara, qu’il n’a jamais été question d’autre chose !
Il avait parlé posément et elle comprit que durant les deux mois qui s’étaient écoulés, alors qu’elle ne songeait qu’à lui, n’espérait que lui, elle n’avait pris aucune place dans sa vie. Près d’elle il venait chercher le plaisir, c’était tout.
Il s’était jeté sur le lit, et elle vint s’étendre tout contre lui :
– Je sais… je sais, tu ne m’as rien promis et je ne t’ai rien demandé, mais tout de même… Je m’ennuie la nuit, moi… si c’est ça que tu appelles des nuits d’amour.
Il sourit et l’attirant contre lui changea soudain de ton. Il murmura, les lèvres dans son cou :
– Tu ne trouves pas, Clara, qu’il fait un peu trop clair chez toi… je voudrais un petit peu d’ombre.
Elle se leva, docile, et alla vers la fenêtre. Elle commençait à tirer un des rideaux et machinalement regardait dans la rue, quand elle eut une sourde exclamation. François demanda sans bouger :
– Qu’est-ce qu’il y a ?
Si bizarre était son intonation, qu’il se leva. Elle lui montra devant le trottoir de l’hôtel une petite camionnette, de laquelle descendait Valentin.
– Il arrive bien celui-là. Qu’est-ce qu’il vient faire ?
Clara redressa la tête, elle jeta presque agressive :
– Pour me voir ? Il vient pour la petite, oui…
– Écoute, Clara, fit-il sèchement, je t’avais dit de ne jamais parler de ça !
Elle haussa les épaules et répliqua rageuse :
– Tu vas voir s’il va se gêner pour t’en parler, lui…
Quelques minutes s’écoulèrent. Ni François ni Clara, demeurés à la fenêtre, ne prononcèrent un mot, puis agacé, il bougonna :
– Qu’est-ce qu’il fait ? Il en met un temps à monter !
Un sourire blasé se joua sur les lèvres de la jeune femme. Elle se dirigea vers la porte sans bruit, ouvrit brusquement. Valentin apparut dans la position fâcheuse du monsieur surpris à écouter aux portes. Un réflexe rapide le fit se redresser et sans le moindre trouble, il entra.
– Eh oui, j’écoute aux portes… Ça vous choque… c’est inouï… ce sont les gens qui ont l’air le plus franc qui ont précisément horreur qu’on écoute aux portes… J’espère que je ne vous dérange pas, au moins. Vous avez l’air si bien tous les deux. Tout de même. ça réchauffe le cœur… de voir un vrai bonheur.
Clara connaissait trop les effets faciles de Valentin pour s’y laisser prendre, elle répliqua, hargneuse :
– Quand t’auras fini de parler entre guillemets, tu me le diras. Qu’est-ce que tu viens faire ici ?
– Moi ? Je viens comme ça en passant… Tu ne veux pas voir les chiens ?
– Non, fit-elle sèchement.
François en avait assez, il éclata :
– Ça va avec tes chiens… Qu’est-ce que tu veux ?
Clara, très lucide, savait qu’elle n’était pas le motif de l’hostilité qui dressait les deux hommes l’un contre l’autre. Elle dit à François :
– Mais tu le sais bien ce qu’il veut… Il veut te parler… et toi aussi tu veux lui parler… Écoute, François, tu devrais t’en aller, il s’en irait avec toi… Vous seriez plus tranquilles et moi aussi… parce que ce que vous avez à dire… ça ne m’intéresse pas.
François gagna la porte sans répondre. Valentin fit un mouvement pour le suivre, puis se ravisant :
– Tu sais, Clara, j’ai eu tout de même beaucoup de peine quand tu m’as quitté…
– Beaucoup de peine ! coupa-t-elle, ironique…
Face à face, à une table du café d’en bas les deux hommes se considérèrent un instant comme s’ils se mesuraient, mais il y avait dans les yeux de François une résolution virile qui fit se détourner le regard de l’autre. Le silence durait et François exaspéré attaqua brusquement :
– Écoute, on ne va pas rester là jusqu’à la fermeture. C’est à cause de Françoise que tu es venu ?
– Oui ! fit l’autre sans s’émouvoir. Je suis ici depuis hier et j’ai appris pas mal de choses… par exemple que vous n’aviez cessé de fréquenter cette jeune fille.
François sursauta :
– Qu’est-ce que ça peut te f… ?
– Ce n’est pas en étant grossier que vous éviterez les explications que j’ai à vous demander, répliqua l’autre, très digne.
– Des explications…
– Parfaitement… J’ai toléré votre liaison avec Clara… parce que j’ai les idées larges… Clara est libre de faire ce qu’elle veut, tandis que Françoise… Il y a quelque chose qu’il faut que vous sachiez… Si je m’intéresse à cette petite, c’est parce qu’elle est… ma fille !
Comme s’il n’avait pas compris, François s’exclama, sidéré :
– Hein ?
– Oui ! dit solennellement Valentin, Françoise est ma fille !
La tête baissée, Raimbaud ruminait l’effarante nouvelle. Déjà, des objections se présentaient :
– Mais elle est de l’Assistance.
– Est-ce que vous croyez que les enfants de l’Assistance n’ont pas de parents ! se récria Valentin. Puis, la voix tremblante d’émotion, il reprit :
– Vous avez devant vous un pauvre homme… J’ai des défauts, des vices même, mais dans le fond je ne suis pas plus mauvais qu’un autre….Je ne parlerai pas de la mère… inutile de l’accabler… Quand nous avons eu cet enfant, j’étais encore jeune, je ne me rendais pas compte… Une erreur de jeunesse, comme on dit, une blague… mais on vieillit et on s’aperçoit que ce n’était pas une blague… mais une faute, et ça ronge… Peu à peu, j’ai fini par ne penser qu’à ça… et j’ai cherché… vous ne pouvez pas savoir ce que j’ai cherché. Je n’osais pas y croire. J’ai tout vérifié deux fois. Mais quand je l’ai vue, tout le portrait de sa mère… les mêmes yeux verts un peu changeants…
Sa voix tomba savamment et il se pencha pour boire une gorgée de son apéritif. Comme s’il réalisait seulement la chose, François eut une sourde exclamation :
– Ça alors, c’est un monde…
– Vous comprenez donc qu’il était de mon devoir d’intervenir… Moi, je ne souhaite qu’une chose, le bonheur de cette petite. Eh bien, franchement, je ne pense pas qu’elle puisse être heureuse avec vous…
François sentait monter en lui un immense écœurement, en même temps que l’agacement de voir ce père subit se mêler de ses affaires.
– Ça c’est formidable… Y a rien d’autre à dire, t’es formidable… le père ! Ah ! il est gratiné, le père !… Il met sa fille au garde-meubles et puis vingt ans après, il s’amène, pour quoi faire ? je vous le demande ? Pour faire de la morale… De quoi se marrer… Écoute… moi aussi, je suis de l’Assistance, mais tu peux être tranquille que si papa et maman rappliquaient pour m’apprendre le piano, comment que je leur dirais deux mots… Et puis, qu’est-ce que ça peut te faire tout ça… Elle me plaît, Françoise. Je l’aime, tu as compris, je l’aime…
Ses derniers mots avaient provoqué une agitation fébrile chez son interlocuteur.
– Vous l’aimez, et elle ?
– Est-ce que ça te regarde ?
– Enfin, j’ai le droit de savoir ce qui s’est passé exactement entre vous et elle…
– Le droit ! ricana François… Tiens, tu me fatigues.
– Voyons… qu’est-ce que vous comptez faire ? Enfin… Françoise, je suis responsable… Vous n’avez pas de situation, pas d’avenir… et il faut bien le dire, vous faites un métier malsain…
La poigne solide de François souleva de sa banquette le cabotin, tandis qu’il grondait avec une sourde violence :
– Qu’est-ce que tu as dit ?
L’autre cessait de plastronner. Il avait peur, mais au fond de ses yeux troubles, François voyait luire une lueur mauvaise. Il le laissa retomber brutalement :
– Tu sais ce que tu vas faire maintenant ? Tu vas te lever… mettre ton petit chapeau sur ta petite tête, puis tu vas partir, tu entends ? Partir immédiatement…
Il faisait oui de la tête, mais il restait à la même place et ce fut François qui s’éloigna.
Françoise avait proposé à son amoureux de lui faire visiter les serres. Les Briquet sortis pour la promenade dominicale, elle était maîtresse du domaine des horticulteurs. Celle dans laquelle elle le conduisit était remplie d’azalées. La première minute d’émerveillement passée, les préoccupations du matin assaillaient François. L’esprit ailleurs, il suivait pas à pas la jeune fille. Peu à peu, impressionnée par son mutisme, elle se tut. Ils étaient arrivés à l’extrémité de la serre, et lui prenant le bras, il dit soudain :
– Ça ne te plairait pas à toi ? de vivre avec moi… On serait heureux, tous les deux… Mais tu sais… il y a quelque chose qui me gêne, ou plutôt quelqu’un, tu sais bien ce que je veux dire…
Un sourire gentiment moqueur se joua sur les lèvres de la jeune fille :
– Alors, ça continue, toujours jaloux ?
– Non, la jalousie, c’est fini. Maintenant je sais qui c’est. Tout de même, t’aurais pu me le dire que c’était ton père…
Françoise éclata de rire avec une telle spontanéité qu’il en resta interdit. Quand elle eut repris le souffle, elle s’exclama. La stupeur le laissa coi, puis une flamme de colère brilla dans ses yeux :
– Qu’est-ce que tu dis ? C’est pas ton père !
– Mais non, fit-elle, rieuse. Il a une marotte. Il aime bien raconter des histoires.
Ses prunelles gardaient la même limpidité, tandis qu’elle continuait très naturellement :
– Il a toujours été très gentil avec moi… c’était le seul avant vous qui ait été gentil avec moi. Chaque fois qu’il vient, il m’apporte quelque chose, il m’écrit. Et puis, il a beaucoup voyagé, il connaît des tas de choses…
Le jeune visage exprimait l’émerveillement des ailleurs dont parlait Valentin avec tant d’aisance.
– C’est pas vrai ! gronda François, il a jamais voyagé. Y connaît rien. C’est un maniaque, un menteur !
La simplicité naturelle de François était rebutée par la complexité de cet homme étrange. À la pensée qu’il avait pu toucher Françoise, le sang martelait ses tempes.
– Si vous voulez, dit-elle doucement, je ne le reverrai plus. Cette proposition spontanée l’apaisa et il l’attira contre lui. Leur baiser les retint un long moment enlacés, puis se dégageant, elle alla s’étendre sur un tas de paillons. François l’y rejoignit. Il s’était agenouillé près d’elle et la dominait, troublé par le charme un peu animal qu’elle dégageait. Il sentait ses rancunes fondre en une immense tendresse ; il se pencha un peu plus et prononça, comme un aveu :
– C’est vrai que je t’aime, tu sais… Tu as un joli corps… tu es fragile. La première fois que je t’ai vue avec tes fleurs, tout d’un coup, j’ai eu envie d’être heureux…
Il prit sa bouche et sous son baiser dominateur elle plia, docile, puis il reposa sa tête contre la sienne. François fit un mouvement, elle porta ses mains à son cou et décrocha la broche qui ornait sa robe, une broche modeste, faite d’une mosaïque de petites pierres multicolores. Elle la tendit à François et dit avec une espèce de solennité :
– Je vous la donne. C’est la chose à laquelle je tenais le plus…
Il tint le bijou enfermé dans sa main et demanda tout bas :
– Tu m’aimes ?
Françoise tourna son visage vers lui et elle répondit, le tutoyant pour la première fois :
– Je t’aime…
Les yeux grands ouverts pour ne pas laisser tomber ses larmes, Clara regardait les passants sans les voir, et tout à coup, elle sentit contre son coude, sur la barre d’appui de la fenêtre, celui de François. Prévenant les mots qu’il allait prononcer, et qui lui seraient encore plus cruels que ceux qui avaient précédé, elle murmura :
– Il n’y a rien à dire François… rien à expliquer… Quand tu es arrivé j’ai compris tout de suite.
Elle eut un petit rire qui se brisa dans un sanglot :
– T’avais l’air de venir pour une mort… tu sais… ces messieurs de la famille…
Ce rire, cette moquerie lui firent mal pour tout ce qu’ils contenaient chez Clara de douleur cachée :
– J’ai été heureuse à cause de toi… alors j’aurais voulu que ça continue… seulement, moi j’habitais ici, toi t’habitais en face. C’était trop loin.
Mais sa vivacité naturelle ne pouvait s’accoutumer de gémissements, et puis l’attitude de François l’exaspérait :
– Oh ! je t’en prie, ne fais pas cette tête-là ! À te voir, on croirait que c’est moi qui te laisse tomber… T’es trop sensible, trop délicat !
Elle quitta l’appui de la fenêtre, rentra dans la chambre, et dans un tiroir prit une paire de bas qu’elle commença à enfiler. François était venu s’asseoir dans le fauteuil, il suivait tous ses mouvements, puis doucement avec affection :
– Écoute, Clara, j’ai pas voulu te faire de peine… et puis je voudrais que tu gardes tout de même un bon souvenir de moi.
Elle s’était dressée violemment :
– Un bon souvenir… des souvenirs… est-ce que j’ai une gueule à faire l’amour avec des souvenirs…
Elle alla chercher dans un coin une mallette qu’elle apporta sur la table et dans laquelle elle fouilla fébrilement. Elle découvrit enfin ce qu’elle cherchait et revint à lui :
– Tiens, je vais t’en donner, moi, un souvenir !
Elle lui tendait une broche toute pareille à celle que, quelques heures plus tôt, Françoise lui avait donnée. Il balbutia, interloqué :
– Où est-ce que tu as eu ça ?
Elle avait un air gouailleur qui procura à François une sorte de malaise :
– C’est Valentin qui me l’a donnée… Ça te choque… Eh bien je lui ai pris, son petit stock ! Tu veux les voir… c’est pas difficile. C’est un lot, une affaire et c’est joli, ça vient d’Italie…
Elle retourna à la valise et retira un carton plat où se trouvaient, encore épinglées, d’autres broches semblables à celle de Françoise.
– Tiens, regarde… c’est beau comme tout… Il en donne une à chaque femme qui couche avec lui…
François revoyait sa fuite sans un mot, alors qu’une douleur affreuse crevait son cœur. Il revivait la nuit d’insomnie qu’il avait passée, étreint par l’abominable doute semé par Clara ; puis le souvenir des yeux purs de la jeune fille lui avait fait repousser l’image de Françoise aux bras du cabotin maniaque. D’avoir revécu l’affreux cauchemar, il se sentait épuisé. Il se dressa d’un jet, courut à la cheminée. Sur la droite du cadre de la glace, il prit un objet, le considéra un instant ; c’était la broche de Françoise ; d’un geste rageur, il jeta le bijou par la fenêtre, en marmonnant entre ses dents :
– Ça c’est un monde !
Les premières lueurs de l’aube répandaient leur clarté morne sur la place, où s’opérait une première circulation. Il n’y avait pas encore de voitures, mais seulement des ouvriers se rendant à leur travail à vélo. Quelques-uns s’arrêtaient, quêtant des détails auprès de ceux qui étaient restés là toute la nuit. Soudain quelqu’un cria avec une espèce d’effroi :
– Il est à sa fenêtre !
D’un même mouvement toutes les têtes se levèrent. On le distinguait nettement, penché sur cette foule qui l’épiait, il cria :
– Qu’est-ce que vous guettez tous ? Je ne suis pas une bête curieuse… Un assassin, c’est intéressant… un assassin… un assassin…
Il clamait le mot âprement, et cette voix, tombant de là-haut dans la tristesse du jour à peine naissant, s’appesantit sur tous les badauds comme un manteau glacé. Il continuait à hurler, jetant son désespoir en un discours incohérent :
– Je suis un assassin… C’est pas rare les assassins… ça court les rues… Tout le monde tue un peu, mais cela ne se voit pas… Allez-vous-en !! Rentrez chez vous. Vous lirez ça dans le journal ce soir…
Sa voix montait, brisée par moment par l’affreuse exaltation qui l’animait. C’est alors qu’au tournant de la rue Serpente, Françoise parut. Paulo et Gaston, deux camarades de Françoise, étaient allés la chercher, et folle d’angoisse elle accourait ; déjà elle pouvait entendre les imprécations du malheureux. Sa poussée se fit plus forte pour écarter les gens devant elle, et quand elle fut plus près de la maison, quand elle put croire qu’il la distinguerait au milieu des autres, qu’il l’entendrait, elle cria de toutes ses forces :
– François ! François !
Mais son appel ne semblait pas l’atteindre. À son esprit n’arrivait plus rien du monde extérieur, et il continuait à parler :
– Je suis fatigué… fatigué… abîmé… c’est fini… j’ai plus confiance… c’est fini…
Quelques camarades, parmi les ouvriers qui étaient sur la place, joignirent leurs appels à ceux de Françoise. D’un homme à l’autre, d’un groupe au plus proche, l’émotion grandissait. De la foule, d’ordinaire méchante et trop souvent imbécile, montait soudain un peu d’humanité. Tous l’adjuraient de cesser cette résistance fatale, de se rendre. Une sorte de délire s’était emparé de la foule. Tous criaient, suppliaient, mais François ne parlait plus.
Lentement il s’était retiré de la fenêtre. Une à une les voix s’éteignirent. Un morne accablement avait succédé sur la place à l’exaltation précédente. C’est à ce moment qu’un car de gardes mobiles, s’ouvrant un passage dans la foule troublée, vint s’arrêter devant la maison. Un officier sauta à terre et ayant reconnu les lieux, ordonna à ses hommes :
— Allez… déblayez…
S’étalant en éventail ils refoulèrent les badauds. Françoise qui se trouvait au premier rang fut repoussée avec les autres. Désespérée, elle cria de toutes ses forces vers l’homme qui ne la voyait ni ne l’entendait plus :
— François… François… je t’aime…
Elle était brisée. De toutes ses forces elle avait résisté au courant qui l’éloignait de la maison, et tout à coup, comme un remous se formait sous une poussée plus rude des agents impatientés, elle s’écroula. Paulo qui était tout près d’elle put la relever et la porta dans ses bras, tandis que Gaston et les autres formaient écran autour de lui et lui frayaient un passage. Soudain, fendant la foule qui se pressait curieusement autour de ce nouveau spectacle, Clara surgit.
Elle n’avait pas quitté la place de toute la nuit. Son visage portait les traces de ses fatigues, tandis que tout le monde hurlait, elle était restée à l’écart silencieuse. Quand elle avait vu la jeune fille s’écrouler, sans réfléchir, d’un élan instinctif, elle s’était portée en avant.
– Elle est blessée ? demanda-t-elle en se penchant vers elle.
– Elle est tombée ! C’est sûrement la tête qui a porté… On peut tout de même pas la laisser là…, dit le brave garçon, embarrassé de son fardeau.
– Bien sûr… il faut la coucher… on va l’emmener dans ma chambre.
Elle désigna l’hôtel du regard et sans attendre leur réponse, elle ouvrit la foule pour les guider.
Appuyé contre le mur, François ne pensait plus à rien. Le ciel plus clair marquait l’approche du lever du soleil et sa lueur commençait à combattre celle de l’ampoule électrique pendue au milieu de la chambre.
Il frissonnait : par les vitres brisées, le froid aigre du matin le transperçait. Il alla prendre sur le dos d’une chaise sa veste de cuir et revint s’asseoir sur son lit. Il laissa la chaleur s’insinuer en lui. Comme il relevait la tête, ses yeux se posèrent sur le réveille-matin placé sur la table de chevet. Il marquait cinq heures dix. Il fixait les aiguilles sur le cadran clair et une autre image remplaça la réalité.
C’était le même réveil. Seulement les aiguilles marquaient huit heures cinquante. C’était… oui, c’était bien hier soir, alors que, prêt à se coucher, il avait saisi le réveil et réglé la sonnerie. C’est à ce moment qu’on avait frappé à sa porte, et Valentin était entré. Tout de suite, à la vue du cabotin, une flambée de colère jaillit en François :
– Qu’est-ce que tu viens faire ici ?
L’autre s’approchait malgré le mauvais accueil :
– Il fallait absolument que je vous parle, seul à seul, d’homme à homme.
– Fous-moi le camp ! ordonna François.
Les dents serrées, un peu pâle, il se contenait pour ne pas le jeter dehors. À son ordre, Valentin n’avait pas obéi, et comme s’il craignait que François ne lui laissât pas le temps de parler, il jeta précipitamment :
– Françoise refuse de me voir… je ne peux pas le supporter. C’est vous qui le lui avez défendu, je le sais…
Une étrange agitation s’était emparée de Valentin. Un tremblement secouait ses mains et jusqu’aux traits de son visage. Ses yeux inquiets semblaient ne pouvoir se fixer nulle part.
– C’est bien ça… Je suis le cornard, le risible. Vous avez dû bien rigoler avec Clara… Mais j’ai pas d’amour-propre, moi… Vous allez me dire tout de suite ce qui se passe avec Françoise !
Valentin changeait de visage et se faisait maintenant implorant :
– Vous ne voyez pas que je souffre ! Bien sûr, l’autre jour, je vous ai raconté des histoires… naturellement, je ne suis pas le père. Ça vous choque…
– Tu me dégoûtes ! jeta Raimbaud méprisant.
Valentin maintenant s’exaltait. Il allait et venait autour de la table, agitant ses mains, multipliant ses gestes qui exaspéraient François.
– Moi, je suis un imaginatif, un rêveur… J’imagine ce qui me plaît… et puis, je ne pouvais pas supporter que cette petite…
Le son même de sa voix, François ne pouvait plus l’entendre. Une étrange fureur qu’il ne pouvait dominer lui fit crier :
– Tu vas te taire !
C’était autour de Valentin de retrouver son aisance à mesure que François perdait tout contrôle :
– Vous êtes nerveux parce que vous êtes inquiet… et vous êtes inquiet parce qu’il y a des choses qui vous échappent, c’est compliqué, hein !
Son expression était pleine de sous-entendus, mais François ne voulait rien entendre et poussant brutalement Valentin jusqu’à la fenêtre, il s’écria rageur :
– Je vais te faire taire, moi !
Il l’avait acculé contre l’appui de bois où sa poigne le maintenait courbé. Une lueur de meurtre était dans ses yeux et Valentin prit peur :
– Arrête ! arrête ! supplia-t-il, lâche-moi.
– Bien sûr que je te lâche, gronda François plein de rancœur, mais c’est dommage.
Délivré, encore pâle d’émotion, Valentin se laissait tomber sur une chaise :
– C’est idiot…, grommela-t-il, j’ai le vertige… Clara a raison, je vieillis… Je ne peux pas maîtriser mes nerfs. Ce n’est pas possible de tuer un homme, hein ? j’en sais quelque chose, j’étais venu pour ça. Tiens, regarde !
Il sortit de sa poche un revolver qu’il jeta sur la table.
– Je voulais te tuer, reprit le cabotin d’une voix lassée. Une idée comme ça. J’ai souvent des idées merveilleuses, mais je ne vais jamais jusqu’au bout… Je suis dérisoire, minable… Et pourtant si tu m’avais connu quand j’étais jeune…
Brutalement François coupa :
– Quand t’étais jeune, tu devais être pareil… aussi dégueulasse que maintenant…
L’injure réveilla chez Valentin une combativité inattendue.
– Dégueulasse ? moi ? et pourquoi pas ? Cela a ses avantages… T’es honnête, toi, t’es simple, t’es confiant…
François bondit, secoua rudement l’homme :
– Qu’est-ce que tu veux dire ?
– Qu’est-ce que tu veux savoir ? brava le cabotin avec une flamme mauvaise au fond des yeux.
Raimbaud le repoussa si violemment qu’il faillit perdre l’équilibre. Rejeté vers la porte, il retrouva vite sa désinvolture :
– Quelle rigolade ! comme les gens simples se font des idées étonnantes sur les femmes…
– Tais-toi ! hurla François, les nerfs tendus à claquer.
L’autre, avec un rire qui sonnait faux, le bravait. Les allusions louches, les fausses confidences qui suivirent, portèrent à son paroxysme la rage de François. À bout de résistance, François prit le revolver sur la table. Un accès de folie noyait son cerveau. Le faire taire à tout prix… Valentin le narguait toujours. La démence de François semblait l’emplir de délectation ; il était si sûr que, pas plus que tout à l’heure à la fenêtre, il ne serait capable d’achever son geste ! Mais il avait trop présumé de sa faiblesse, car une détonation claqua soudain, en même temps qu’à son flanc une tenaille déchirait sa chair…
François se souvenait du silence qui avait suivi. Valentin n’avait pas poussé un cri, mais ses mains s’étaient crispées sur son ventre, tandis que son visage se convulsait en une affreuse grimace.
Lentement la grisaille du ciel pâlissait. Recroquevillé sur son lit, François s’étonnait de ne plus souffrir. Il remua un peu pour sortir de sa poche une cigarette. Il étendit la main pour prendre dans le cendrier le mégot déposé quelques instants plus tôt, l’approcha de sa cigarette, mais c’est en vain qu’il aspira à plusieurs reprises… Le mégot était éteint, il n’avait plus de feu. Ses mains désormais inutiles, il les enfonça dans ses poches et il commença une marche qui ne devait plus guère s’interrompre.
Étendue sur le lit de Clara, Françoise délirait tout bas.
– François… j’ai mal, tu sais, mal à la tête… dedans… ça roule…
Assise à côté d’elle, Clara la regardait, l’écoutait. Un peu de pitié s’insinuait en elle pour cette enfant. Elle la considérait sans hostilité ; une commune misère les rapprochait. La malade ne réalisait absolument pas la présence de la jeune femme auprès d’elle et entre deux gémissements continuait à parler tout haut :
– François, je t’aime… tu sais… Toujours expliquer… toujours expliquer… Tu comprends, François… on s’aime… le reste, ça ne nous regarde pas…
Trois coups frappés contre la porte rompirent le calme de la chambre. Clara allant ouvrir trouva Paulo et Gaston sur le palier. Visiblement impressionné par ce qu’il allait annoncer, Paulo prononça tout bas :
– Les gaz !
Elle ne réalisait pas tout de suite ce qu’il voulait dire, puis, comprenant soudain, elle eut un cri d’indignation :
– C’est pas possible, ils vont pas l’asphyxier !
– Mais non… c’est des gaz lacrymogènes… Ça le fera pleurer, et puis il toussera… un sale moment à passer… avec le sable, on est habitué…
Ils se regardèrent tous trois en silence. Les mots par lesquels ils auraient voulu exprimer leur peine et leur commune appréhension ne venaient pas à leurs lèvres. C’est alors que la voix faible de Françoise appela :
– Clara… Clara…
Elle revint au lit, tandis que les deux ouvriers s’en allaient. La jeune fille n’avait pas bougé, mais elle continuait à prononcer des paroles sans suite dans un demi-délire :
– Clara… qu’est-ce que ça peut faire, Clara, puisqu’il ne l’aime pas… C’est moi que tu aimes, François, on ne peut pas aimer tout le monde à la fois…
Le jour qui commençait à envahir la chambre pouvait gêner le repos de la malade et Clara alla à la fenêtre fermer le rideau. Une dernière fois elle regarda derrière les vitres en direction de la chambre de François… Elle aperçut alors la silhouette du lieutenant de la brigade des gaz qui, sur le toit de la maison, se détachait en sombre sur le ciel d’aube. La fin du drame se préparait.
Elle appuya son front contre la vitre, retenant les sanglots qui crevaient sa poitrine. Des larmes sillonnaient ses joues… Derrière elle, Françoise continuait à soupirer dans un rêve apaisé :
– François… François… je t’aime…
Sur le faîtage de la maison, le lieutenant de la brigade des gaz avançait avec précaution. Le plan était de lancer les bombes dans la chambre de l’assiégé, où, le suffoquant sans l’asphyxier, elles l’obligeraient à se rendre.
Au milieu de sa chambre, les mains dans ses poches, François ne se préoccupait guère de ce qu’on préparait pour lui. Il savait qu’avec le jour sa vie finirait et la résolution qu’il avait prise, presque à son insu, lui avait procuré un extraordinaire apaisement.
À quoi bon vivre ? Il y a des gens qui sont faits pour être heureux. François ne se sentait pas de ceux-là…
Il prit le revolver sur la table. Lentement, il éleva sa main gauche, du bout des doigts il chercha la place du cœur… Il le sentit battre à son rythme régulier… Il tourna alors le canon du revolver qui, sous la veste de cuir, toucha l’étoffe brune de la chemise.
Une simple pression…
Le lieutenant était arrivé au-dessus de la fenêtre de François. Il cala ses semelles contre l’arête inférieure du toit. Bien équilibré, il put sortir d’une musette attachée dans son dos deux grenades qu’il arma posément, l’une après l’autre, puis il se pencha avec précaution vers la fenêtre aux vitres brisées. En bas, la foule repoussée derrière les barrages d’agents suivait haletante l’opération. Un silence fait de l’oppression de toutes les poitrines écrasa la place. Le lieutenant, le bras levé, se préparait à lancer sa première grenade quand éclata la détonation, venant de l’intérieur. Instinctivement et croyant le coup de feu dirigé contre lui, il eut un recul en arrière, puis par un rapide réflexe, il lança coup sur coup les deux grenades dans la chambre où elles éclatèrent avec un bruit sourd.
Elles étaient retombées au ras de la fenêtre. Déjà les volutes de gaz se répandaient dans la pièce, glissant lentement le long du carrelage.. À terre, le visage tourné vers le sol, sa main crispée encore autour de l’arme avec laquelle il venait de se tuer, François Raimbaud avait cessé de vivre… D’un petit trou tout rond, à la hauteur du sein, la vie s’en était allée de lui… et avec elle toutes les angoisses, toutes les douleurs…
De François maintenant, il ne restait plus qu’un cadavre encore chaud qu’enveloppait comme un suaire la nappe de gaz.
Le jour était levé…
Dans son maigre reflet jaune, l’ampoule électrique continuait à brûler au plafond.
Fin
R. LAUDE et R. CORLIEU.


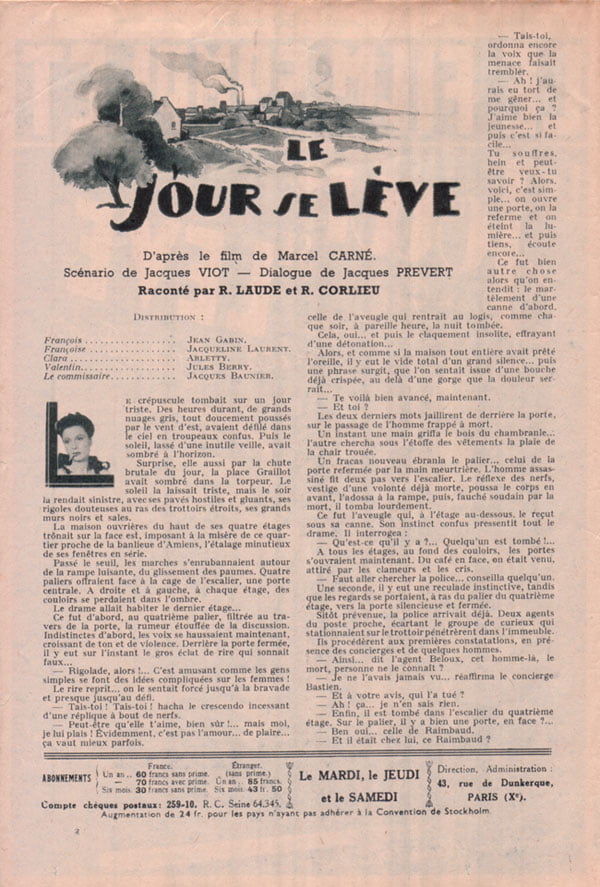













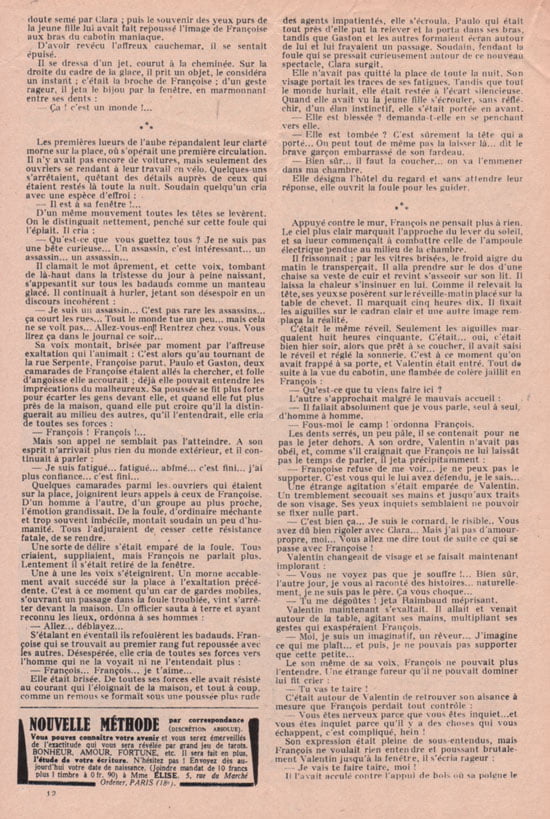







tres beau film ou la tendresse et l amour sont parfois saccagés par un vil profiteur qui profite de la candeur de la fille naive !!!!
je me pose toujours la question a t il vraiment couché avec francoise ou il le fais croire a jean gabin pour le destabilisé ???
si un cinéphile a une idée alors qu il me le fasse savoir
merci d avance
Mais alors, pourquoi Françoise a le même médaillon que ceux de Valentin ?