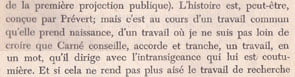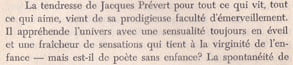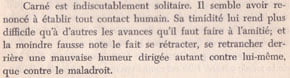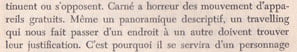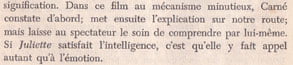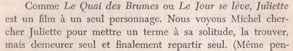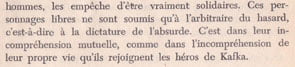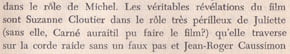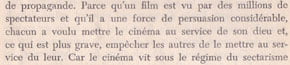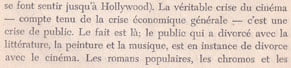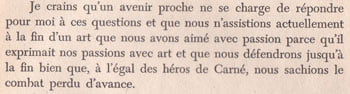BERNARD – G. LANDRY présente MARCEL CARNÉ
– Avec l’aimable autorisation de Bernard-G Landry –
Chapitre V –
OÙ VA MARCEL CARNÉ ?
Vous pouvez accéder directement aux sous-chapitres suivants en cliquant dessus :
5a – CARNÉ – PREVERT
5b – JULIETTE OU LA CLEF DE CARNÉ
5c – MARCEL CARNÉ ET LE CINÉMA
————-
5a – CARNÉ – PREVERT
Sans doute, est-il temps maintenant, de rendre à Marcel Carné et de rendre à Jacques Prévert ce qui, respectivement, leur appartient. Peut-être convient-il de détruire cette légende qui voulut faire de ces deux hommes l’équipe immuable du cinéma français, une espèce de couple idéal, de Laurel et Hardy de la réalisation. Au point qu’on dit couramment : « un film Carné-Prévert », sans même préciser qui est responsable du scénario et qui de la réalisation, exactement comme on dit : un ascenseur « Roux-Combaluzier ou Otis-Pifre », sans vouloir prétendre pour cela que Messieurs Roux et Otis se soient particulièrement occupés de la montée, et Messieurs Combaluzier et Pifre de la descente.
Certes, dans leurs films communs, la collaboration Carné-Prévert est effective dés l’élaboration du scénario. (C’est, en effet, une habitude de Carné — dont on s’étonne qu’elle ne soit pas commune à tous les réalisateurs — de s’occuper de ses films à partir de l’idée initiale, pour ne les lâcher que le jour de la première projection publique).
L’histoire est, peut-être, conçue par Prévert ; mais c’est au cours d’un travail commun qu’elle prend naissance, d’un travail où je ne suis pas loin de croire que Carné conseille, accorde et tranche, un travail, en un mot, qu’il dirige avec l’intransigeance qui lui est coutumière. Et si cela ne rend pas plus aisé le travail de recherche en paternité que j’ébauche ici, il ne fait qu’accentuer la nécessité de l’entreprendre.
Il est indiscutable que plus de dix ans de travail en collaboration ont créé entre ces deux hommes, en plus de liens d’amitié extrêmement solides (il suffit d’entendre Carné parler de « Jacques », pour comprendre la profondeur de l’amitié qu’il lui voue), des points communs établis par un jeu d’influences réciproques.
Prévert fit, avant que Carné ne tourne des films, des scénarios qu’il ne pourrait plus écrire maintenant dans le même esprit. De son côté Carné ne peut pas faire aujourd’hui exactement les mêmes films qu’il aurait réalisés s’il n’avait jamais rencontré Prévert. Pourtant je ne pense pas qu’il puisse exister sur terre deux hommes dont la parenté de pensée irait jusqu’à en faire des frères siamois de l’esprit même s’ils avaient subi une formation intellectuelle identique. Or il n’y eut longtemps rien de commun entre le petit garçon qui partait errer avec son frère quand leur père rentrait ivre, le bohème du café de Flore, le surréaliste turbulent et le fils émancipé du petit artisan ébéniste, l’assistant scrupuleux d’un metteur en scène célèbre, le critique sévère et incorruptible…
La part indiscutable que Marcel Carné apporte à l’équipe c’est, évidemment, toute la partie proprement technique, un certain style de la photographie (1), une syntaxe cinématographique particulière. Celle de Prévert c’est le dialogue. Jacques Prévert, à de rares exceptions près, a dialogué les films de Marcel Carné et, dans ses dialogues, comme dans ses poèmes, passe un souffle à la fois cruel et bienveillant ; feu d’artifices de mots d’esprit, de calembours cocasses, de coq-à-l’âne, de pirouettes, d’acrobaties verbales, de calembredaines avec, de temps à autres, un mot vrai, profond, émouvant. Mais ce dialogue où il y a à boire et à manger, où tout se trouve, le meilleur et le pire, l’Almanach Vermot, Voltaire et le Canard Enchaîné, est tyrannique au point que, parfois, on aimerait le lire après l’avoir entendu. Il retient à ce point l’attention que les oreilles ne suffisent pas à l’entendre ; et l’on se surprend à l’écouter avec les yeux, à le saisir avec ses mains ou avec sa bouche, pendant que les images défilent sur l’écran, qu’on ne voit plus.
Sont encore la propriété de Jacques Prévert un certain nombre de personnages familiers qui hantent ses poèmes et ses scénarios comme les dieux dérisoires d’une mythologie intime : personnages falots qui portent avec eux leur petite vie médiocre et sans lumière, bourgeois bêtes et cruels aux gros ventres décorés, gosses en ribambelles, familles trop nombreuses qui « mangent comme quatre, mais qui sont quinze », les hommes et les femmes qu’il agite comme des épouvantails, clamant leur rancoeur et leurs indignations, les bons et les méchants, les purs et les souillés, Dromadaire ou William Kramps, le peintre fou, le seigneur rubicond, le bourreau sinistre, Lacenaire, et Jéricho, et Guy Sénéchal, et tous les autres qu’on peut saluer au passage, car ce sont de vieilles connaissances, depuis Le Crime de Mr Lange, ou L’Affaire est dans le sac, ou encore La Crosse en l’air, poème-feuilleton.
Mais il ne s’agit là que de l’apport de chacun, versé au capital d’une association placée sous le régime de la communauté. Il pourrait être encore question d’une pensée unique entre deux personnes.
Le point où Carné et Prévert s’éloignent le plus l’un de l’autre — et qui est l’essentiel ! — a trait à leur attitude en face de la vie.
Si Carné pose, parfois, le problème de la vie d’une façon tendancieuse, du moins se garde-t-il bien de le résoudre, que ce soit par l’absurde, comme Jean Vigo, ou par l’algèbre, à la manière de Jean Renoir. C’est que Carné n’est ni un propagandiste, ni un pamphlétaire ; pas même un satiriste. Au contraire de celle de Prévert, son oeuvre ne revêt jamais la truculence de celui qui déchire à belles dents.
Je crois surtout qu’il y a chez Carné une sorte d’incapacité, d’irréductibilité à la gaîté. (Drôle de Drame, qui doit tant à Prévert, est aussi accidentel dans l’oeuvre de Carné que Les Plaideurs dans celle de Racine).
Si Carné, bien qu’il ait le sens de l’humour, est un homme aussi sérieux, jusque dans les moindres actes de sa vie privée, c’est qu’il est d’un pessimisme irrémédiable, que ne vient atténuer aucun espoir, ni aucune croyance.
Au contraire, Jacques Prévert est un mystique. Cela le ferait rire sans doute s’il lisait ces lignes, mais il n’en est pas moins vrai qu’en dépit de son anarchie débordante, qui s’attaque à toutes les autorités et à toutes les croyances officielles, Jacques Prévert est un croyant sincère, avec tout ce que cela représente de bonne mauvaise foi et de fanatisme. La seule différence, c’est que Jacques Prévert croit en l’homme, alors que d’autres croient en Dieu. C’est ce qui fait son optimisme. Bien sûr, il ne s’agit pas d’un optimisme béat, du genre « tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes ». Non, tout n’est pas pour le mieux et il s’en faut ; mais ce n’est pas dans le pire des mondes. Il suffirait que tous ces hommes qui sont là, et qui ont de bonnes gueules de bons copains, débarrassent le monde de tous les salauds qui ont les bonnes places, pour que tout change et que tout devienne beau.
Cette espérance dans les possibilités d’un avenir meilleur, on la retrouve dans les films de Jean Renoir, où dans la même turbulence anarchisante, où s’épanouit, la même sensualité brûlante que dans les oeuvres de Prévert. Leur collaboration si heureuse du Crime de Mr Lange, où se révélait une harmonie sans dissonance entre les deux hommes, fait regretter davantage encore que les ambitions littéraires de Jean Renoir aient empêché que se forme définitivement une équipe Renoir-Prévert, peut-être mieux assortie que l’équipe Carné-Prévert. Car je doute qu’il y ait chez Carné cette confiance en l’homme dont témoignent pourtant certains de ses films (ceux qu’il fit avec Prévert), mais que démentent formellement La Marie du Port (il est vrai que ce film ne prouve rien) et Juliette ou la Clef des Songes, où le seul personnage sympathique ne trouve de recours que dans un suicide moral.
La vérité c’est que l’optimisme de Jacques Prévert est un optimisme de propagandiste, qui ne va pas sans une naïveté qui explique son génie, comme les défauts qui l’entachent. Au fond Prévert est un simple, qui aime totalement ses personnages sympathiques et déteste totalement ceux qui ne le sont pas, au point de ne pas leur reconnaître de possibilités viriles (« Je te ferai bien rougir, si je disais certaines choses » dit — à peu près — Malou à Georges dans Les Portes de la Nuit). Il s’est trouvé en plus que ses convictions politiques ont déterminé, d’avance, à quelles classes sociales appartiendraient les bons et les méchants. Que les capitalistes ne sachent pas faire l’amour, Prévert en est persuadé ; de même qu’il est persuadé que les classes laborieuses sont automatiquement parées de toutes les vertus, parce qu’elles crèvent de faim. Il y a là un romantisme qui permettra peut-être, plus tard, de rapprocher Jacques Prévert de Victor Hugo, dont, même par la forme — humour en plus (quoique Hugo n’ait pas ignoré, ni toujours dédaigné l’humour) — il ne me paraît pas tellement éloigné (2).
Les films de Prévert sont des mélodrames qui mettent aux prises des bons sans défaut et des méchants sans vertu.
L’invraisemblable collection de monstres qui forme la famille des Amants de Vérone montre jusqu’où peut aller Jacques Prévert dans la schématisation excessive, quand rien, ni personne, ne vient endiguer sa férocité et permettre à sa tendresse de s’exprimer. Dans ce film, la rage de Jacques Prévert a dévoré presqu’entièrement l’histoire d’amour, qui donnait pourtant son titre au film et qui tentait une modernisation de la légende de Roméo et Juliette.
Les films de Marcel Carné sont des tragédies où tous les personnages sont innocents.
Il se trouve que, parfois, les films de Prévert furent aussi les films de Carné, ce qui nécessita, de la part de chacun, des concessions perpétuelles, que, seule, une longue amitié d’homme pouvait tolérer. L’exemple le plus frappant de ce désaccord profond se trouve sans doute dans Les Enfants du Paradis. L’optimisme de Prévert lui a fait centrer son film sur Lacenaire, ce personnage en perpétuelle révolte contre la société — car l’anarchisme n’est pas une position facile dictée par le désespoir, il exige une confiance, remise en question et renouvelée chaque jour, dans les vertus destructrices de quelques mots, de quelques actes, de quelques individus. Carné, désenchanté, désespéré, totalement pessimiste a fait de Baptiste Debureau, timide et résigné, ayant une femme, un enfant, une situation sociale, en un mot dévoré par le virus-société dont il connaît la nocivité, le personnage principal du sien. Plus significatif encore est le personnage d’Edouard de Montray. aristocrate hautain et cassant, qui était pour Prévert un fat orgueilleux, suffisant, impatient de ses désirs : insupportable, et dont Louis Salou, sous la direction de Carné, a fait un homme aussi dur envers lui-même qu’envers les autres, redoutant sa solitude, presque sympathique et souvent pitoyable : d’un méchant de mélodrame Carné a fait un irresponsable tragique.
La tendresse de Jacques Prévert pour tout ce qui vit, tout ce qui aime, vient de sa prodigieuse faculté d’émerveillement. Il appréhende l’univers avec une sensualité toujours en éveil et une fraîcheur de sensations qui tient à la virginité de l’enfance — mais est-il de poète sans enfance ? La spontanéité de ses réactions explique leur manque de nuance. C’est parce qu’il voit toujours tout pour la première fois, qu’il aime et déteste avec une telle violence, une telle passion. Prévert n’est capable que de sentiments forts, quitte à être injustes.
La tendresse que Carné voue à ses personnages n’est pas de la même nature. Elle est moins passionnée mais plus équitable ; elle est moins un mouvement du coeur qu’un réflexe de l’intelligence. Peut-être est-elle plus de la sympathie que de la tendresse ? C’est pour obéir à un sentiment de justice, que Carné s’efforce d’accorder à ses créatures au moins un moment de bonheur. Il s’agit donc d’une intention concertée, beaucoup plus que d’un élan instinctif. Ce sont là, évidemment, des hypothèses, mais je ne vois guère de sensualité chez Marcel Carné — sinon celle, très particulière, qu’il dénonce en composant les images de ses films avec science et aussi avec amour. Sa tendresse pour ses personnages me paraît commandée par une sensibilité de l’intelligence, où les sens ont peu de part. Les scènes d’amour de ses films le montrent bien, qui ne présentent jamais la formation d’un couple, mais, comme je l’ai déjà dit, l’effort désespéré de deux individus pour rompre leurs solitudes ; c’est-à-dire beaucoup plus une démarche de l’esprit que de l’instinct.
Car nous voilà revenus à la solitude qui est le mot-clef quand il s’agit de Carné.
Sans doute Prévert a-t-il le sentiment de sa solitude. Il transparaît dans plus d’un poème. Mais il est trop solidaire des hommes qui souffrent et de ceux qui se révoltent, pour se sentir vraiment seul. En mettant les choses au pire, il pourrait s’appuyer sur sa haine sans cruauté — et la haine est un sentiment réconfortant de chaleur humaine. Dans tous les cas, il lui resterait encore l’amitié sans borne que lui voue son frère ; l’amour sans limites qu’il éprouve pour sa fille. Toujours, il tentera de briser sa solitude ; il cherchera à établir l’impossible contact.
Carné est indiscutablement solitaire. Il semble avoir renoncé à établir tout contact humain. Sa timidité lui rend plus difficile qu’à d’autres les avances qu’il faut faire à l’amitié ; et la moindre fausse note le fait se rétracter, se retrancher derrière une mauvaise humeur dirigée autant contre lui-même, que contre le maladroit.
C’est pourquoi on voit peu Carné se mêler aux manifestations officielles ou à la vie mondaine du Tout-Paris. Il se tient assez éloigné de l’agitation en vase clos des ciné-clubs, il milite peu dans la vie syndicale ; et s’il associe, parfois, son nom à des manifestations collectives, c’est plus par obligations professionnelles, que dans l’espoir d’y trouver un contact humain. Dans cette profession où tout le monde se tutoie et se tape sur le ventre, Marcel Carné reste à l’écart, isolé, solitaire…
Je sais tout ce que ces quelques pages ont de schématique et d’insuffisant. Elles ne visent pas à épuiser le sujet, mais se proposent, bien plutôt, d’attirer l’attention sur lui. Je me serais pourtant bien mal exprimé, si elles permettaient d’entendre que je crois à une incompatibilité de pensée entre Marcel Carné et Jacques Prévert. Je ne doute pas que ces deux hommes ne soient unis par des attaches solides, dont une commune tournure politique de l’esprit et une sensibilité poétique parente, en face de certains mythes modernes, ne sont pas les moindres.
Peut-être, même, fut-il à un moment nécessaire que la rigueur de l’un s’enrichisse de la truculence de l’autre ; et que la démesure de l’autre se plie au classicisme de l’un. Je dis, seulement, qu’il est peut-être bon que se soit séparée cette équipe qui a donné ses meilleures oeuvres, qui ne vivait plus que de compromis et de concessions mutuelles ; et dont la prolongation eût sans doute empêché le talent de l’un et de l’autre équipier de se renouveler, pour s’étendre dans un domaine qui lui soit propre. Carné et Prévert sont séparés — peut-être provisoirement — je suis persuadé que ni Prévert, ni Carné, ni même le cinéma n’ont à redouter cette séparation.
(1) Que le directeur de la photographie s’appelle Hubert, Schufftan, Tirard, Courant, Agostini ou Alekan, on trouve dans tous les films de Carné un style identique de la photographie, parce qu’il y a un « style Carné », comme il y a un « style Orson Welles », qu’une seule image extraite d’un de leurs films permet de reconnaître.
(2) Carné m’a souvent déclaré et avec quelle force ! pour m’expliquer sa nécessité de rigueur et d’ascétisme, qu’il avait Victor Hugo en horreur. Il est possible que Jacques Prévert professe, lui aussi, le mépris d’un poète dont il est très proche par l’esprit, malgré les apparences ; mais si cela est, ce ne peut être pour les mêmes raisons que Carné.
5b – JULIETTE OU LA CLEF DE CARNÉ
Avec La Marie du Port, Marcel Carné achevait, en le fermant ce que j’appellerai son premier cycle.
On attendait avec impatience — et, en ce qui me concerne, avec inquiétude — le « prochain Carné ».
Le « prochain Carné », c’est Juliette ou la Clef des Songes.
Sachant qu’il s’agit là d’un ancien projet que les circonstances empêchèrent de réaliser, on pouvait se demander si Juliette prouverait vraiment quelque chose ; si ce film ne semblerait pas être un retour en arrière, plutôt qu’un nouveau point de départ. Mais Carné a entièrement transformé le scénario de jadis et, s’il reste peu de chose de la pièce de Neveux, dont le film est, en principe, tiré, il ne reste plus rien de l’adaptation à laquelle travailla Jean Cocteau en 1941. C’est bien d’un nouveau film qu’il s’agit, et dont on peut tirer de nombreux enseignements.
Dans sa prison, un jeune homme, Michel, s’évade par le rêve… Au Pays de l’Oubli, qu’il visite en dormant, il rencontre la jeune fille qu’il aime. Celle-ci écoute ses paroles d’amour et lui fait de belles promesses qu’elle oublie aussitôt — puisqu’elle est de ce pays où les habitants n’ont plus de mémoire — pour se laisser enlever par le Seigneur du village. De retour dans la réalité, Michel apprend que la jeune fille n’a pas été plus constante que dans son rêve et qu’elle épouse son patron. Après une dernière explication avec la jeune fille, Michel repart vers le Pays sans Souvenir et sans Nom.
Si j’ai tenu, contrairement à mes habitudes, à évoquer la trame sur laquelle Carné a brodé son dernier film, c’est que je la pense suffisante pour indiquer déjà les points essentiels sur lesquels Carné a évolué et ceux qu’il a conservés intacts.
Juliette ou la Clef des Songes est écrit sur pellicule, sensiblement dans le même style cinématographique que les oeuvres antérieures de Marcel Carné, avec le même souci de sobriété, (Carné a supprimé impitoyablement, tout ce que Cocteau avait introduit dans l’adaptation de miroirs magiques, de forêts enchantées et de statues vivantes), la même perfection plastique (aucun film de Carné ne présente, avec la même continuité que Juliette, cette splendeur des images qui suffirait, déjà, à faire de cette oeuvre une grande réussite) ainsi que le même attachement aux grands décors qui, restituant la réalité avec un imperceptible décalage, donnent à son oeuvre cette si particulière atmosphère, à cheval sur le vrai et sur le faux (1).
On y retrouve aussi certains procédés techniques. Les séquences s’enchaînent sans « fondus », sans « volet », que Carné considère sans doute comme des truquages, ou comme des bavures, qu’il s’interdit, dans son goût de la netteté. Les scènes se succèdent, exclusivement enchaînées les unes aux autres par un mouvement plastique ou un rythme sonore qui se continuent ou s’opposent.
Carné a horreur des mouvement d’appareils gratuits.
Même un panoramique descriptif, un travelling qui nous fait passer d’un endroit à un autre doivent trouver leur justification. C’est pourquoi il se servira d’un personnage ou d’un objet qui, en se déplaçant entraînera l’appareil avec lui et lui permettra d’accomplir le mouvement désiré. Dans Le Jour se Lève, l’appareil est entraîné par une voiture, bascule et découvre la place d’Amiens; dans L’Hôtel du Nord, pour aller d’un groupe à un autre, l’appareil saisit un figurant qui passe devant le premier groupe, le suit en panoramiquant et ne le lâche que lorsqu’il a dépassé le second groupe. De même dans Juliette, l’appareil panoramique pour suivre un vieux paysan qui traverse la place avec son âne et nous décrit la place du même mouvement. Pareillement, il cherche le légionnaire dans la foule des danseurs, le trouve, le suit et, avec lui, découvre la fête dans la forêt.
Mieux encore : il va, dans Juliette jusqu’à conserver certaines figures de style déjà vues dans ses films précédents. Je pense surtout au travelling le long du mur, quand Michel fuit Juliette, la mort dans l’âme et la résolution au coeur ; travelling qu’on ne peut s’empêcher de comparer à celui, à peu près identique, de Diégo à la sortie de l’hôpital, dans la dernière séquence des Portes de la Nuit.
Juliette ou la Clef des Songes est construit suivant une architecture rigoureuse.
Si le film peut dérouter au début, il n’est aucune énigme qu’il pose, qui ne soit résolue quand il s’achève. Nous découvrons progressivement le caractère merveilleux du pays où arrive Michel : c’est d’abord la petite fille qui ne sait pas le nom du village ; puis la gardienne de chèvres qui reste silencieuse ; puis le notaire et sa réponse troublante, l’horloge sans aiguilles, l’homme perdu dans les éphémérides du calendrier, les deux commères qui se disent bonjour sans arrêt et l’une d’elle qui prend Michel pour son mari ; etc. etc.
Nous sommes prévenus, et quand Michel fera appeler Juliette par le tambour du garde-champêtre, nous n’offrirons plus guère de résistance. Chaque personnage du rêve : Barbe-Bleue ou le policier, Juliette ou le Père la Jeunesse, ont leur correspondant dans la vie : le patron de Michel ou le juge d’instruction ; Juliette ou le greffier. Mais ce n’est qu’à la fin du film quand Michel ne rêve plus, que le subterfuge nous est révélé et que les personnages oniriques prennent toute leur signification. Dans ce film au mécanisme minutieux, Carné constate d’abord ; met ensuite l’explication sur notre route ; mais laisse au spectateur le soin de comprendre par lui-même. Si Juliette satisfait l’intelligence, c’est qu’elle y fait appel autant qu’à l’émotion.
Les films de Carné suivent généralement un rythme lent et uniforme. Juliette ou la Clef des Songes est rythmé avec autant de sûreté et sans doute plus de vigueur que les précédents. Après le prologue dans la prison, le rêve commence, large et lent. A mesure que l’angoisse des personnages se fait jour, son rythme se resserre, s’accélère. C’est la double action de Juliette enlevée par Barbe-Bleue, d’une part, et de Michel à la recherche de Juliette, d’autre part, qui, en se confondant en une seule, fait atteindre au film son premier sommet : Barbe-Bleue jette la statue à terre et la fête éclate (c’est une des liaisons les mieux réussies du film). Puis, le rythme s’apaise progressivement pour retrouver presque la lenteur du début pendant la scène d’amour dans la forêt. Mais la nouvelle intervention de Barbe-Bleue permet la reprise brutale du rythme accéléré, qui ne va plus nous laisser un instant de repos et conduira le film dans la fièvre du cauchemar jusqu’à son deuxième sommet : la confession publique de Michel. La sonnerie du réveil jouera le même rôle de liaison que la statue brisée et nous ramènera au rythme cahotant de la vie quotidienne. Enfin la dernière séquence ralentira petit à petit le rythme du film et lui fera retrouver l’ampleur majestueuse des oeuvres précédentes de Carné avec la marche résolue et calme de Michel sur le chemin des oliviers, vers le Pays de l’Oubli…
Quelques personnages épisodiques traversent Juliette pour affirmer la fidélité de Marcel Carné à certains mythes. Le légionnaire n’est pas sans évoquer le soldat de la coloniale qui déambulait sur le quai des brumes. Le joueur d’accordéon, surtout, fait penser à certains personnages qui fréquentaient la cabane de Panama ou rôdaient aux portes de la nuit. Il est le seul au village à être à peu près lucide, le seul à avoir conservé un peu de mémoire. Meneur de jeu symbolique, il traverse la route de Michel chaque fois que celui-ci se trouve à un tournant de sa destinée.
Il serait toutefois excessif de vouloir en faire une représentation du Destin. Il conseille Michel mais ne le fait pas agir. Il se trouve là quand la vie change pour le jeune homme, mais ce n’est pas lui qui la fait changer. Il est un témoin, non un protagoniste du drame.
Mais la survivance la plus importante de l’oeuvre antérieure de Carné dans Juliette ou la Clef des Songes, est, sans aucun doute, celle du thème de la solitude.
Comme Le Quai des Brumes ou Le Jour se lève, Juliette est un film à un seul personnage.
Nous voyons Michel chercher Juliette pour mettre un terme à sa solitude, la trouver, mais demeurer seul et finalement repartir seul. (Même pendant la scène d’amour, magnifique et atroce, Michel est seul en face de Juliette qui refuse le passé qu’il lui propose, pour conserver celui qu’elle s’est construit à la mesure de son ambition et de sa futilité). Les autres personnages, et Juliette elle-même n’existent qu’en fonction de l’effort de Michel pour se libérer de sa solitude, soit qu’ils l’aident, soit qu’ils le contrarient ou simplement le traversent.
Donc Michel cherche à s’évader, comme les autres héros de Carné.
Mais alors que ceux-ci étaient emprisonnés dans leur passé, retenus par leur présent, et cherchaient à se libérer dans l’avenir, c’est par l’évocation d’un passé tout proche que tente de s’évader Michel. Il ignore l’avenir, il dédaigne le présent. Dès qu’il retrouve Juliette, c’est pour faire revivre leur passé commun, reprendre la vie là où il l’avait laissée, et faire avec elle le fameux voyage à la mer. De retour dans la vie réelle c’est encore son passé qu’il recherchera et c’est pour retrouver son rêve là où il l’avait également laissé, qu’il ouvrira la porte où s’inscrit le mot Danger. Car, dans Juliette, Carné offre une porte de sortie à son héros, peu importe si elle ouvre sur la Mort.
Dans La Marie du Port, plus encore que dans tout autre film, parce que réalisé dans un climat de prudence qu’expliquent les circonstances intimes qui présidèrent à sa réalisation, Marcel Carné avait soigné son travail avec excès, polissant toutes les aspérités au risque de supprimer les reliefs. Et voilà que dans Juliette ou la Clef des Songes, Carné fait soudain preuve d’une audace, d’une liberté dans l’expression qui étonnent et ravissent. On se demande si l’obligation où il se trouvait jusqu’à présent, d’endiguer le génie débordant de Prévert, ne le conduisait pas à se guinder lui-même. Le rot sonore et incongru que lâche Barbe-Bleue dans la boutique de la confiseuse, est une de ces fautes de goût merveilleuses que Carné ne se serait jamais consenti auparavant, et qui manifeste une assurance, une confiance en lui auxquelles il ne nous avait pas habitués.
Cette confiance, cette libération font sentir leur effet davantage encore en profondeur. La symbolique de Carné s’était jusque là exprimée avec une certaine prudence, contrainte par la vraisemblance et un réalisme apparent. Sans avoir rien abdiqué de sa rigueur (ce qu’il y a de merveilleux dans Juliette, c’est la liberté du style et sa nécessité), Marcel Carné s’est libéré de la vraisemblance et des explications qu’elle exige. C’est pourquoi il ne cherche plus à justifier les entorses au vraisemblable, par on ne sait trop quelle sorcellerie, comme il le fit pour Les Visiteurs du Soir. Il pose les choses telles qu’il veut qu’elles soient, sans davantage les expliquer. Dans ce pays les gens n’ont pas de mémoire, voilà ! De l’autre côté de la porte il y a le Pays sans Souvenir, c’est comme ça ! Presque sur le ton indifférent du fait-divers, un peu à la manière de Marcel Aymé. Dans Juliette ou la Clef des Songes, Carné ne se réfugie plus dans une diablerie anachronique : il serre de près le fantastique moderne, celui de Kafka, voire celui de Michaux (2).
Mais s’il y a une liberté nouvelle de Marcel Carné, il y a aussi une liberté de ses personnages. Dans Juliette il n’y a plus de Destin, plus de Fatalité, plus de Force Supérieure consciente et organisée, qui dirige les hommes comme des pions et les fait agir ainsi qu’elle l’entend. Les habitants du Pays de l’Oubli sont étrangement libres, puisque libérés des liens du passé, je le répète. Ils sont aussi étrangement seuls. Chaque fois qu’ils cherchent à connaître leur passé, donc à rompre leur solitude, comme le légionnaire qui tend sa main au diseur de bonne aventure, ils perdent un peu de leur liberté. C’est elle qui sépare les hommes, les empêche d’être vraiment solidaires. Ces personnages libres ne sont soumis qu’à l’arbitraire du hasard, c’est-à-dire à la dictature de l’absurde. C’est dans leur incompréhension mutuelle, comme dans l’incompréhension de leur propre vie qu’ils rejoignent les héros de Kafka.
Jean Genêt reproche à Jacques Prévert d’ignorer la cruauté. Sans doute est-ce sous l’influence de Prévert que Carné lui avait jusque là fermé les portes de son oeuvre. Dans Juliette, avec une force accumulée depuis longtemps, la cruauté explose à chaque scène et révèle chez Carné un masochiste, qui ne nous surprend guère ; mais aussi un sadique que nous ne connaissions pas.
Barbe-Bleue n’est pas un assassin aveuglé de jalousie, comme Zabel ; ni un criminel par idéologie, comme Lacenaire ; pas même, comme William Kramps qui tuait les bouchers par amour des bêtes, un tueur sentimental. Barbe-Bleue est un sadique fétichiste qui vit au milieu de ses chiens, tue les femmes qu’il épouse (ou, plus exactement, épouse les femmes qu’il veut tuer), conserve dans un placard leur dernière robe tachée de sang ; cherche quel personnage célèbre il fut, et faute de le trouver, s’affirme par la terreur et le luxe. C’est un véritable gibier de psychanalyse. Mais Michel n’est pas le docteur Freud ; il n’écarte pas le danger qui pèse sur Juliette, il ne libère pas Barbe-Bleue de sa névrose en criant sa véritable identité, parce qu’il serait trop simple de révéler son passé à un homme dans un seul cri. On le voit, délibérément le personnage de Barbe-Bleue a été placé là par Carné pour assumer la cruauté de l’irresponsable, sur le plan physique.
Il est à remarquer également que, jusque là, les femmes avaient été, dans les films de Carné et Prévert, des personnages quasi-irréels, sorte de merveilleuses fées distribuant leurs bienfaits aux hommes. Déjà, La Marie du Port avait curieusement contrebattu ce mythe Prévertien de la femme sans défaut. Marie se révélait comme une petite garce, en particulier au cours de cette scène étonnante dans le bureau de Chatelard, où elle jouait le jeu équivoque et cruel de la séduction en une sorte de danse savante par laquelle elle envoûtait littéralement Chatelard sans rien livrer d’elle-même.
Dans Juliette, non seulement Barbe-Bleue est un personnage cruel comme Marie était une jeune fille cruelle, mais Carné cherche, en plus, à endosser la cruauté à son propre compte. C’est ainsi qu’il révélera à travers le personnage de Juliette, sur lequel il s’acharne particulièrement, une misogynie féroce. Juliette est une jeune fille innocente. Il n’y a aucune méchanceté en elle. Ce jeune homme qui vient à la portière de sa voiture, bien sûr qu’elle n’est pas fâchée contre lui ; elle le trouve même charmant. Ce n’est pas sa faute si elle ne se souvient pas qu’un instant auparavant elle lui faisait des serments d’amour passionné. Quand Michel vient faire une scène chez elle parce qu’elle épouse son patron, elle le trouve stupide et parfaitement injuste ; en somme c’est elle qui souffre le plus et qui se montre la plus courageuse : ne sacrifie-t-elle point son amour, cet amour impossible avec un garçon sans argent ?
Juliette n’est pas un être mauvais. Pas de calculs ni d’arrière-pensée chez elle : elle est toujours parfaitement sincère. Sans doute est-elle un peu coquette, un peu futile, mais ce sont là de charmants défauts de jeune fille. Ce sont précisément ces « charmants défauts de jeune fille » que Carné ne peut supporter, qu’il reproche à Juliette et qui le font s’acharner sur elle avec une telle cruauté. Inconséquente, légère, coquette, incapable de sauver un homme de lui-même, telle est la jeune Juliette, soucieuse seulement de savoir si elle est jolie, si elle est aimée, si elle est riche ; délicieuse et horripilante, redoutable à force d’inconséquence.
Juliette ou la Clef des Songes est joué comme le sont rarement les films français, mais très souvent les films de Carné. C’est-à-dire que la moindre des silhouettes, le plus lointain des figurants est aussi à sa place que le premier rôle ; sans jamais parler faux, ni gesticuler de travers. Yves Robert donne du joueur d’accordéon une image précise et nette en même temps que chargée de poésie. Gérard Philipe n’est plus une révélation, mais il se montre digne de lui-même dans le rôle de Michel. Les véritables révélations du film sont Suzanne Cloutier dans le rôle très périlleux de Juliette (sans elle, Carné aurait-il pu faire le film ?) qu’elle traverse sur la corde raide sans un faux pas et Jean-Roger Caussimon qui fait de Barbe-Bleue une composition d’un pittoresque et d’une solidité qui le rapprochent d’un Michel Simon, de vingt ans plus jeune. Il n’est pas jusqu’à un presque débutant, Roland Lesaffre, qui, dans le rôle assez court du légionnaire, crève un court instant l’écran.
Après Juliette ou la Clef des Songes qui a la complexité et l’authenticité des chefs-d’oeuvre, je pense que l’heure est venue pour Marcel Carné de nous montrer qu’il est assez grand pour réaliser enfin des films seul.
(1) Le décor de la forêt dans lequel fut tourné un tiers du film, demeurera sans doute, dans les annales du cinéma comme un exemple de la hardiesse récompensée. Tous les arbres de cette forêt à la Raspoutine étaient montés sur roulettes et maintenus par des palans à leur extrémité supérieure, ce qui permettait, en brouillant leur ordre comme un jeu de cartes, de donner différents aspects de ce bois merveilleux. Réussite artistique indiscutable ce décor, qui permit à Carné des effets de lumière impossibles en extérieur, fut aussi une heureuse manoeuvre financière. En effet, au prix des journées de tournage en extérieur, et compte tenu de l’été pourri pendant lequel on tourna le film, le prix du décor fut vite amorti. Marcel Carné a toujours pensé que, quel que soit son prix, un décor d’importance est plus économique qu’un extérieur. Sa fâcheuse expérience de La Fleur de l’Age est là pour nous montrer qu’il a raison.
(2) Carné, on le sait, voulut tourner Le Château de Kafka. Faute d’avoir pu le réaliser, il le fit un peu par la bande dans Juliette. Ce château désert avec ses souterrains interminables, l’arrestation sans raison de Michel, l’interrogatoire brutal et parodique que lui fait subir le policier font bien partie de l’univers de Kafka, rigoureux et arbitraire, absurde à force de logique.
5c – MARCEL CARNÉ ET LE CINÉMA
Nous venons de voir quelle fut, jusqu’à ce jour la carrière de Marcel Carné. Après des débuts difficiles, il a construit son oeuvre, rigoureuse et sévère, avec une intransigeance qui ne connaît pas les concessions. C’est que Carné considère le cinéma non comme un commerce fructueux ni un exercice de virtuosité, mais comme un art, c’est-à-dire un moyen de communiquer et un instrument de connaissance humaine.
De Jenny aux Portes de la Nuit, Marcel Carné a été tout droit dans une direction, aussi loin qu’on peut aller. Il exprima le tragique de notre temps dans une forme très proche de la tragédie antique et plus encore de la tragédie racinienne, avec un sens de la fatalité et de l’absurde qui, parmi les contemporains, l’apparente à Kafka. Il introduisit au cinéma une réalité au-dessus de la réalité, une véritable surréalité qui n’a pas besoin de la justification de la fantaisie ou du scandale, mais qui, efficace et discrète, ne se laisse appréhender que par un sixième sens qui doit bien être le sens du cinéma.
Il utilisa, avant que Jean Cocteau n’en parle, un statisme cinématographique qui montra que le cinéma n’était pas seulement un art dynamique condamné aux cavalcades échevelées et aux poursuites frénétiques à perpétuité, mais qu’on pouvait lui confier les tâches les plus délicates comme les plus redoutables.
Ne pouvant plus progresser dans cette direction, Marcel Carné sentit le danger d’un style qui menaçait de tourner au poncif et dont il risquait d’être prisonnier. Ne voulant pas ajouter à ses films des films par lesquels il ne pourrait que se survivre, il liquida son fonds et acheva le premier cycle de son oeuvre avec La Marie du Port.
Dans Juliette ou la Clef des Songes, Carné prend un nouveau départ, avec une liberté de style et d’intention qu’il n’avait jamais eue. Il est trop tôt pour dire dans quelle direction va le porter cette seconde manière. Tout ce qu’on peut avancer c’est qu’il a devant lui une carrière nouvelle pleine de promesses et de difficultés. Sans doute allons-nous le voir chercher dans des directions différentes — et même, peut-être, revenir à ses premières amours — et essayer plusieurs voies pour trouver la sienne propre. C’est dans cette douloureuse confrontation avec lui-même où il devra tout remettre en question à chaque nouveau film, que Marcel Carné trouvera sa sincérité. Il a, plus que beaucoup d’autres, le sentiment de la solitude et le moyen de l’exprimer (1). Aussi devrait-il pouvoir s’attaquer à un grand sujet sans se retrancher derrière un fait divers ou une affabulation. Pourquoi pas, un jour, un Byrd au Pôle ou une Vie du colonel Lawrence, par Marcel Carné ?
Mais ces films-là, Carné ne les tournera jamais, parce que le cinéma ne le lui permettra pas. Le cinéma est un art impossible pour des raisons multiples dont certaines sont inséparables de sa nature même :
Le cinéma est un art impossible parce qu’il est soumis à trop d’impondérables.
Le romancier donne à ses personnages le visage et les intonations qu’il veut, il les fait évoluer dans un cadre qu’il a créé ou arbitrairement choisi. Le réalisateur, sauf hasard trop improbable pour qu’il en tienne compte, ne peut pas trouver les acteurs qui coïncident exactement avec ses personnages. Faute d’acteurs qui puissent entrer dans la peau de personnages donnés, il est tenté d’en écrire sur mesure pour des acteurs donnés et sa liberté d’expression se trouve réduite d’autant. Carné a dû, plusieurs fois, abandonner des projets faute de pouvoir réunir la distribution adéquate. Lors qu’il s’obstina, le résultat ne fut pas bon : c’est ainsi que Les Portes de la Nuit furent faussées par un changement d’acteurs de la dernière minute et en partie gâchées par la mauvaise interprétation de Nathalie Nattier. Pareillement, l’esprit de La Marie du Port fut légèrement gauchi par la fatigue de Jean Gabin.
De plus le réalisateur ne peut toujours être un homme universel et il doit bien déléguer certains de ses pouvoirs à un compositeur, un décorateur, un dialoguiste ou un chef-opérateur. Il est certain qu’il ne peut obtenir de ces hommes exactement ce qu’il veut ou ce qu’il rêve, aussi harmonieuse que soit l’équipe qu’il dirige. Quelle que soit la miraculeuse conformité des décors de Trauner à ceux que Carné peut rêver, elle ne suffit pas à contre-balancer les concessions réciproques que durent se consentir Carné et Prévert. Ne parlons que pour mémoire, tellement elles sont évidentes, des surprises rarement heureuses que réservent les défauts de pellicule, les enregistrements sonores sur des appareils défectueux ou des copies contre-typées où se trouve bouleversée toute l’échelle des valeurs plastiques. Mais tous ces hasards auxquels est soumis le cinéma ne sont guère — à peine aggravées — que les contraintes et les conventions que les autres arts ont réussi à surmonter.
Mais il y a pire.
Le cinéma est un art impossible parce qu’il est une arme de propagande.
Parce qu’un film est vu par des millions de spectateurs et qu’il a une force de persuasion considérable, chacun a voulu mettre le cinéma au service de son dieu et, ce qui est plus grave, empêcher les autres de le mettre au service du leur. Car le cinéma vit sous le régime du sectarisme et de la censure, que ce soit la censure gouvernementale — qui n’est pas toujours la pire — celles des clubs de femmes, des partis politiques ou des religions puritaines.
Le cinéma est écartelé entre les dictatures de droite et les dictatures de gauche, celles des partis catholiques et celles des religions communistes.
L’Île des Enfants Perdus fut interdite la première fois que Carné voulu tourner le film et des personnages politiques influents intervinrent pour torpiller La Fleur de l’Age qui reprenait, sous un autre titre le violent réquisitoire contre certains abus. Les journaux de droite firent longtemps campagne contre Carné et triomphèrent un moment sous l’occupation. Ce sont leurs successeurs qui orchestrèrent joyeusement les manifestations « spontanées » qui tentèrent d’interrompre la carrière des Portes de la Nuit (aujourd’hui encore, Pathé, sous l’influence de certaines puissances capitalistes, refuse de rééditer Les Portes, malgré la demande de Carné qui consentirait même quelques coupures).
Quoiqu’on en pense la contrainte morale n’a jamais favorisé la liberté intellectuelle : Racine vaincu par la cabale et réduit au silence après Phèdre, les arts réduits à l’impuissance par Napoléon ou Sade ou Van Gogh, les artistes maudits, les artistes morts-nés, les artistes assassinés s’élèvent en faux contre ce lieu commun.
En ce qui concerne le cinéma, la liberté est plus indispensable encore, parce qu’on ne peut guère, sauf par accident, tourner clandestinement. Or quel est le pays, à l’heure actuelle, où n’importe qui puisse tourner n’importe quoi ? Sans parler des pays de l’autre côté du rideau de fer, croyez-vous que la censure autoriserait un film non-conformiste en Amérique, en Italie ou en Angleterre encore moins en France, dans la belle dictature de la pagaie où se débat le cinéma ?
Le cinéma est un art impossible parce que c’est aussi une industrie et que les gens qui mettent de l’argent dans une affaire entendent que leurs capitaux rapportent le plus possible, le plus rapidement possible. On ne saurait reprocher aux producteurs de n’être, ni des philanthropes, ni des mécènes. Ce n’est pas leur rôle. Ce qu’on peut déplorer, par contre, c’est que le cinéma soit devenu une entreprise onéreuse, et, surtout, si aventureuse, parce qu’à partir d’un certain prix (et d’un prix très bas!) un film n’est plus amortissable en France. Cela vient de ce que les gens ne vont pas assez au cinéma et cela dans le monde entier (le cinéma anglais traverse une crise au moins aussi grave que la nôtre et des difficultés du même ordre se font sentir jusqu’à Hollywood). La véritable crise du cinéma — compte tenu de la crise économique générale — c’est une crise de public.
Le fait est là ; le public qui a divorcé avec la littérature, la peinture et la musique, est en instance de divorce avec le cinéma. Les romans populaires, les chromos et les chansonnettes n’ont pas sauvé la littérature, la peinture ou la musique, les Coeur-sur-mer, les Porteuse de pain, les Caroline Chérie ne sauveront pas davantage l’art du cinéma, s’ils permettent à l’industrie cinématographique de survivre.
Loin de s’améliorer, cette situation s’aggrave chaque jour, rendant la création cinématographique de plus en plus précaire. Un réalisateur ne peut tracer tout droit sa voie, il lui faut abandonner des projets et les reprendre quand l’occasion s’en présente, même s’ils sont très anciens et ne répondent plus pour lui à une nécessité intime. Il doit faire sa route, louvoyer, marcher en zig-zag au risque d’incohérence. Ou mourir.
De moins en moins un cinéaste peut tourner comme il l’entend. Carné lui-même, dans Juliette ou la Clef des Songes, dut, plusieurs fois, mettre les pouces ; ne pas recommencer, comme il en avait le désir, certains plans de la forêt qui ne le satisfaisaient pas pleinement, renoncer à tourner la fin exactement telle qu’il l’envisageait et faire des acrobaties de raccords et de montage pour obtenir une dernière séquence qui lui convienne en partie !
Juste au moment où il entrait en possession d’un langage lentement élaboré et qui lui soit propre ; à peine arrivé à l’âge d’homme, le cinéma est dangereusement menacé.
Que sont devenus Eric von Stroheim, Orson Welles, Jean Renoir ?
Durant ces dernières années combien King Vidor, Flaherty, Dreyer ont-ils tourné de films ? Combien, Clair, Carné, Bresson, Autant-Lara, Clouzot, Becker, tournent-ils de films par an ? Combien d’oeuvres de qualité sont-elles sorties cette année en France ? Combien de mises en chantier ?
Certes, il y aura toujours des salles de cinéma. On y projettera toujours de la pellicule impressionnée, devant un public qui ne réagira plus et viendra là, seulement pour chercher sa provision hebdomadaire d’émotion à bon marché. Mais le cinéma ne sera-t-il bientôt plus qu’un distributeur automatique de rires ou de larmes où chacun viendra acheter pour cent ou deux cents francs d’émotion comme il acquiert des boites de conserve ou des légumes secs ? Le cinéma deviendra-t-il exclusivement une industrie fort bien comprise, où le travail se fera à la chaîne, dans les meilleures conditions de rendement et d’asepsie ?
Le cinéma va-t-il mourir ?
Je crains qu’un avenir proche ne se charge de répondre pour moi à ces questions et que nous n’assistions actuellement à la fin d’un art que nous avons aimé avec passion parce qu’il exprimait nos passions avec art et que nous défendrons jusqu’à la fin bien que, à l’égal des héros de Carné, nous sachions le combat perdu d’avance.
A moins que…
(1) Chaplin, lui aussi, a le sentiment de la solitude farouche où l’a contraint l’hostilité de l’Amérique, mais c’est avec des moyens beaucoup plus mélodramatiques qu’il l’exprime.