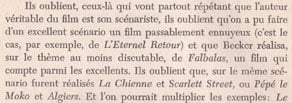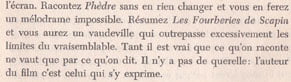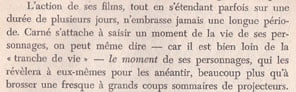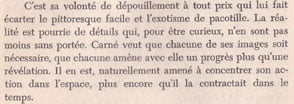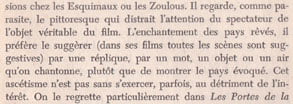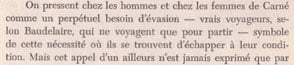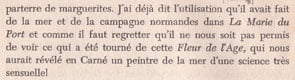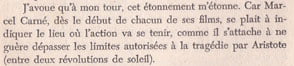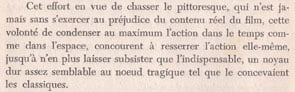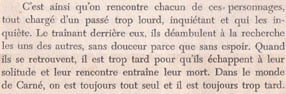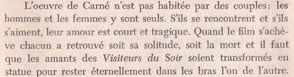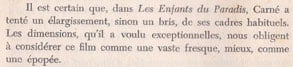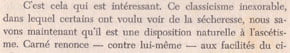BERNARD – G. LANDRY présente MARCEL CARNÉ
– Avec l’aimable autorisation de Bernard-G Landry –
Chapitre III – A LA RECHERCHE DES TROIS UNITÉS
Vous pouvez accéder directement aux sous-chapitres suivants en cliquant dessus :
3a – EN UNE RÉVOLUTION DE SOLEIL…
3b – DANS UN SEUL LIEU
3c – UNE ACTION UNIQUE
3d – UNE EXCEPTION QUI, DE NE PAS L’ÊTRE, CONFIRME
3a – EN UNE RÉVOLUTION DE SOLEIL…
L’action d’un film, en général, se disperse sur une longue durée dramatique, heureux encore quand elle ne tente pas d’embrasser l’existence de plusieurs générations, voire l’écoulement de plusieurs siècles. Ces Cavalcade, ces Perles de la Couronne, ces Untel Père et Fils reçoivent presque toujours un accueil chaleureux du public. Pour peu qu’on mêle quelques jolies filles, un peu déshabillées, à ce music-hall plus ou moins historique, on obtient un triomphe. Nous sommes assez loin du cinéma et qui emploie ce procédé aussi facile, hélas! qu’apprécié, montre un beau mépris de son art.
Curieux art, en vérité! Ceux qui devraient s’en montrer les plus fervents défenseurs se contentent de le traiter avec condescendance, quand ils ne le qualifient pas d’art mineur dans des discours officiels et académiques. C’est la position de ceux qui le considèrent surtout comme un sous-produit du théâtre. A leurs yeux, le cinéma est un mécène trop riche pour être intelligent et qui ne peut que mettre au service du théâtre ses moyens somptueux. De là vient le désir d’en faire un art du verbe — sinon du bavardage — où l’image n’est qu’un commentaire visuel dont, même, on pourrait se passer. Et ils rêvent de quelque film idéal à lire, ou à entendre à la radio.
Ils oublient, ceux-là qui vont partout répétant que l’auteur véritable du film est son scénariste, ils oublient qu’on a pu faire d’un excellent scénario un film passablement ennuyeux (c’est le cas, par exemple, de L’Eternel Retour) et que Becker réalisa, sur le thème au moins discutable, de Falbalas, un film qui compte parmi les excellents. Ils oublient que, sur le même scénario furent réalisés La Chienne et Scarlett Street, ou Pépé le Moko et Algiers. Et l’on pourrait multiplier les exemples : Le Pays sans Etoiles, réussi par Véry et manqué par Lacombe; « Les Portes de la Nuit » manquées par Prévert et réussies par Carné, etc…
Il s’agit là, je le sais, d’une vieille querelle presqu’aussi vieille que le cinéma ; mais aussi d’une mauvaise querelle soigneusement entretenue par les scénaristes, quand ce ne serait que parce qu’elle les absout des échecs et leur permet de revendiquer les succès. En vérité il n’y a pas de querelle d’auteur au cinéma, car, contrairement à ce que pensent certains, l’histoire ne compte pas au cinéma. « Toutes les histoires sont bêtes à l’écran », disait Jean Epstein en 1921 dans Bonjour Cinéma. Toutes les histoires sont bêtes et pas seulement à l’écran. Racontez Phèdre sans en rien changer et vous en ferez un mélodrame impossible. Résumez Les Fourberies de Scapin et vous aurez un vaudeville qui outrepasse excessivement les limites du vraisemblable. Tant il est vrai que ce qu’on raconte ne vaut que par ce qu’on dit. Il n’y a pas de querelle : l’auteur du film c’est celui qui s’y exprime.
Carné obéit toujours à la bonne vieille règle des trois unités. Il n’y met heureusement pas le zèle maladroit du converti. Il sait prendre quelques libertés avec la vieille dame. Il lui arrive de la rudoyer, même de lui manquer de respect.
L’action de ses films, tout en s’étendant parfois sur une durée de plusieurs jours, n’embrasse jamais une longue période. Carné s’attache à saisir un moment de la vie de ses personnages, on peut même dire — car il est bien loin de la « tranche de vie » — le moment de ses personnages, qui les révélera à eux-mêmes pour les anéantir, beaucoup plus qu’à brosser une fresque à grands coups sommaires de projecteurs.
On ne trouve jamais dans l’oeuvre de Carné, pas plus que dans celle de Racine, des situations à longs développements, ni à lentes évolutions psychologiques.
S’il fallait assimiler les films de Carné à un genre littéraire, on pourrait dire qu’ils sont plus proches de la nouvelle que du roman, de la tragédie classique que du drame romantique.
C’est ce qui explique que leur durée dramatique soit réduite au strict minimum, jusqu’à ne plus contenir qu’un seul jour dans Le Jour se Lève, ou une seule nuit dans Les Portes de la Nuit. Ce dernier film, si controversé, prend d’ailleurs une importance prépondérante dans l’oeuvre de Carné. On peut le considérer comme l’épanouissement de la « manière Carné » et certainement comme le chef-d’oeuvre du réalisateur. On comprend qu’après ce film, Carné ait éprouvé le besoin de se renouveler, car il était difficile d’aller plus loin dans cette direction, à cheval sur le réalisme et l’expressionnisme. La Marie du Port, plus qu’une marche arrière, est une liquidation d’un mythe envahissant.
Mais en dehors de ces deux films particulièrement significatifs (Le Jour se lève et Les Portes de la Nuit) on remarquera dans tous les autres films de Carné cette même tendance, ce même désir de resserrer au maximum l’action dans le temps.
S’il tourne des adaptations de roman, le film s’écartera délibérément du roman. Il paraîtra inspiré par l’oeuvre littéraire plutôt qu’adapté d’elle et les libertés prises avec l’oeuvre originale iront toutes dans le même sens : réduire la durée dramatique de l’oeuvre, la concentrer pour atteindre à une densité et à une violence maxima.
Dans Le Quai des Brumes, Mac Orlan suivait ses personnages depuis leur rencontre à Montmartre, au « Lapin Agile », jusqu’à leur mort ou leur lente absorption par la vie quotidienne. Dans le film, Jean (1) arrive au Havre, suintant des brouillards de l’aube et, le lendemain, il est tué aux dernières lueurs du crépuscule.
Hôtel du Nord de Dabit racontait la vie de l’hôtel jusqu’à sa démolition. Les adaptateurs ont choisi un « moment » de son existence. Et l’action se déroule en quelques jours, qui suffisent à tout nous apprendre sur la vie de l’hôtel et les habitudes de ses locataires.
Que l’adaptation soit signée Aurenche et Jeanson ou Jacques Prévert, c’est toujours vers le même but que tendent les efforts : resserrer l’action dans le temps, et aussi dans l’espace.
Drôle de Drame ne déroule son intrigue compliquée que sur un nombre relativement restreint de jours.
Dans Les Visiteurs du Soir, il suffit d’un très bref séjour des voyageurs infernaux pour troubler les fêtes et bouleverser les amours. Ils se présentent à la poterne du château, montés sur leurs chevaux noirs et, à peine quelques jours plus tard, Dominique quitte le manoir, poursuivie par « son cher seigneur », tandis que Gilles et Anne se retrouvent pour la dernière fois sur les bords de la fontaine fleurie.
Tous les films de Carné respectent l’unité de temps.
Je dirai tout à l’heure comment Les Enfants du Paradis obéissent à cette règle, ainsi que La Marie du Port. Il n’est qu’une exception et c’est Jenny. Mais nous savons déjà ce qu’il faut penser de cette composition d’examen que Marcel Carné réalisa pour obtenir son diplôme de bachelier ès-cinéma.
Pourtant Marcel Carné n’a pas su toujours éviter l’arbitraire. Il vint un jour où il prit conscience de cette tendance. Ainsi dans Le Jour se Lève resserre-t-il trop volontairement l’action dans le temps pour que cela ne sente pas le procédé. Le drame se situe bien dans un seul jour — le dernier de François qui doit mourir à l’aube, n’ayant eu à lutter que contre lui-même, et vaincu par lui-même — mais on nous montre à travers la mémoire de l’assassin occasionnel, les circonstances qui l’ont conduit au crime. Et ces circonstances, elles, s’étendent sur plusieurs semaines. On reconnaît là le procédé du retour en arrière, si fort en honneur au cinéma depuis L’Histoire d’un Crime de Zecca jusqu’à Citizen Kane d’Orson Welles. Il est particulièrement cher au scénariste Jacques Viot qui, après l’avoir employé dans Le Jour se Lève, l’utilisera à nouveau dans Marie-Martine et l’utilise encore maintenant en adaptant Climats, de Maurois.
Le Jour se Lève est le seul film où Carné, mal à son aise, sans doute, devant un sujet trop mince, se soit laissé aller à quelques virtuosités. Virtuosité dans la construction du scénario — mais le scénariste y est évidemment pour beaucoup. Virtuosité purement technique surtout (le travelling compliqué de panoramique qui ouvre le film est un des mouvements d’appareils les plus complexes de toute l’oeuvre de Carné).
Il n’y a aucun doute : Le Jour se Lève — considéré par certains comme le chef-d’oeuvre de Carné — n’est pas son meilleur film. Je le crois, personnellement, menacé d’un vieillissement prématuré (2).
(1) Nous préférons appeler les personnages par le nom qu’ils portent dans les films, plutôt que par celui des acteurs qui les incarnent. Le lecteur qui désirerait savoir quel acteur prête son visage à tel personnage, est invité à se reporter à la filmographie située à la fin du volume.
(2) Ayant eu récemment l’occasion de confronter Le Quai des Brumes et Le Jour se Lève, je me vois obligé de réviser un peu ce jugement. Il y a dans Le Jour une rigueur qui doit le protéger contre le vieillissement et qu’on ne trouve pas toujours dans Le Quai.
3b – … DANS UN SEUL LIEU…
Marcel Carné emprunte plus d’un élément au théâtre. Il tourne volontiers dans des décors construits (assez éloignés, dans leur esprit, des toiles peintes du Cabinet du Docteur Caligari ou des décors trop élaborés, que Malet-Stevens construisait pour les films « intellectuels » de Marcel l’Herbier, à la fin du muet), avec des éclairages artificiels qui ne cherchent pas à copier la réalité — mais à la restituer — et ses personnages échangent toujours des dialogues assez littéraires — même quand ils ne sont pas signés Jacques Prévert.
De plus, Carné a plusieurs fois projeté de porter des pièces de théâtre à l’écran, qu’il s’agisse d’Euridyce de Jean Anouilh ou de Juliette ou la clef de songes de Georges Neveux. C’est que, prétend Carné, si un auteur, non spécialisé, a quelque chose à dire il le confie au théâtre ou au roman, d’abord pour qu’il demeure dans l’élément qui lui est propre et dans lequel il excelle, ensuite parce que les risques d’indiscrétion et, par conséquent, de plagiat sont infiniment moins grands….
Carné adapte donc au cinéma des pièces ou des romans, parce qu’il est avide de se nourrir d’une substance que les scénarios originaux lui apportent rarement. Pourtant, il n’y a rien de théâtral dans son oeuvre. Il a toujours su fondre des éléments étrangers en un tout riche en possibilités cinématographiques.
C’est sa volonté de dépouillement à tout prix qui lui fait écarter le pittoresque facile et l’exotisme de pacotille. La réalité est pourrie de détails qui, pour être curieux, n’en sont pas moins sans portée. Carné veut que chacune de ses images soit nécessaire, que chacune amène avec elle un progrès plus qu’une révélation. Il en est, naturellement amené à concentrer son action dans l’espace, plus encore qu’il la contractait dans le temps.
Chez lui, point de ces promenades sous les cocotiers, de ces rêveries au clair de lune, parmi les palmes et les cris de crapauds ; de ces croisières aux pays d’outre-mer ; de ces excursions chez les Esquimaux ou les Zoulous. Il regarde, comme parasite, le pittoresque qui distrait l’attention du spectateur de l’objet véritable du film. L’enchantement des pays rêvés, il préfère le suggérer (dans ses films toutes les scènes sont suggestives) par une réplique, par un mot, un objet ou un air qu’on chantonne, plutôt que de montrer le pays évoqué.
Cet ascétisme n’est pas sans s’exercer, parfois, au détriment de l’intérêt. On le regrette particulièrement dans Les Portes de la Nuit, où Carné a confié au dialogue de Prévert le soin de nous conduire dans des pays merveilleux. Il est d’autant plus dommage que Carné ait refusé de nous montrer ce film sur l’Ile de Pâques, que ceux qu’il avait chargés de nous le décrire, s’en acquittent assez mal, Nathalie Nattier surtout. Pourtant, en bien d’autres cas, et également dans le même film, il nous avait démontré que sa méthode était bonne.
Une fenêtre grillagée et c’est tout le passé des deux amants damnés qu’on pressent (1). Une carte postale et l’écran est envahi par le soleil et les fleurs éclatantes du midi (2). Une chanson, fredonnée dans un chantier de démolition, évoque à la fois une enfance heureuse, un Noël de guerre et les bars tapageurs de San Francisco. Les fatigues du monde entier sont entrevues, à travers l’accent de Diégo, son teint hâlé, son sourire large et barré des rides de la souffrance, grâce à un petit bateau dessiné maladroitement sur une nappe en papier (3).
Les associations d’idées, soit dans l’esprit de l’auteur, soit dans celui de ses personnages ne sont pas sans évoquer la technique surréaliste de l’écriture automatique et le monologue intérieur des romanciers américains. (A quand un film d’après un roman de Faulkner ?).
On pressent chez les hommes et chez les femmes de Carné comme un perpétuel besoin d’évasion — vrais voyageurs, selon Baudelaire, qui ne voyagent que pour partir — symbole de cette nécessité où ils se trouvent d’échapper à leur condition. Mais cet appel d’un ailleurs n’est jamais exprimé que par un détail insignifiant : la joie de Raymonde à l’idée de partir en voyage ; sa déception quand M. Edmond lui annonce: « On ne part plus » (4). La rêverie de Françoise devant les cartes postales de M. Valentin (5). Le peintre fou et les navires que Jean ne prendra pas (6). Et, même dans Jenny, les valises qu’on prépare fébrilement et qui ne serviront jamais.
Le lieu de prédilection de Marcel Carné, celui qui sert de cadre avec le plus de bonheur à la majorité de ses films est, sans conteste, plus encore que la grande ville tentaculaire, sa proche banlieue toute enfumée d’usines et de chemin de fer, ou ses quartiers excentriques toujours en fermentation. C’est dans ces agglomérations encore mal fixées, déjà dévorées d’immeubles de sept étages, mais traversées toujours de chemins de terre boueux, où poussent les herbes jaunes et les fleurs pâles, qu’il aime à placer le sujet de ses tragédies modernes.
Dans Le Quai des Brumes on le sent envoûté par la présence du Havre, qui en acquiert une existence autonome, animale, hostile et menaçante. La banlieue d’Amiens revêt ce même aspect inquiétant dans Le Jour se Lève et pèse de tout son poids d’obscurité trouble sur les épaules de ses habitants.
Mais c’est Paris surtout, Paris populaire, grouillant et âpre qui obsède Carné. C’est lui qu’il a chanté dès Jenny et qu’il a magnifié dans Hôtel du Nord, Les Enfants du Paradis et Les Portes de la Nuit. Et même le Londres fantaisiste de Drôle de Drame, par une curieuse méprise, n’est pas sans évoquer un Paris brumeux et gentiment désuet.
C’est pourtant bien le limiter que de vouloir faire de Marcel Carné exclusivement le poète des villes et de Paris en particulier (7). Il a su exprimer dans Nogent Eldorado du Dimanche toute la poésie familière et mélancolique des paysages des bords de la Marne que villas et guinguettes ponctuent de notes d’un mauvais goût agressif. Nul mieux que lui n’a su révéler la tragique beauté des paysages rocailleux qui préfacent Les Visiteurs du Soir de leur grandeur désespérée. Il lui plaît, néanmoins dans le même film de présenter les forêts sauvages et pourtant débonnaires de la Provence, traversées par la chasse des seigneurs, ou la fraîche fontaine assise au centre de son parterre de marguerites.
J’ai déjà dit l’utilisation qu’il avait fait de la mer et de la campagne normandes dans La Marie du Port et comme il faut regretter qu’il ne nous soit pas permis de voir ce qui a été tourné de cette Fleur de l’Age, qui nous aurait révélé en Carné un peintre de la mer d’une science très sensuelle !
On remarque tout au long de l’oeuvre de Carné une évolution constante.
Il tend à limiter de plus en plus dans l’espace le cadre de ses films.
Si Jenny — mise à part sa première scène, si inutile — ne nous faisait pas un instant quitter Paris, si l’intrigue de Drôle de Drame se nouait et se dénouait sans s’éloigner de quelques quartiers de Londres, l’action de ces deux films n’en avait pas moins une ville entière pour théâtre. Mais l’action du Quai des Brumes, du commencement à la fin, se tient dans un quartier fort restreint du Havre.
Ces limites se trouveront encore resserrées dans Hôtel du Nord. A part le voyage à Marseille qu’il eut été plus habile de suggérer (chaque fois que Carné renonce à son ascétisme naturel, chaque fois qu’il viole ses règles, cela ne lui réussit pas), les personnages vivent, s’aiment et meurent entre l’Hôtel et les rives du canal Saint-Martin.
Nouvelle étape avec Le Jour se Lève. Là encore c’est un quartier qui est mis en scène, mais la présence continuelle de la chambre de François, tout au long du film comme un leitmotiv, rend cette unité encore plus précise.
Et si les seigneurs des Visiteurs du Soir s’éloignaient un instant de leur château, c’était pour se rendre à la fontaine toute proche ou aller chasser dans la forêt voisine.
Les Enfants du Paradis, malgré leur volonté de rompre les écluses, de s’affranchir de toutes règles, n’en sont pas moins très limités dans l’espace. Les deux époques ne développent leur action qu’à Paris, et presque exclusivement sur le Boulevard du Crime, entre le Grand Théâtre et le Théâtre des Funambules.
Mais Les Portes de la Nuit représentent, sans conteste possible, le point d’aboutissement de cette évolution, l’expression la plus complète et à ce jour la plus parfaite, de cette tendance. Elles s’entr’ouvrent sur un quartier de Paris très limité, dessiné par les boulevards extérieurs et le canal Saint-Martin.
Marcel Carné devait, dans La Fleur de l’Age, enfermer ses personnages dans un lieu naturellement clos : une île de Bretagne, dont nul n’aurait pu s’échapper. Enfin, malgré le souci de Carné de tourner le dos à ses précédentes habitudes dans La Marie du Port, son dernier film ne nous décrit qu’une petite portion de paysage, nous faisant quitter la brasserie et le cinéma de Chatelard, pour nous entraîner au Café du Port ; n’abandonnant ce tout petit coin de Cherbourg que pour ce tout petit coin de Port-en-Bessin, qui n’en est pas tellement éloigné…
Les critiques à l’apparition des Portes de la Nuit parlèrent des trois unités comme d’une découverte soudaine et puérile, une nouveauté imprévue dans l’oeuvre de Carné. « L’incroyable satisfaction du cinéma découvrant la bonne vieille unité de temps » écrivait l’un d’eux avec ironie (8).
J’avoue qu’à mon tour, cet étonnement m’étonne. Car Marcel Carné, dès le début de chacun de ses films, se plaît à indiquer le lieu où l’action va se tenir, comme il s’attache à ne guère dépasser les limites autorisées à la tragédie par Aristote (entre deux révolutions de soleil).
Présentation du Havre dans le brouillard blanc du petit jour (9).
Présentation de l’hôtel : le gâteau de première communion monte les étages, traverse les couloirs, découvre les chambres et leurs occupants (10).
Présentation de la maison du crime : la première image montre une voiture à chevaux en « plongée » qui, en avançant, fait panoramiquer l’appareil sur une place et découvre la maison où François va mourir (11).
Présentation du château : on ne le voit qu’au moment où Gilles et Dominique pénètrent à l’intérieur du porche qui semble les engloutir (12).
Présentation du Boulevard du Crime : la foule bigarrée qui assiège les baraques, les théâtres, les tréteaux de parade (13).
Présentation du quartier où va se chanter la légende d’amour des Portes de la Nuit. On ne peut oublier le grand panoramique qui ouvre le film, pris plongeant sur le métro aérien, il délimite tout de suite le lieu de l’action et le situe avec une précision rare.
(1)Les Visiteurs du Soir.
(2)Le Jour se Lève.
(3)Les Portes de la Nuit.
(4)Hôtel du Nord.
(5)Le Jour se Lève.
(6)Le Quai des Brumes.
(7) Le rattacher à l’école paysagiste de Jean Epstein, ainsi qu’on l’a voulu faire à propos de Nogent, serait d’une erreur encore plus grossière.
(8)Pierre Seize : Les cents millions de Marcel Carné, Le Figaro du 26 Juin 1946.
(9)Le Quai des Brumes.
(10)Hôtel du Nord.
(11)Le Jour se Lève.
(12)Les Visiteurs du Soir.
(13)Les Enfants du Paradis.
3c – … UNE ACTION UNIQUE
Cet effort en vue de chasser le pittoresque, qui n’est jamais sans s’exercer au préjudice du contenu réel du film, cette volonté de condenser au maximum l’action dans le temps comme dans l’espace, concourent à resserrer l’action elle-même, jusqu’à n’en plus laisser subsister que l’indispensable, un noyau dur assez semblable au noeud tragique tel que le concevaient les classiques.
Si Carné ne nous plonge pas directement en pleine crise (sauf dans Le Jour se Lève) du moins, dès le commencement, la sentons-nous inévitable, souhaitable même, comme on redoute et souhaite, à la fois, l’orage au milieu des trop lourdes chaleurs d’été. Et c’est pour ne pas nous laisser évader un instant d’une atmosphère irrespirable d’angoisse, qu’il omet d’éclairer en détail le passé de ses personnages, lequel n’est que suggéré par un regard, un soupir, un sourire, une réflexion brève, un éclair sur le visage.
Nous ne savons rien, ou à peu près de Jean avant sa rencontre avec Nelly, sinon qu’il est un déserteur, peut-être même un meurtrier (1). Pas davantage de Diégo et de Malou : l’une est chanteuse, l’autre vagabond du monde (2).
Des parties importantes de l’intrigue elle-même restent dans l’ombre. Ainsi on devine que l’oncle de Nelly, l’ignoble Zabel, lubrique et sanguinaire, a tué l’amant de sa pupille par jalousie et fait disparaître le cadavre et que, pour cette raison, il est traqué par la bande de voyous à laquelle appartenait sa victime (3); on comprend que M. Edmond se cache sous une personnalité entièrement fabriquée pour échapper à la vengeance d’anciens complices qu’il a vendus (4); on admet qu’avant leur pacte avec le diable, Gilles et Dominique étaient des amants orageux et que, peut-être, ils s’entretuèrent (5), en tout cas rien n’est dit formellement. Et des trois nains qui chantent ironiquement leur ronde autour des deux damnés, de ces trois créatures du diable, on ne connaîtra jamais le rôle précis.
C’est ainsi qu’on rencontre chacun de ces personnages, tout chargé d’un passé trop lourd, inquiétant et qui les inquiète. Le traînant derrière eux, ils déambulent à la recherche les uns des autres, sans douceur parce que sans espoir. Quand ils se retrouvent, il est trop tard pour qu’ils échappent à leur solitude et leur rencontre entraîne leur mort. Dans le monde de Carné, on est toujours tout seul et il est toujours trop tard.
Comme dans Andromaque, comme dans Phèdre, c’est le dénouement d’une vie qu’on nous propose, l’achèvement du destin des personnages. Aussi rigoureuse que dans la tragédie antique, la mort est la seule fin logique des films de Carné.
L’unité d’action commande qu’avec la mort du héros s’achève le film, sans statuer sur le sort des autres. Mais il ne reste plus aucune raison de vivre aux survivants : les gens trop malheureux, eux non plus, n’ont pas d’histoire.
La vie de Françoise après la mort de François et de M. Valentin (6); celle de Nelly quand Jean s’est cassé en deux sur les pavés du Havre (7) n’ont plus aucun intérêt — même pour le spectateur. On sent, quand le mot FIN se superpose à la dernière image tachée de sang caillé, qu’il ne leur reste plus à vivre qu’une existence grise, monotone, inutile, comme celle de Thésée après la mort d’Hippolyte et de Phèdre, ne pouvant plus trouver de justification que dans la folie, comme celle d’Oreste, accompli son crime inutile.
Mais ce « noeud tragique » apparaît d’autant plus fortement qu’il se forme entre un nombre plus restreint de personnages. Le cinéma est habituellement prodigue de ces personnages secondaires, de ces silhouettes, plus ou moins heureusement typées, qui encombrent presque tous les films de leur cocasserie facile. Chez Carné, rien de tout cela. Une fois de plus sa haine du pittoresque de pacotille lui fait rejeter ce fatras de fantoches inutiles. Il enferme ses personnages dans leur solitude sans issue, qui se trouve comme renforcée par la présence permanente de la ville hostile et par le grouillement indifférent de la foule. En vérité les films de Carné sont à un seul personnage : Jean dans Le Quai des Brumes, Renée dans Hôtel du Nord (on sait combien Carné — qui désavouerait volontiers ce film — regretta l’importance qu’Henri Jeanson donna au couple Edmond-Raymonde), François dans Le Jour se Lève, Gilles dans Les Visiteurs du Soir, Diégo dans Les Portes de la Nuit (l’inconsistance de l’interprétation de Nathalie Nattier retirait encore du relief à son personnage de Malou) enfin Marie dans La Marie du Port.
Les autres personnages n’interviennent qu’à l’égal de révélateurs pour mettre en lumière un aspect du personnage central, je dirai même qu’ils n’existent que dans la mesure où ils interviennent dans la lutte du héros pour se libérer de sa solitude, soit pour lui faciliter la tâche, soit pour l’entraver, soit simplement qu’ils traversent sa vie comme une dernière épreuve ou une ultime récompense.
L’oeuvre de Carné n’est pas habitée par des couples : les hommes et les femmes y sont seuls. S’ils se rencontrent et s’ils s’aiment, leur amour est court et tragique. Quand le film s’achève chacun a retrouvé soit sa solitude, soit la mort et il faut que les amants des Visiteurs du Soir soient transformés en statue pour rester éternellement dans les bras l’un de l’autre. Hôtel du Nord se termine par un baiser sur la bouche, ou presque. Mais le film entier nous a décrit la solitude de Renée ; et nous sommes sceptiques sur l’avenir de ce couple, qui a déjà manqué une fois son union dans la mort. Bien sûr, à la fin de La Marie du Port, Chatelard et Marie s’éloignent enlacés; mais nous savons bien que l’union de ces deux-là est purement physique et commandée, d’une part, par le désir de Chatelard dont on peut supposer qu’il aura une fin, d’autre part, par l’ambition de Marie. (Le film ne se termine pas réellement par un baiser sur la bouche; mais par la main crispée sur le trousseau de clefs.)
(1)Le Quai des Brumes.
(2)Les Portes de la Nuit.
(3)Le Quai des Brumes.
(4)Hôtel du Nord.
(5)Les Visiteurs du Soir.
(6)Le Jour se Lève.
(7)Le Quai des Brumes.
3d – UNE EXCEPTION QUI, DE NE PAS L’ÊTRE, CONFIRME
Dans l’oeuvre de Marcel Carné se trouve néanmoins un film — Les Enfants du Paradis — qui ne présente pas ces caractéristiques formelles que j’ai essayé de dégager. Je crois pourtant que, dans une certaine mesure, ce film fleuve participe à l’oeuvre de Carné, sans apporter de démenti à tout ce qui précède.
On a beaucoup dit, beaucoup écrit — et beaucoup trop pour que ce soit tout à fait vrai — que, dans Les Enfants du Paradis, Marcel Carné avait « rompu les écluses » qui, jusque là, contenaient le courant de ses films. Les 5.593 mètres du film furent pour beaucoup dans le jugement hâtif de quelques-uns. De fait, il serait vain de vouloir retrouver, dans ces kilomètres de pellicule, la volonté rigoureuse de concentration qui préside habituellement à l’élaboration des tragédies de Carné. Mais, afin de ne commettre aucune erreur d’appréciation, sans doute eut-il été bon de placer le film sur son plan véritable et de ne pas se laisser impressionner par son métrage important.
Il est certain que, dans Les Enfants du Paradis, Carné a tenté un élargissement, sinon un bris, de ses cadres habituels. Les dimensions, qu’il a voulu exceptionnelles, nous obligent à considérer ce film comme une vaste fresque, mieux, comme une épopée.
Tout comme dans une épopée, on trouve, en effet, dans le film, un fourmillement de personnages, une action diffuse et la juxtaposition de tous les genres et de styles différents. On y rencontre aussi bien de charmantes idylles, de pittoresques descriptions, que d’énormes morceaux de bravoure, sorte de Sac de Troie ou de Descente aux Enfers.
Pourtant, en y regardant de près, on s’aperçoit que dans ce film, Marcel Carné n’a rien abdiqué de sa rigueur et qu’il la plie à cette règle des trois unités, dont il ne peut lui-même s’écarter sans danger (cf. la première scène de Jenny ou la séquence marseillaise d’Hôtel du Nord).
En effet : l’action se déroule entièrement à Paris et, plus précisément, sur le Boulevard du Crime, entre le Grand Théâtre et le théâtre des Funambules (unité de lieu); la première époque se situe au cours d’une fraction relativement peu importante de 1840 et, la seconde, en 1847 (unité de temps); l’intrigue peut se résumer, en fait, aux amours du trop timide Baptiste Debureau, du trop avantageux Frédérick Lemaître et de la trop belle Garance que viennent troubler la jalousie de Nathalie, la cruauté de Lacenaire et la superbe du comte de Montray (unité d’action).
Ce film, plus que tout autre, offrait des tentations de pittoresque, de lyrisme et sans doute de grandiloquence et de démesure. Mais peut-être Les Enfants du Paradis souffrent-ils justement de n’avoir pas succombé à cette tentation et je crois que c’est là qu’il faut chercher les raisons des quelques restrictions qui nuancèrent les cris d’admiration.
Mais Carné n’a pas voulu s’abandonner à un délire poétique. Conscient de ses possibilités et de ses limites, il venait de renoncer à porter à l’écran une Vie de Milord l’Arsouille dont la truculence le rebutait (c’est pour des raisons identiques que, quelques années plus tard, il ne donnera pas suite au projet de Casque d’Or, que Jacques Becker vient de nous donner). S’il s’intéresse aux Enfants du Paradis, c’est donc qu’il pense pouvoir plier le sujet à ses exigences habituelles et le déséquilibre qui fait, malgré tout, du film une oeuvre équivoque, vient de ce que le sujet ne s’est pas toujours laissé faire — ne serait-ce que parce que Jacques Prévert ressent, à un degré moindre, la nécessité de la rigueur.
Avant même que commence le film, dès que frappent les trois coups, dès que se lève ce rideau sur la foule du boulevard du Crime, nous comprenons que le classicisme naturel de Marcel Carné l’emportera sur sa volonté d’être épique. Malgré tout il concentrera l’action de son film au maximum et l’enfermera dans les limites les plus étroites que puisse permettre la vraisemblance. Il ne pourra évidemment pas en faire une tragédie au sens classique du terme, mais son horreur du fouillis, sa phobie du désordre l’empêcheront d’en faire absolument une épopée. Cela donne un curieux compromis, drame en deux actes (en deux journées, dirait-on s’il s’agissait d’un espagnol) d’un romantisme réticent, d’une folie savamment ordonnée.
C’est cela qui est intéressant.
Ce classicisme inexorable, dans lequel certains ont voulu voir de la sécheresse, nous savons maintenant qu’il est une disposition naturelle à l’ascétisme.
Carné renonce — contre lui-même — aux facilités du cinéma. Son esthétique ne relève pas d’une attitude artificielle ; elle lui est une obligation; il fait de bons films sans le vouloir ou plutôt, il est condamné à ne faire que de bons films car il ne peut pas en faire de mauvais ; je veux dire des films où il ne soit pas en entier avec ses exigences et sa personnalité.