BERNARD – G. LANDRY présente MARCEL CARNÉ
– Avec l’aimable autorisation de Bernard-G Landry –
Bernard-G Landry était âgé d’à peine 20 ans lorsqu’il a écrit ce premier livre consacré à la carrière de Marcel Carné. Et pourtant il fait preuve d’une grande maturité et d’une grande profondeur dans la compréhension des films de la première période, la plus riche, de Carné.
Ainsi plus de 55 ans après sa parution il s’agit toujours de l’un des ouvrages les plus importants dédié à Carné. C’est la raison pour laquelle il nous apparaît important de lui donner une seconde vie en mettant en ligne l’intégralité de cet ouvrage.
En effet, Les Editions Jacques Vautrain ayant fait faillite dans les années 50, il y a peu de chances que cet ouvrage soit réédité un jour malheureusement.Nous allons donc mettre en ligne, en accord avec Bernard-G Landry, les 6 chapitres de ce livre à raison de deux chapitres par mois à partir du 18 août 2008, date anniversaire de la naissance de Marcel Carné et ce jusqu’au 31 octobre 2008 date de son décès.
D’ailleurs lors d’une interview avec le professeur Edward Turk en 1980 (dont vous pouvez lire et écouter de larges extraits ici), Marcel Carné avouait que c’était le livre « le plus personnel et percutant » que l’on ait écrit sur lui. Voici l’extrait inédit de cet interview :
Ecoutez l’extrait de cette interview (cliquez sur la flèche verte) :
Edward Turk : A propos de critiques, est-ce qu’il y a eu un critique qui a vraiment saisi le sens de votre oeuvre ? À mon avis le livre de Queval n’est pas bon.
Marcel Carné : Ah ! vous savez que j’ai refusé le livre de Queval ? Il y a un éditeur qui s’appelait Jacques Vautrin qui m’a dit « voilà, je veux faire un livre sur vous et j’ai pensé à Jacques Queval, est-ce que vous êtes d’accord ? » Je ne le connaissais pas du tout donc je pouvais pas me permettre de penser quoique que ce soit, donc j’ai répondu qu’il commence à écrire le livre, puis je le lirais et je vous dirai ce que j’en pense. Donc il a commencé et m’a montré des pages et quand j’ai vu ce que c’était j’ai dit à l’éditeur « je suis pas d’accord ! » et il m’a répondu « mais je ne ferais pas un livre sur vous sans que vous soyez d’accord sur l’auteur que j’aurais choisi ». Et il y a eu un garçon qui s’appelait Bernard Landry qui a fait un livre merveilleux car c’est le plus personnel, le plus percutant qu’on ait fait sur moi.Signalons que par la suite Bernard-G Landry deviendra scénariste (notamment dans les années 70 pour le réalisateur Roger Coggio), syndicaliste et surtout romancier. Il est l’un des fondateurs de la maison d’édition indépendante Le Temps des Cerises.
Chapitre I –
LA GRANDE HISTOIRE ET
LES PETITES HISTOIRES DE MARCEL CARNÉ
Vous pouvez accéder directement aux sous-chapitres suivants en cliquant dessus :
1a – MARCEL CARNÉ AVANT MARCEL CARNÉ
1b – LES DÉBUTS DE MARCEL CARNÉ
1c – NAISSANCE D’UN MYTHE
1d – LE CARNÉ LÉGENDAIRE
1a – MARCEL CARNÉ AVANT MARCEL CARNÉ
Il est né aux Batignolles, le 18 août 1909. A cinq heures du matin, pour être précis.
(En fait Carné est né en 1906 et à 17h. ndr)
Son père était un petit artisan ébéniste qui rêvait, comme cela est naturel, de voir son fils lui succéder dans son métier, l’installer avec pignon sur rue et, qui sait, de le voir même devenir un des rois du « Noble Faubourg », (lisez: Faubourg Saint Antoine, patrie des ébénistes, cher au coeur de Jean Grémillon).
Son enfance, il ne la passa guère à la maison, le père, devenu veuf, était rarement là, et le jeune Marcel, élevé par une grand-mère et une tante qui lui toléraient tous ses caprices, devait partir très jeune à la découverte du monde…
Le square des Batignolles, tout proche, fut le royaume béni de son adolescence. C’est là, qu’en compagnie de galopins de son âge, il commença à donner libre cours à son imagination naissante et aussi à faire preuve du sens de l’autorité et du commandement qu’on lui reconnaîtra plus tard, dans des parties de « gendarmes et de voleurs » dont il conserve encore un souvenir attendri.
Toutefois, régner sur des petits camarades de jeux n’est pas toujours aussi facile qu’on le croit. Il se trouve toujours quelqu’un dans la bande pour s’accommoder assez mal du despotisme du « chef » et ruer dans les brancards. Ce renacleur, le jeune Carné devait le rencontrer dans la personne d’un grand dadais, long comme un jour sans pain, à la voix déjà râpeuse et à l’accent des faubourgs. Il y eut pas mal de bagarres, puis, enfin, un jour ce fut la vie qui les sépara… Quinze ans plus tard, Carné, préparant Le Quai des Brumes se rend au Théâtre Antoine, où un jeune acteur répondant au nom de Pierre Brasseur interprète L’Homme qui se donnait la Comédie. Carné le voit, il lui plaît. Il se rend alors dans sa loge pour lui parler du Quai. Puis, soudain, à brûle-pourpoint, le dévisageant :
– Dites-moi… N’avez-vous pas fréquenté l’école de la rue des Batignolles ?
Le grand dadais, si fier de ses patins à roulettes tout neufs, celui qui, déjà, renâclait devant l’autorité naissante du futur metteur en scène des Enfants du Paradis, c’était lui, Pierre Brasseur !
Marcel Carné a maintenant dix-huit ans. Encore qu’il ait dit un adieu définitif au domaine de son enfance, devenu, avec l’âge, minuscule et ridicule à ses yeux, il ne demeure pas pour cela davantage à la maison, au contraire. Depuis de longues années déjà, il a une passion dont tout le monde se moque dans son entourage : le cinéma, qui commence à marcher tout seul comme un grand. Tous les soirs, son repas englouti en vitesse, il se précipite d’un bout à l’autre de la capitale, partout où, au son d’un vieux piano désaccordé, passe un film digne de quelque intérêt. A l’Epatant, à Belleville, au Cinéma des Gobelins ou encore au Casino de Grenelle, où, sous le manteau, ont lieu les projections des films soviétiques de l’époque « destructive ».
D’autres soirs, cependant, le voient hanter en culottes courtes, les divers promenoirs des music-halls : le Casino, les Folies Bergères, naturellement; et puis aussi le Moulin Rouge, les Ambassadeurs, l’Empire et le Music-hall des Champs Élysées. Mais ce n’est pas ce que vous croyez. Parallèlement au cinéma, encore muet, Carné s’est découvert une seconde passion: le Music-Hall avec l’intrusion explosive du jazz, l’apogée de Mistinguett et de Maurice Chevalier, le passage fulgurant des Dolly Sisters et l’entrée en scène de Joséphine Baker, panthère noire ceinturée de bananes, se trémoussant là où, la veille, des mélomanes bouleversés écoutaient, les yeux clos, le chant d’amour déchirant de Tristan à Yseult !
Tout cela est très joli, certes. Néanmoins Monsieur Carné père, pense qu’il est temps de songer aux choses sérieuses. A sa sortie de l’école communale, le garçon est entré dans une grande école d’apprentissage du meuble. Il n’a trop rien dit car il adore « bricoler ». Toutefois exécuter une « queue d’aronde » ou sculpter au ciseau une rosace « dans la masse » est une chose, engager définitivement l’avenir en est une autre.
Le jeune Marcel refuse un jour de poursuivre plus avant et son père, un peu par dépit et peut-être aussi dans le secret espoir que cet emploi rebutera le garçon et le fera revenir à de meilleurs sentiments, son père donc, une relation aidant, le fait débuter dans… une compagnie d’assurances ! Et qui plus est, dans les services d’un contentieux ! Cependant au grand étonnement de tous, Carné se laisse faire ! Il semble même trouver sa nouvelle occupation suffisamment à son goût. C’est qu’il a sa petite idée à lui : employé d’assurances, autant dire une mesure pour rien. Employé d’assurances, cela n’est pas un métier, du moins à ses yeux. Donc l’avenir est toujours sauf. Il s’agit de gagner l’âge du régiment, après on verra bien.
Il suit alors assidûment, quoique en cachette, des cours techniques de photographie qui ont lieu deux fois par semaine aux Arts-et-Métiers et grâce auxquels il s’initie aux mystères des objectifs et de l’émulsion photographique. Chaque dimanche matin, en compagnie de ses camarades de cours, il se rend dans le bois de Vincennes, où chaque élève manipule à tour de rôle, durant quelques secondes, une caméra antédiluvienne, prêtée par la maison Pathé. Carné, d’abord ravi, comprend vite que ces cours, ayant surtout pour objet de former des techniciens de laboratoire et des chimistes spécialisés, ne lui seront guère d’un grand profit.
C’est alors qu’il rencontre Françoise Rosay chez des amis communs. Celle-ci, étonnée par le sérieux du jeune homme et l’intelligence du cinéma que manifestent ses propos, lui ménage un entretien avec son mari, Jacques Feyder.
Mais Carné sort désespéré du petit bureau de la rue Fortuny où durant un quart d’heure, il eut avec Feyder une entrevue glaciale ! Françoise Rosay tente de le consoler.
– S’il vous a écouté un quart d’heure, dit-elle, c’est que vous lui avez plu !
Carné en doute. Et pourtant Françoise Rosay avait raison.
Quelques semaines plus tard — nous sommes en juin 1928 — Feyder accepte de prendre Carné avec lui dans Les Nouveaux Messieurs, qu’il entreprend d’après la pièce de Flers et de Croisset. Officiellement Carné est engagé comme aide-opérateur (de Georges Périnal). En réalité, il deviendra très vite l’assistant de Feyder et son bras droit en quelque sorte.
Inutile de dire que Carné, ravi, accepte sans l’ombre d’une hésitation. Mais le premier moment d’exaltation passé, il a peur; que dire chez lui? Bah! il ne dira rien, voilà tout. On verra bien.
Ce qu’on vit, c’est que ses nouvelles occupations contraignaient Carné à des rentrées souvent tardives, pour ne pas dire nocturnes, à la maison. Bienheureux encore que le film ne comportât pas de scènes d’extérieur ! Le jeune Marcel, bien embarrassé, explique comme il peut que sa compagnie l’a changé de service, qu’il se rend maintenant en banlieue démarcher des clients, d’où ces heures irrégulières de travail. Dans sa famille on le croit, ou peut-être on feint de le croire. Les deux braves femmes qui l’ont élevé ont échangé un regard complice devant ses explications confuses: sans doute l’idée leur est-elle venue d’une toute autre cause à ces retards…
Mais à quelque temps de là, un jour qu’on tournait une scène des Nouveaux Messieurs autour de l’Opéra, Carné est aperçu par un ami de la famille qui, rencontrant son père s’étonne :
– Tu ne m’avais pas dit que Marcel faisait du cinéma ?
– Du cinéma?… Première nouvelle !
En rentrant chez lui ce soir-là, le jeune Marcel fut accueilli de la façon dont vous pensez !
– Tu as vu beaucoup de clients aujourd’hui ? — interroge son père.
– Oui, pas mal, — répond effrontément Marcel qui renchérit: — je crois même que j’ai traité une excellente affaire…
– Du côté de l’Opéra, sans doute ?…
Finalement son père dût s’incliner devant le fait accompli, mais non sans lui avoir prédit qu’il crèverait de faim toute sa vie.
– Tu trouveras toujours ici de quoi dormir et de quoi manger, ajouta-t-il. Pour le reste, débrouille-toi.
La partie était gagnée.
Gagnée ? Carné le croyait, quand, en novembre 1928, engagé par la Metro Goldwyn Mayer, Feyder s’embarque au Havre, via Hollywood. Peu après, Carné, qui a devancé l’appel, part de son côté accomplir son service militaire en Rhénanie.
Quand il revient, il est seul, sans protecteurs, sans ami, dans la faune féroce du cinéma. Mais il n’est pas de ceux qui abandonnent… Pour la société qui avait produit Les Nouveaux Messieurs, il accepte d’assister Kruger dans Cagliostro, tourné par Richard Oswald. Le voilà à nouveau cantonné, malgré lui, dans la photographie.
Cela lui donne l’idée d’acheter, à l’aide de quelques économies, jointes à celles d’un camarade, Michel Sanvoisin, une caméra portative. C’est ainsi que tous les dimanches de l’été 1929 Carné les passe à Nogent-sur-Marne où, aidé de son camarade, il tourne presqu’en amateur, son premier film Nogent Eldorado du Dimanche, sorte de documentaire poétique sur le petit peuple des guinguettes des bords de Marne, les plaisirs faciles et les joies simples des promeneurs dominicaux. En quelque sorte l’ébauche de ce que sera vingt ans plus tard, en plus romancé, Dimanche d’Août, de Luciano Emmer. Coût du film — sans dépassement de devis — 4.500 francs !
Il montre Nogent à quelques amis, qui le félicitent et l’encouragent à le porter à une salle d’avant-garde : le Vieux-Colombier, les Ursulines ou le Studio 28, que Jean Mauclère, aidé de Jean-Georges Auriol viennent de fonder. Mais Carné hésite. Plein de scrupules, il ne pense pas que son petit film, dénué d’ambition, mérite des projections publiques. En tous cas il ne lui semble pas qu’il puisse satisfaire le public des salles dites spécialisées où la mode est alors à l’avant-garde la plus échevelée : films abstraits, montages rapides, contre-jour, jeux de cristaux et de vitesse, surimpressions et tout l’habituel arsenal pseudo-poétique.
Pourtant un ami le présente aux directeurs des Ursulines : Tallier et Myrga. Carné leur montre son film. Il est accepté moyennant — déjà — quelques coupures. Au grand étonnement de son auteur, il est même chaleureusement accueilli par la critique, Alexandre Arnoux en tête, ainsi que par la portion compétente du public. Quelques amateurs éclairés commencent à connaître ce nom jusque là inconnu : Marcel Carné.
René Clair a vu Nogent, Eldorado du Dimanche. Il a été séduit, autant par la fraîcheur nostalgique et la sensibilité populaire du film que par les qualités de cinéaste que son auteur y montre. Aussitôt il demande à Marcel Carné d’être son second assistant — le premier étant Georges Lacombe — pour le film qu’il entreprend : Sous les toits de Paris.
Carné a une grande admiration pour René Clair, dont il a vu naturellement tous les films et particulièrement Paris qui dort, qu’il préfère. Il accepte avec enthousiasme. Mais au cours du tournage, les relations entre les deux hommes se tendent un peu. Indépendamment des caractères, il y a surtout incompatibilité totale de méthode de travail. Carné, habitué à celle de Feyder, accepte assez difficilement la rigidité de Clair, pour qui le film est achevé lorsqu’il est écrit et qui, par conséquent, tourne mécaniquement plan après plan, s’interdisant toute modification du découpage sur le plateau.
Ayant terminé Sous les toits de Paris, à la fois par désoeuvrement et par amusement, Carné participe au concours de Critiques organisé par le plus grand hebdomadaire de cinéma de l’époque : Cinémagazine.
Il envoie cinq critiques, écrites, ainsi que le règlement l’exige au dos d’une carte postale, quatre signées de son nom et une cinquième signée Michel Sanvoisin, du nom du camarade qui l’avait aidé pour Nogent. Les quatre premières ont trait à l’Argent, de Marcel l’Herbier; les Espions de Fritz Lang, les Nouveaux Messieurs de Jacques Feyder, les Deux Timides de René Clair. Quant à la cinquième elle exalte ce poème de mécanique qu’est le Pont d’Acier de Joris Yvens.
Or, il se trouve qu’il remporte le premier prix devant Gaston Paris, Maurice Muller-Strauss, le prince Troubetskoï, etc… Mieux encore, les critiques qu’il a envoyées sont jugées si intéressantes par la direction du journal qu’il est aussitôt engagé par celle-ci pour rendre compte, chaque semaine en compagnie de Robert Vernay, des films nouveaux. Il y restera jusqu’en 1931, date de la disparition du premier Cinémagazine.
Dans cette carrière nouvelle de journaliste qui s’ouvre à lui, Carné fait déjà montre de cette indépendance sourcilleuse, qui devait lui valoir tant d’ennemis. Peu après il entre à Hebdo-Film, revue corporative que dirige un ancien chansonnier qui a troqué son nom de Garnier, trop roturier, pour celui, qui sonne mieux, d’André de Reusse.
Carné quittera très vite ce dernier, d’une manière qui vaut d’être contée…
L’étrange directeur qu’était de Reusse laissait à son collaborateur le soin de faire entièrement le journal : depuis la rédaction de tous les articles — à l’exception du leader qu’il envoyait chaque semaine du Raincy où il habitait — jusqu’à la correction au marbre en passant par la mise en pages. C’est précisément ce malheureux article hebdomadaire et directorial qui provoqua l’orage.
Cette semaine-là, le papier que de Reusse fit parvenir au journal était, ni plus ni moins, un éreintement féroce des Lumières de la Ville et de son auteur en particulier, que de Reusse,dans le désir de se singulariser, traînait dans le boue ! En le lisant, Carné qui adorait le film et pour qui Chaplin était une sorte de dieu, bondit ! Puis, ayant réfléchi, il résolut de jouer à de Reusse un tour à sa façon !
La semaine suivante, lorsque celui-ci reçut son journal au Raincy, ce fut à son tour de bondir ! Sur quatre pages du périodique s’étalait une gigantesque revue de presse où Carné avait réuni tout ce qu’il avait pu trouver d’éloges et de dithyrambes sur les Lumières de la Ville ! Furieux, comme on imagine, s’estimant ridiculisé, de Reusse, dans le numéro suivant y alla naturellement de son papier vengeur traitant Carné de « Bolchevik », de « Nihiliste » et de « Vipère nourrie dans son sein ». Le « Nihiliste » s’en souciait peu : le jour de la parution de la fameuse revue de presse, il était parti du journal pour n’y plus revenir.
Quittant Hebdo-Film, Carné devait retrouver Ciné-Magazine qui, reparaissant mensuellement, avait désarticulé son titre et transformé son format comme sa formule.
Néanmoins, parallèlement à son activité journalistique Carné continuait à faire du cinéma ; c’est ainsi qu’il réalise de courtes bandes publicitaires présentant cette particularité remarquable que leurs scénarios sont de Jean Aurenche et leurs décors et costumes de Paul Grimault !
L’une d’elles, intitulée une Election à l’Académie faillit provoquer un scandale.
On y voyait un vieil académicien barbu, dans le genre de ceux que devait affectionner par la suite le doux Jean Effel, s’enfuir en courant de l’Institut, les pans de son habit flottant au vent, poursuivi par un huissier affolé et criant :
– Maître, maître, on vous attend !…
– On m’avait promis un fauteuil à l’Académie, mais je croyais que c’était un fauteuil Lévitan !…
Ce film devait passer à l’entracte dans le circuit des salles Pathé-Nathan. Or, ce dernier qui dirigeait alors la maison, jugeant ce sketch incompatible avec la dignité d’une institution aussi respectable que l’Académie, le refusa sans appel !
Pendant trois ans, de 1930 à 1933, Carné suivit cette école aussi profitable que joyeuse — il y a également l’histoire d’un radeau sur la Seine qui vaut son pesant d’or — à laquelle il doit en partie de tout connaître de la technique si complexe du cinéma. Ces films, en effet, il les découpait, les mettait en scène, les photographiait, les montait et les sonorisait !…
Enfin, en 1933, le jour tant attendu arrive, Jacques Feyder, retour d’Amérique, débarque à Cherbourg. Aussitôt il reprend Carné avec lui. Mais Feyder ne tournait guère plus d’un film par an et cela répugnait quelque peu à Carné de travailler le reste du temps sous la direction d’un quelconque médiocre… Jusque là, les prédictions paternelles « Tu crèveras de faim toute ta vie » semblaient se confirmer, malgré l’énorme somme de travail fournie par Carné tant au journal qu’au studio. (Cela, toutefois, ne l’empêchait pas de tourner, bénévolement de surcroît, les démonstrations populaires du mouvement Ciné-Liberté dans lequel il s’était jeté à corps perdu.)
Il est donc l’assistant de Jacques Feyder pour trois films — un assistant d’un zèle, d’un dévouement total, absolu, passionné, mais aussi un assistant qui manque bien souvent de la souplesse un peu servile que réclame cet emploi si particulier — Le Grand Jeu (1933), Pension Mimosa (1934), La Kermesse Héroïque (1935). Son nom figure sur les génériques en qualité d’assistant technique, encore que pour La Kermesse il ait été en fait directeur de production, le titulaire du poste s’étant pris de querelle avec Feyder dès le début du film et n’ayant plus reparu par la suite sur le plateau.
1b – LES DÉBUTS DE MARCEL CARNÉ
En 1936, encouragé par Jacques Feyder, soutenu par Françoise Rosay, Marcel Carné réalise son premier grand film : Jenny, d’après un scénario plus ou moins imposé par le producteur et primitivement intitulé Prison de Velours (sic).
Pour ce film, Carné qui, peu de temps auparavant avait été fortement impressionné par la projection du Crime de Monsieur Lange, demande au producteur d’engager Jacques Prévert pour l’adaptation et les dialogues du scénario de Pierre Rocher. Il s’attend à ce que le producteur lui réponde :
– Jacques Prévert?… Connais pas !
Or, pas du tout. Au seul nom de Prévert, le producteur exulte ! Comme cela se trouve : Prévert ? mais c’est « un ami de la maison » ! En effet, celui-ci ne vient-il pas de travailler pour lui au scénario de L’Empereur des Vaches, mis en scène par Jean Stelli ? (A Jacques Prévert aussi il est parfois arrivé d’avoir besoin d’argent). Seulement, donnant donnant. En échange de Prévert, Carné doit accepter Jean Stelli comme « directeur artistique ».
Ce n’est pas tout : l’assistante imposée au jeune débutant, décidément étroitement surveillé, est du dernier bien avec le fils du producteur. Enfin Carné doit non seulement travailler sous l’oeil attentif de Françoise Rosay, mais Feyder, sans que son ancien assistant soit mis au courant, signe un contrat de supervision pour le film. (En réalité, Feyder qui apprécie peu l’esprit grinçant de Prévert, se désintéressera complètement du film et ne viendra qu’un seul soir au studio pour y chercher sa femme).
Un premier incident éclata à propos du scénario.
La majeure partie de celui-ci se déroulait dans une maison de rendez-vous, dissimulée sous la façade d’une lingerie de la rue de la Lune dont on trouve l’adresse dans les petits journaux galants pleins de déshabillés…
Le producteur informa très vite Carné que la censure interdisait la-dite maison à l’écran. Carné encore novice le crut et, en compagnie de Jacques Constant, remania son histoire à quelques jours du premier tour de manivelle. C’est ainsi qu’il remplaça le commerce incriminé par une vague boîte de nuit, mi-tripot, mi-lupanar, qu’il dût, comble d’infortune, réaliser dans un mauvais décor. Prévert, plantant là Jenny et sa Prison de Velours, avait laissé Carné se débrouiller seul et était parti se reposer aux Baléares.
(Le film terminé Carné devait apprendre que la soi-disant interdiction de la censure, était en réalité un veto des Etablissements Gaumont qui devaient distribuer le film).
Le second incident eut pour cause Jean Stelli.
Ainsi surveillé de toutes parts, Carné se sentait plutôt gêné aux entournures. Aussi, son premier soin fut-il d’éliminer Jean Stelli qui manifestait l’intention de diriger la mise en scène et de laisser à Carné le soin exclusif de faire répéter les acteurs ! C’est à cette occasion que, pour la première fois, le petit homme piqua sur le plateau une de ces colères qui devaient devenir légendaires. Ulcéré, Stelli se retira sous sa tente, je veux dire que, se drapant dans sa dignité offensée, il n’apparut plus, silencieusement, que de loin en loin sur le studio pour y jeter un coup d’oeil méprisant et hautain sur le travail en cours. Ce qui ne l’empêcha pas, le film terminé et accueilli avec une surprise sympathique par la critique, d’aller partout répétant que le film, c’était lui, Stelli, qui l’avait fait !
Albert Préjean, un des principaux interprètes du film assistait, amusé, aux bagarres de Carné contre son entourage. Un jour où l’atmosphère avait été particulièrement orageuse, il s’approcha de son jeune metteur en scène et lui confia :
– T’en fais pas… J’en ai vu des metteurs en scène, mais des metteurs en scène comme toi, je n’en ai pas rencontré beaucoup… Ne te laisse pas faire. Tu iras loin, c’est moi qui te le dis…
Un des producteurs, Albert Pinkovitch, appréciait pourtant le travail de Carné. Il lui confie son projet de l’engager à l’année, en compagnie d’un de ses collègues. Carné aussitôt cite le nom de son cher Feyder; mais l’affaire ne se fait pas, devant, paraît-il, les exigences de celui-ci. Carné lance alors un second nom : Renoir; mais le producteur revient effondré de l’entrevue qu’il a eue avec le réalisateur de Toni. Renoir n’émet-il pas la prétention de tourner un film sur les prisonniers de guerre ? Carné insiste, il sait que Renoir et Spaak traînent ce scénario depuis cinq ans successivement chez tous les producteurs. Un projet qui leur tient tellement à coeur, ne peut donner matière à un film indifférent.
Bref, l’affaire finit par se faire. Ce devait être La Grande Illusion et le succès que l’on connaît.
Quant à Carné, si Renoir devait réaliser pour les R.A.C.: La Marseillaise, il ne fut plus question, lui, de l’engager à l’année. Mieux, Renoir ne ménagera pas, publiquement, ses critiques à Carné et Prévert lorsque sortiront Drôle de Drame et Le Quai des Brumes, celui-ci qualifié par lui de film « fasciste », à la grande fureur de Prévert.
A la sortie de Jenny, la critique n’ignorant pas les antécédents artistiques de Carné, ne manqua pas de trouver dans son film une influence de Feyder — indiscutable et dont je reparlerai plus loin — et également l’influence de René Clair ce qui paraît moins probant. Mais de prime abord, on admira le technicien et le directeur d’acteurs et d’emblée on l’enrôla dans le bataillon des cinéastes « réalistes ».
Néanmoins — seules dissonances à ce concert d’éloges — des restrictions sont déjà faites sur le fond et la moralité de l’histoire !
Si Carné reconnaît volontiers que Jenny est un mélo et que le film, aujourd’hui vieux de quinze ans porte bien son âge, en revanche il se défend d’avoir fait un film réaliste dans le sens entier du mot et davantage encore un film immoral. Mais les étiquettes qu’on vous colle sur le dos ne sont pas toujours faciles à enlever et quoi que Carné dise ou fasse, la soi-disant immoralité de son oeuvre continuera à aller de pair avec sa réputation de croquemitaine.
L’année suivante, en 1937, Carné réalise son second film : Drôle de Drame, adapté librement par Prévert d’un roman de Storer Clouston, His First Offence, dans lequel il semble s’amuser à renier l’influence qu’il a pu subir de Feyder.
Dans ce film plein d’astuces et de cabrioles, il perfectionne encore sa technique et lui donne la souplesse qui va lui permettre dorénavant de faire tout ce qu’il veut. Cependant la critique est assez réticente. L’esprit faussement cartésien du spectateur français est heurté par l’humour déchaîné qui explose à chaque instant et s’indigne quelque peu des personnages Prévertiens sortis tout droit de L’Affaire est dans le Sac.
Boudé d’abord par un public incompréhensif, Drôle de Drame fait, dans les Ciné-Clubs et les salles spécialisées, depuis la libération une seconde carrière, brillante au point que Georges Allary peut écrire dans Le Dictionnaire des Contemporains (1) qu’il est « le film comique des jeunes gens du milieu du siècle ».
(1)Le Crapouillot n. 8 (nouvelle série).
1c – NAISSANCE D’UN MYTHE
C’est avec Le Quai des Brumes que prend vraiment naissance la légende de Marcel Carné, complexe d’admiration et de hargne. Le film fut tourné dans de très grands décors reconstituant quelques rues du Havre. Les échotiers s’emparent aussitôt de l’affaire et l’on commence à reprocher à Carné son goût des dépenses somptuaires et sa folie des grandeurs. (Depuis qu’avec Intolérance, Griffith établit en matière de décors de cinéma un record sans doute jamais égalé, les dimensions des décors s’ils font l’orgueil des producteurs, excitent l’ironie des journalistes…).
Il semble que ce soit également à propos du Quai des Brumes que se développa cette réputation faite à Carné d’être coléreux et mauvais coucheur. En réalité Carné est un petit homme timide, d’une sensibilité quasi-féminine qui confine à la susceptibilité. Il est bourré de complexes d’infériorité, que même ses succès ne l’ont pas aidé à surmonter. Il remplace donc les quelques centimètres qui manquent à son autorité physique, par un caractère parfois agressif et une intransigeance têtue. S’il est tellement méticuleux, jusqu’à l’obsession morbide, c’est qu’il manque souvent de confiance en lui. Ce petit homme qui cache son âge, de peur qu’on le trouve trop jeune; qui vous pose dix fois la même question, comme il recommence dix fois un même plan; qui ne veut pas revoir ses anciens films, parce qu’il est trop tard pour qu’il y change quoi que ce soit, est au fond, un grand inquiet. C’est cette inquiétude, qu’il porte en lui au studio comme dans la vie et qu’il projette sur tous ses personnages, qui lui donne, sans doute, ce sens tragique dont nous parlerons tout à l’heure.
C’est, en tout cas, à propos de Quai des Brumes que Marcel Carné commença sa prodigieuse collection de contre-temps imprévisibles et de graves démêlés avec ses producteurs.
Le film devait d’abord être tourné par la U.F.A. dont Robert Ploquin dirigeait alors à Berlin la section française de production. Mais quand les services du docteur Goebbels eurent lu le scénario, ils furent affolés : jamais un tel film ne pourrait être exploité en Allemagne, jamais la U.F.A. ne pourrait patronner un film aussi « ploutocrate ». On cherche à qui on peut céder le film. Plusieurs producteurs français se trouvent intéressés — pas par Prévert, ni par Carné mais par les conditions avantageuses de Ploquin qui cède Gabin pour 450.000 Francs alors qu’il vaut plus du double — Grégor Rabinovitch se trouvant sur les rangs, ordre fut donné de Berlin de passer l’affaire au « juif » en qui les services du docteur Goebbels avaient davantage confiance !
Grégor Rabinovitch engagea aussitôt la bataille contre Marcel Carné.
Effaré soudain du scénario qu’il devait produire et qu’il ignorait auparavant il commença à demander à Carné de couper tout ce qu’il trouvait « sale » – Rabinovitch appelait « sale » tout ce qui choquait en lui une moralité rudimentaire. Ainsi fut interdit, par lui, le suicide du peintre fou. Mais Carné — profitant de ce qu’il tournait au Havre et que le directeur de production était rappelé à Paris pour un enterrement — décida de passer outre et de tourner tout de même le fameux suicide. La chose fut compliquée du fait que Le Vigan, qui jouait le personnage, n’était plus là. Carné le fit doubler par un assistant qui avait à peu de chose près sa carrure et l’on tourna la scène de dos. Ce fut pourtant Rabinovitch qui eut le dernier mot en faisant couper la scène purement et simplement (Cela servit à Carné de leçon: depuis il exige, par contrat, qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans ses films sans son consentement).
Il eut cependant sa revanche sur un autre point.
On se rappelle que, dans le film, Jean s’acharne à coups de brique sur Zabel. Rabinovitch trouvait cet acharnement « sale » et ne voulait qu’un seul et décisif coup de brique. Carné, dans la salle de montage glissait au monteur : « Laissez trois coups de brique », Rabinovitch passait derrière et ordonnait : « Coupez deux coups de brique » et puis Carné insistait : « Rajoutez trois coups de brique >>. Enfin Rabinovitch céda et laissa plusieurs coups de brique, mais ce fut avec une telle mauvaise grâce qu’on aurait pu croire qu’il les recevait lui-même sur la tête !…
Quand le film fut achevé, Rabinovitch était de plus en plus perplexe au sujet du film qu’il venait d’achever. Aussi envoyait-il ses amis à des projections privées afin de connaître leur avis. Si ceux-ci s’écriaient : « C’est un chef-d’oeuvre! » le générique commençait par : « Grégor Rabinovitch présente ». S’ils avouaient : « C’est abominable! » le nom de Rabinovitch disparaissait. S’ils condescendaient à dire: « Ce n’est pas mal! », il refaisait une apparition timide entre deux acteurs de second plan ou après la script-girl… On refit ainsi le générique quatorze fois !
C’est parce qu’ils reflètent l’inquiétude et le désespoir d’une époque qui sent la guerre inévitable, que les films de Carné sont jugés démoralisants et, par conséquent, immoraux. Beaucoup de gens réclament des artistes, dans les périodes tragiques, qu’ils les chatouillent sous les bras pour les faire rire coûte que coûte. Le Quai des Brumes fut le premier à encourir aussi fortement ces critiques d’un ordre moral :
« Le grand reproche qu’on peut adresser à ce film, ainsi qu’à la plupart des oeuvres cinématographiques de classe de ces dernières années c’est de puiser leur inspiration dans un monde taré et de transformer en héros des criminels, des hors-la-loi, des désaxés (…) Une étrange coïncidence — ou peut-être un état d’esprit regrettable — fait que les meilleurs films français de ces dernières années mettent en lumière des âmes complexes, une atmosphère morbide, et offrent ainsi l’image d’un monde amoral, sans lumière, sans espoir et privé de joie de vivre » . – (R. Henri). Il y eut même un début de « bataille du Quai des Brumes » quand il s’agit d’envoyer le film, avec la sélection française, à la biennale de Venise. Malgré une vive opposition de certains « bien-pensants », le film alla à Venise où il devait recevoir le prix de la Meilleure Réalisation.
Il n’est pas indifférent que ce soit à propos du Quai des Brumes que naisse le mythe Carné, car c’est vraiment le premier film par lequel le réalisateur se soit exprimé. Ses thèmes et ses personnages, on les trouve déjà dans Jenny et Drôle de Drame, voire même dans Nogent, Eldorado du Dimanche, mais imprécis et non encore révélés à Carné lui-même. Dans ses deux premiers grands films, Carné montre un style qui doit beaucoup à ceux qu’il admira ou qui furent ses maîtres. Avec Le Quai des brumes, en même temps qu’il trouve son style propre, Marcel Carné se révèle et nous révèle les thèmes essentiels de son oeuvre.
1d – LE CARNÉ LÉGENDAIRE
Marcel Carné se battant contre la censure qui l’empêcha de réaliser L’Île des Enfants Perdus, contre les producteurs qui veulent lui imposer des scénarios ineptes, contre le public qu’il force à admirer des oeuvres estimables, contre lui-même (il renonce en 1939 à réaliser Rue des Vertus pour ne pas profiter de la mode, alors florissante, des films de gangsters), poursuivait son oeuvre et affirmait sa maîtrise.
Il réalise Hôtel du Nord en 1938 et Le Jour se Lève en 1939 qui sont des variations sur les thèmes déjà exposés dans Le Quai des Brumes et qui, comme ce film, sont accueillis avec chaleur par beaucoup, avec hargne hypocrite par quelques uns (1).
En 1939 Marcel Carné préparait avec Henri Jeanson et Pierre Prévert un film, École Communale, tout à fait dans la ligne de son oeuvre d’alors. Les acteurs étaient engagés, on avait photographié des centaines d’enfants pour les sélectionner en vue de la figuration intelligente, Trauner préparait les décors, Jaubert avait accepté de faire la musique. Le film allait être mis en route, quand la guerre éclata, dispersant l’équipe, Carné lui-même étant mobilisé (dans les pionniers) au grade flatteur de « fonctionnaire caporal ».
Après l’exode et l’armistice, la position de Carné dans la « France-Nouvelle » était assez délicate. Le Quai des Brumes — avec André Gide et les congés payés — était tenu pour responsable de la défaite. Il ne pouvait être question pour Carné de reprendre ses thèmes habituels, du moins sous la forme où il les avait exposés jusque là (2). C’est alors qu’il éprouva le besoin de se réfugier dans le merveilleux.
Ce fut d’abord le projet des Evadés de l’an 4.000 qui ne put aboutir, Carné étant en désaccord avec la production sur le choix de ses interprètes. Puis, séduit par le merveilleux des romans et des nouvelles de Marcel Aymé, il tenta l’adaptation des Bottes de Sept Lieues. Mais, chose curieuse, le merveilleux littéraire de Marcel Aymé ne survivait pas à la transposition visuelle.
Nouveau projet avec Juliette ou La Clef des Songes. Un désaccord avec le producteur au sujet de Jean Cocteau, qui devait en écrire les dialogues additionnels, en fait un nouvel échec.
Enfin ce fut Les Visiteurs du Soir, « légende médiévale » inventée par Jacques Prévert avec la collaboration de Pierre Laroche.
Pendant une année entière Marcel Carné travailla à ce film qui représente un effort considérable (on parla à l’époque de 20 millions) et pour lequel on construisit cet énorme décor du château. (A cette occasion il faut rappeler que ce château n’était pas primitivement de la blancheur immaculée que certains lui reprochèrent. Le décor, construit en plein air, avait été consciencieusement patiné, mais un matin, après une de ces nuits d’orage dont le Midi a le secret, on le découvrit lessivé à neuf. Plutôt que de le repatiner, ce qui aurait coûté fort cher et fait perdre beaucoup de temps, Carné préféra profiter de ce hasard et, rusant avec le soleil pour éviter de trop grandes surfaces blanches, il utilisa le château neuf comme un fond de miniature et en tira de très heureux effets.
Le film sortit à Paris le 5 Décembre 1942 et fut accueilli par la critique avec un enthousiasme jusque là jamais vu. Même François Vinneuil (pseudonyme de Lucien Rebatet) dont le feuilleton toujours sévère aurait pu être suivi avec confiance s’il n’avait été si souvent inspiré par des mobiles politiques, lui consacra une chronique fort élogieuse, au grand soulagement du distributeur qui l’attendait avec inquiétude.
« Il semble bien, dès maintenant, écrivait-il dans Je suis Partout le 11 Décembre 1942, que Les Visiteurs du Soir soit inintelligible à une catégorie considérable de spectateurs… Aucun spectateur de quelque culture ne contestera, je pense, le goût infaillible avec lequel Marcel Carné a créé ses moindres images… Je consens que ce film soit très élaboré, trop rempli d’intentions et de sentiments pour atteindre au lyrisme que l’on aurait aimé y voir par instants. Mais le lyrisme n’est pas toute la poésie… »
Ses confrères de la presse d’alors furent quasi-unanimes à saluer dans Les Visiteurs du Soir une réussite exceptionnelle dont le cinéma français pouvait s’enorgueillir.
« Pour la première fois peut-être depuis que la parole a été donnée au film, le cinéma français se retrouve dans son vrai domaine, celui de la fantaisie, de la poésie, du mystère, des jeux subtils à travers et au-dessus de la réalité… Le rythme est lent, surtout au début, mais c’est le résultat d’un choix et non d’une erreur. On est très vite pris par ce ralenti et on se laisse bercer par la triple incantation, par les trois mélodies tressées des images, des dialogues et du son, ainsi que de la musique » (René Barjavel, L’Echo des Etudiants).
« Ce début de Décembre 1942 marquera dans l’histoire du Cinéma Français une date que nous n’évoquerons jamais sans une émotion profonde » (A. Le Bret, Paris-Soir).
« Nous voici devant le film le plus important tourné en France et sans doute en Europe depuis de longues années ». (Roger Régent, Les Nouveaux Temps).
« Chaque Français quelles que soient ses préventions contre le cinéma, se doit d’aller voir ce film, quand ce ne serait que pour se prouver à lui-même que l’art en France existe… » (Jeander, La Vie Parisienne).
« La parole est maintenant au public, et s’il boude c’est à désespérer de lui. Il faut que Les Visiteurs du Soir soient un succès, il le faut pour l’honneur du cinéma français » (Arthur Hoérée, Comoedia).
Sans doute l’honneur du cinéma français fut-il sauf, car Les Visiteurs du Soir furent un énorme succès et leur influence fut telle qu’elle déborda du domaine strictement cinématographique pour s’exercer sur la mode et même le langage, le titre du film servant encore maintenant pour désigner d’indésirables tardifs.
L’encourageant succès des Visiteurs du Soir qui montrait qu’un film audacieux et cher pouvait être une bonne affaire commerciale, incita Paulvé, son producteur, à confier à l’équipe Carné-Prévert l’élaboration et la réalisation d’un nouveau film de prestige.
Un premier sujet est proposé et rejeté pour diverses raisons : Paulvé le trouve trop hardi et pas assez public (il s’agit du projet de Jour de Sortie que Prévert et Carné reprendront plus tard sans, d’ailleurs, pouvoir le réaliser davantage).
C’est alors que prennent corps Les Enfants du Paradis.
Au début de l’hiver, sur la terrasse de l’hôtel Royal à Nice, Jean-Louis Barrault avait raconté à Prévert et à Carné l’étonnante histoire de Jean-Gaspard Debureau qui, pour avoir tué un homme dans la rue d’un coup de canne, fut arrêté, jugé ; et au procès de qui tout Paris se rendit pour entendre le son de sa voix.
Aussitôt Carné se documente, fouille les bibliothèques, dévalise les antiquaires et ramène des valises entières de papiers et de livres au « Prieuré de Valette », une auberge retirée dans la campagne niçoise, au-dessus de Tourrette sur Loup. Non loin de là se sont réfugiés Kosma et Trauner recherchés par les Allemands. Là, dans le jardin qui s’orne encore de la vasque gothique et de la statue des Visiteurs du Soir, pendant des mois l’équipe travaille. Prévert dessine des scènes, Trauner compose des décors, Kosma construit de la musique, pendant que Mayo qui, entre-temps, à été invité à se joindre à eux, écrit des costumes. Carné, lui, commande ou décommande, accepte ou refuse, suggère ou interdit, accouche en un mot de ce film énorme qui se nomme provisoirement Funambules, et se trouve prêt à tourner au début de l’été.
C’est là que commencèrent les difficultés.
Le premier tour de manivelle est bien donné au studio de la Victorine à Nice le 16 août 1943 et le dernier est prévu pour le 15 décembre de la même année, mais les Américains débarquent en Sicile et les bruits les plus contradictoires circulent. On voit les Américains partout et les imaginations méridionales les font débarquer tous les jours jusque dans la Baie des Anges. La Direction du Cinéma ordonne le repli des studios et de leur matériel à Paris. Il suffit de quinze jours pour en avoir fini avec le décor du Boulevard du Crime, qu’on ne peut évidemment songer à rebâtir ailleurs. Mais l’ordre est formel : il faut se replier à Paris.
Paulvé qui produisait le film à Nice, propose de le continuer à Paris. Mais son offre est refusée et c’est Pathé qui reprend ces enfants terribles (car maintenant le titre est arrêté : Les Enfants du Paradis) non sans mauvaise grâce, d’ailleurs, et seulement sous la pression insistante de la Direction du Cinéma.
Toutes ces négociations ont duré plus de deux mois, ce qui a occasionné des frais énormes (près de dix millions!) puisqu’il a fallu prolonger la location des costumes et trouver des compromis invraisemblables pour les contrats des acteurs et des techniciens (J. L. Barrault est très pris par sa mise en scène du Soulier de Satin à la Comédie Française). Enfin, le 9 Novembre on reprend les prises de vues, mais dans les pires conditions dues surtout au terrible régime des coupures de courant.
En Février 1944, comme les Américains ne sont pas encore à Menton (on colle à Paris des affiches qui montrent un escargot sur la botte italienne) toute l’équipe retourne à Nice. Mais le décor a été en partie détruit par un cyclone et il en coûtera 700.000 frs. de réfection…
En Juin 1944 le film est sur le point d’être achevé quand a lieu le débarquement de Normandie. Marcel Carné ralentit la réalisation du film afin qu’il ne sorte pas dans une France occupée et rêve qu’il sera le premier film français présenté dans Paris libéré. Mais à la Libération Robert Le Vigan qui joue le rôle de Jéricho, est arrêté pour collaboration et les scènes qu’il a déjà tournées, heureusement peu nombreuses, doivent être recommencées avec Pierre Renoir pour qui Prévert a un peu modifié le rôle.
Enfin le film est terminé et il est présenté en grande pompe le 9 Mars 1945 au cours d’un gala au Palais de Chaillot.
Évidemment, ce film tellement attendu, trop attendu, soulève, dès qu’il est lâché dans la cage aux critiques, des réactions diverses. Tout d’abord littéralement abasourdis par l’ampleur et la richesse du film, les critiques, malgré leur scepticisme professionnel, ne purent s’empêcher de laisser éclater leur enthousiasme et crièrent leur admiration. Puis vinrent les restrictions, beaucoup reprochant à la mariée d’être trop belle, d’autres trouvant l’oeuvre plus admirable qu’émouvante, d’autres enfin, tel François Chalais (3) dans Carrefour, regrettant l’inactualité du film dans ses thèmes.
Il y eut aussi, bien sûr, l’inévitable couplet moralisateur, inspiré par l’indignation puritaine et fourni par M. G. Daumas dans Témoignage Chrétien. Sans doute aurait-il été inutile de le signaler, tellement il pouvait être prévu, s’il n’expliquait l’interdiction des Enfants du Paradis par le Comité d’Action Catholique de Montréal, quand le film, qui fit le tour du monde dans une apothéose (les critiques anglais furent délirants d’enthousiasme) parvint au Canada. On doit à la vérité de dire que cette interdiction ne fut que temporaire.
La longueur inusitée du film — Marcel Carné avait tenu à ce que les deux époques fussent toujours présentées en une seule séance — et l’augmentation du prix des places qu’elle entraînait n’empêchèrent pas le film d’être un énorme succès public. Comme Les Visiteurs du Soir, Les Enfants du Paradis démontrèrent qu’un devis impressionnant ne fait pas forcément d’un film une mauvaise affaire pour son producteur.
Après Les Enfants du Paradis, c’est la ronde des projets avortés qui recommence. D’abord Jour de Sortie que j’ai déjà mentionné et que Carné et Prévert reprennent, rebaptisent La Lanterne Magique, pour lequel ils choisissent le décorateur, le musicien, l’opérateur, songent à l’interprétation, qu’ils espèrent pouvoir tourner en couleurs et que, finalement, ils sont obligés d’abandonner, le producteur ne trouvant pas les fonds nécessaires à sa réalisation.
Puis c’est L’Ombre, d’après la nouvelle d’Andersen qui ne dépasse pas le stade du simple projet. C’est Le Masque de la Mort Rouge, d’après la nouvelle d’Edgard Poe, que Carné voudrait également tourner en couleurs et qu’il est obligé d’abandonner devant la difficulté d’un telle entreprise dans les studios français. D’ailleurs à cette époque Marcel Carné est très attiré par la couleur. Ne parle-t-il pas de refaire Le Quai des Brumes en couleurs, mais avec une palette extrêmement réduite, dans la gamme des bruns et des gris, avec, seulement, quelques taches violentes de couleurs vives, un peu comme sont les maquettes de Trauner ?
Enfin un projet semble prendre corps. Il s’agit d’un scénario inspiré par un ballet que Prévert et Kosma donnèrent à Roland Petit et que celui-ci dansa avec Marina de Berg au théâtre Sarah Bernhardt. Le ballet s’appelait Le Rendez-vous. Pourtant le film ne pourra porter ce nom, un film de Lubitsch étant sorti récemment en France sous ce même titre. Il s’intitulera donc Rendez-vous avec le Destin ou encore Le Destin se promène la nuit.
Mais quand Prévert aura achevé le scénario, le film aura encore changé de titre et, l’empruntant à un vers d’une chanson qui y est chantée, il l’appellera, Les Portes de la Nuit. On se souvient de l’incident Marlène Diétrich–Jean Gabin qui faillit empêcher la réalisation du film.
Je le rappelle brièvement pour mémoire :
Lorsqu’on décida chez Pathé de confier un film à Carné, on voulut en faire une grosse production internationale et l’on pensa en confier les deux principaux rôles à Jean Gabin et à Marlène Diétrich. Gabin, qui connaissait bien Carné et Prévert, accepte tout de suite et apporte l’accord de principe de Marlène. Cette dernière se réserve par contrat un droit de regard sur le scénario. Celui-ci en main, elle demande à Prévert quelques modifications qu’il lui accorde. Mais elle tarde à donner sa réponse concernant cette version modifiée. Finalement elle refuse trouvant le rôle un peu mince pour elle. Sans Marlène, Gabin n’a plus guère envie de tourner Les Portes de la Nuit.
On lui propose Maria Mauban comme partenaire ; il la refuse, la trouvant trop jeune. Puis il informe la maison Pathé qu’il lui est impossible de tourner le film de Carné, celui-ci ayant été retardé (par les tergiversations de Marlène Diétrich, les difficultés financières finalement résolues, les retards dans la disponibilité des studios occasionnés par L’Affaire du Collier de la Reine que L’Herbier termine après bien des mésaventures) et lui-même devant tourner à des dates irrévocables Martin Roumagnac, dont il a acheté les droits avant la guerre.
L’affaire est encore embrouillée par des mises au point, des communiqués à la presse du directeur général des syndicats d’acteurs ou de techniciens, des lettres ouvertes dans les journaux, des interviews tapageuses. Carné tient au film (4). La mise en route à déjà coûté près de dix millions. Finalement le film se fait, sans Jean Gabin et sans Marlène Dietrich, avec Yves Montand et Nathalie Nattier, engagée à la dernière minute, ce qui explique, s’il ne l’excuse pas, la médiocrité du choix de cette interprète.
Le film se tourne dans une atmosphère souvent orageuse. On change deux fois de photographes, une fois de chef de publicité et Carné change personnellement un assistant. Les échotiers s’en donnent à coeur joie. Jamais encore les colonnes des journaux cinématographiques et autres, n’ont autant retenti des colères de Marcel Carné, de la grandeur ridicule de ses décors, du prix de revient prohibitif de ses films. Pierre Seize dans le Figaro du 26 Juin 1946 consacre un long article aux Cent millions de Marcel Carné.
Évidemment dès la sortie du film une campagne de presse, encore renforcée par des mobiles politiques, s’orchestra savamment contre le film. Il y eut même dans les salles des sifflets « spontanés », alors que dans les salles environnantes, le public assistait impassible à des médiocrités aujourd’hui oubliées…
Après avoir un moment projeté de tourner Candide avec Gérard Philipe, d’après le conte de Voltaire, Marcel Carné décide de reprendre le projet de L’Île des Enfants Perdus, dont le scénario avait été interdit jadis, par la censure. Le scénario est transformé par Jacques Prévert, puis le titre est changé en La Fleur de L’Age, la censure ayant interdit à nouveau le premier titre.
On sait que ce film dût être interrompu et ne fut jamais achevé. Les détracteurs habituels de Marcel Carné se livrèrent à nouveau à cette occasion à une danse du scalp où la vérité fut souvent violée.
Au départ le financement est assuré par trois groupes :
1) un producteur,
2) deux distributeurs parisiens chargés de la vente à l’étranger,
3) quatre distributeurs régionaux.
Un nouveau financier devait être amené par le producteur au cours du tournage.
Le premier tour de manivelle est donné le 5 Mai 1947 à Belle-Ile-en-Mer. Après dix semaines, dont quatre de mauvais temps pendant lesquelles on n’a pas pu travailler, le film est interrompu. Le quart en est tourné et déjà 45.000.000 de francs ont été dépensés. Sur cette somme il y a dix millions pour les quatre semaines de mauvais temps, et vingt millions de frais de préparation (achat du scénario, du dialogue, des costumes, locations des accessoires, etc., « à valoir » importants sur les contrats, les locations de studio et celle du yacht, etc.). Il n’y a donc que quinze millions pour le quart tourné. Marcel Carné espérait que les dix millions de mauvais temps seraient chiffrés hors devis et, ainsi le devis de 85.000.000 prévu, n’était pas dépassé.
Mais un désaccord était intervenu sur des points divers entre les différents groupes de financement. Profitant d’un voyage à l’étranger du producteur, les autres groupes décident de ne plus effectuer aucun versement jusqu’à l’entrée en studio du film (5). Carné recherche donc la somme nécessaire à l’achèvement des extérieurs. C’est alors qu’il se heurte à la mauvaise volonté de quelques-uns et l’hostilité déclarée d’un haut personnage politique, mort depuis.
Vaincu par la cabale, Marcel Carné abandonne son film et, dégoûté, songe à quitter la France. C’est alors qu’il signe avec Universalia, la grande maison de production italienne, un contrat qui le lie pour deux films.
Le producteur Salvo D’Angelo propose de reprendre La Fleur de l’Age. Mais tourner ce film en Italie pose de nouveaux problèmes d’adaptation (Quelle langue parlera-t-on ? Quel uniforme auront les gardiens ? etc.). Aussi Carné abandonne-t-il rapidement ce projet.
Il songe alors à tirer un film du Château de Kafka. Mais l’exécuteur testamentaire de l’écrivain, propriétaire des droits est introuvable. On le sait en Palestine, mais on ne peut le joindre. Finalement le projet doit être abandonné également.
On parle alors du Barrage d’Arvillars, adapté d’un roman de Thyde Monnier, lui-même inspiré des incidents de Tignes. Le producteur, craignant que Carné n’en fasse un film révolutionnaire, repousse le projet. Après l’abandon d’un scénario original de Jean Anouilh, puis celui des Evadés de l’an 4000 rebaptisés Le soleil Noir, Carné et son producteur se mettent d’accord sur une adaptation d’Eurydice, la pièce de Jean Anouilh qui change bientôt de titre pour s’appeler L’Espace d’un Matin.
Le projet est déjà très avancé : Michèle Morgan sera Eurydice, Gérard Philipe Orphée, Paul Meurisse la Mort, Michel Simon le père d’Orphée, Française Rosay la mère d’Eurydice, etc., etc… C’est alors que des différents graves opposent Marcel Carné à Universalia. Sans doute est-il inutile de revenir maintenant sur cette affaire, sinon pour dire qu’il semble bien qu’elle soit une manifestation de la cabale anti-Carné émigrée en Italie. Je rappelle seulement que le film ne se fit pas, après que le débat eût été porté à la connaissance du public par un échange de lettres ouvertes peu amicales, et annulé le contrat liant Marcel Carné à Universalia pour deux films (6).
Cela faisait trois fois en trois ans que Marcel Carné alimentait — à son corps défendant — la chronique scandaleuse. Le petit homme rentre en France torturé d’inquiétude. Moins sûr de lui que jamais, il parle d’abandonner le cinéma. Tout au moins a-t-il le besoin impérieux de réussir coûte que coûte un film pour se remettre en selle, plus encore à ses propres yeux qu’à ceux des producteurs.
Il reste complètement inactif pendant quelques mois.
Et puis son nom réapparaît dans les journaux spécialisés, d’abord associé à des nouvelles fantaisistes. Puis les nouvelles se précisent et l’on apprend que Marcel Carné va tourner pour Sacha Gordine un film tiré d’un roman de Simenon, La Marie du Port.
Il semble que Carné n’ait pas, dès le départ, attaché un très grand intérêt à ce film. Il devait le réaliser dans un temps assez court, suivant un devis modeste, pour montrer , qu’il était capable de tourner un film d’importance moyenne et détruire ainsi la dangereuse légende de metteur en scène ruineux dont, avec malveillance, on l’entourait. Aussi prépare-t-il longuement et minutieusement le film afin de le tourner dans les délais qui lui étaient strictement impartis.
De même pendant le tournage s’attacha-t-il à détruire une autre légende : celle de metteur en scène coléreux. Jamais il ne fut plus courtois avec les figurants, ni plus aimable avec les journalistes. Il termina son film à la date prévue et sans dépassement du devis. Comme un écolier bien sage il avait fait son devoir en s’appliquant et rendait une copie bien propre et bien présentée.
Du film, dont nous reparlerons, qu’on sache seulement pour l’instant qu’il reflète l’application et la prudence qui assurent la réussite sans trop de danger, dont Marcel Carné avait besoin pour entreprendre de nouveau les oeuvres ambitieuses qui lui tiennent au coeur, telle que Juliette ou la clef des songes, par exemple.
(1) Ces films ne se tournèrent pas tout seuls ; ils eurent eux aussi leurs petites histoires. Celle-ci, qui vient du Jour se lève me semble symptomatique des rapports de Carné et de ses producteurs. Le producteur, pendant le tournage du film, réunissait tous les soirs dans son bureau Carné, Prévert et Trauner et, avec des attitudes tragiques et des trémolos dans la voix, leur annonçait sa ruine et son suicide pour la nuit même. Et comme les trois complices restaient impassibles, « Cela ne vous fait donc rien« , enchaînait le producteur, plus » Odéon » que jamais, « de voir un homme qui va mourir cette nuit ? » Carné et Prévert ne répondaient rien, mais Trauner, secouait la tête et répondait doucement: « non » avec son plus gracieux sourire. Il parait que ce producteur ne travailla jamais plus avec Trauner. Toutefois il ne se suicida pas — et Carné fit Le jour se lève !
(2) A la demande d’Henri Jeanson, Marcel Carné donna à Aujourd’hui (où Galtier-Boissière venait de publier un article fort amusant partant en guerre contre l’esprit vichyste et intitulé : C’est la faute à Quai des brumes) un article particulièrement anodin (Jeanson l’avait menacé de l’écrire lui-même et de lui emprunter sa signature) où sous le titre de Cinéma vieux frère, Carné se moquait des producteurs juifs qui jouaient sur la côte et fort gros jeu pendant que le cinéma se mourait en France. Il n’en fallut pas plus pour le faire taxer d’antisémitisme à la Libération !
(3) Quand le film fut présenté à Londres, François Chalais qui assistait à la projection, révisa son jugement et tint à informer Carné qu’il considérait son film comme une grande oeuvre.
(4) Carné avait un contrat pour un film avec Gabin. Gabin ne faisant plus Les Portes, Carné se trouvait libre d’abandonner le film C’était une solution facile dont il ne se contenta pas. Il alla de l’avant et fit le film sans vedettes.
(5) Je tire ces précisions, ainsi que les chiffres qui précèdent, d’un article de journal corporatif, Le Film Français, du 22 Août 1947.
(6) A la demande d’Universalia, l’affaire fut plus tard arrangée à l’amiable et Marcel Carné, dont le bon droit se trouvait de ce fait reconnu, reçut des dommages et intérêts substantiels sans avoir recours aux tribunaux.

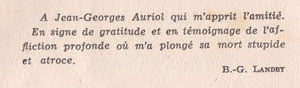
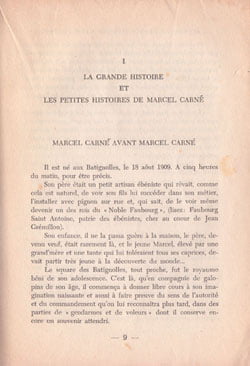
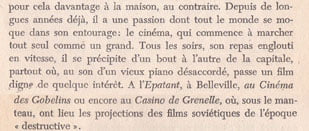
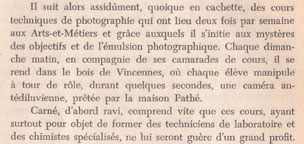
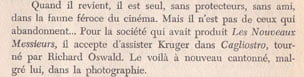
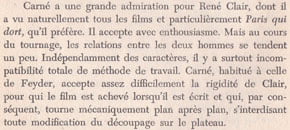
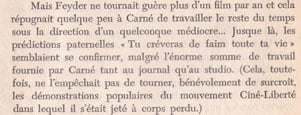
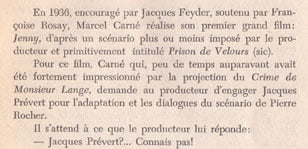

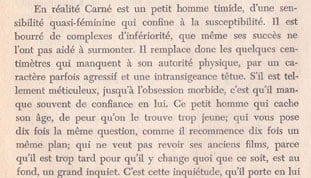
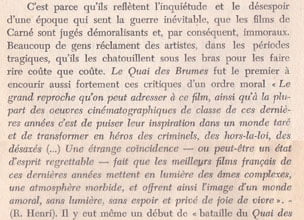
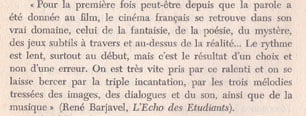
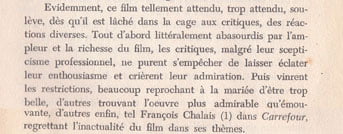
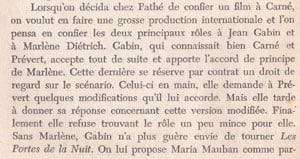
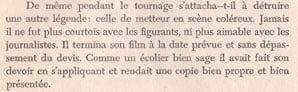
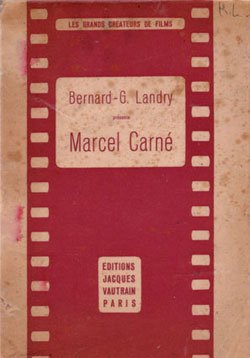
Marlene n’a pas refusé le film par simple caprice. Elle reprochait au scénario de trop évoquer la collaboration et de donner une image négative et pessimiste des Français. Paradoxalement, Marlene, allemande naturalisée américaine, trouvait Prévert et Carné peu patriotiques…